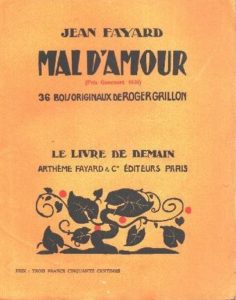 Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit…
Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit…
Jacques Dolent, dont le patronyme désigne toute l’énergie du caractère, rencontre Florence, et c’est le coup de foudre. Mais elle est la maîtresse d’un peintre anglais célèbre, plus âgé. Il nous faut aller de Paris à Arcachon pour assister à la réalisation de cet amour, mais de retour à Paris la dame revient près de son peintre. Divers quiproquos éloignent les deux amants. Florence finalement part aux Etats-Unis avec un troisième homme, officier de marine reconverti dans les affaires.
Le couple revient de New-York ruiné, et l’auteur, ne sachant plus que faire de son héroïne, la fait mourir. De façon à laisser la place aux acteurs pour lesquels il porte un véritable intérêt : les trois hommes abandonnés. Dans les dernières pages, le hasard (enfin presque) les fait se retrouver tous les trois à Arcachon où ils peuvent méditer sur leurs chimères.
Le roman est l’occasion de nous faire découvrir de profondes vérités sur les femmes : « Il y a des femmes intelligentes. Il n’y a pas de femmes qui aient du tact » ; « la maladie d’un être pour lequel elles éprouvent la moindre tendresse élève les femmes à leur plus haute vertu » ; « les femmes franchissent aisément le stade de la pudeur et on se demandait où celle-là s’arrêterait ».
Mais surtout elles sont la cause de douleurs (morales nous dit l’auteur) que les hommes subissent : « Aujourd’hui, la douleur a les cheveux coupés et elle va en costume tailleur. Le métro, les taxis et les cinémas permanents ne comportent plus les beaux atours, ni le langage des dieux, ni les attitudes éplorées. Elle sait se conformer à chaque siècle ; et la ville d’aujourd’hui ne lui fait pas peur. Elle est devenue un peu canaille, elle traîne aux abords des gares, et elle fume, je crois bien. Moins prétentieuse qu’autrefois, elle n’est pas moins tyrannique ».
Ainsi la société change en ces années 30 du XXème siècle, mais la Femme reste éternelle dans sa constance à faire souffrir les hommes.
Andreossi
Mal d’amour, Jean Fayard


 Les découvertes archéologiques du XIX° siècle révélant la polychromie de l’architecture et de la sculpture antiques vont bousculer cet idéal de beauté. De même, l’engouement pour le Moyen-Age et la Renaissance va jouer un rôle important dans la 2ème moitié du XIX° siècle : les œuvres de Henry Cros inspirées du XVI° siècle en constituent une des plus séduisantes illustrations (voir par exemple Le Prix du tournoi). On ne passera pas non plus à côté de l’hommage à Bernard Palissy à travers des statues représentant le célèbre artiste de la Renaissance, l’une en biscuit de porcelaine, l’autre monumentale en faïence décorée d’émaux, signées Charles Octave Lévy.
Les découvertes archéologiques du XIX° siècle révélant la polychromie de l’architecture et de la sculpture antiques vont bousculer cet idéal de beauté. De même, l’engouement pour le Moyen-Age et la Renaissance va jouer un rôle important dans la 2ème moitié du XIX° siècle : les œuvres de Henry Cros inspirées du XVI° siècle en constituent une des plus séduisantes illustrations (voir par exemple Le Prix du tournoi). On ne passera pas non plus à côté de l’hommage à Bernard Palissy à travers des statues représentant le célèbre artiste de la Renaissance, l’une en biscuit de porcelaine, l’autre monumentale en faïence décorée d’émaux, signées Charles Octave Lévy. A l’opposé, mais également dans cette veine historicisante, un émouvant Saint-François de Zacharie Astruc déploie une polychromie toute discrète sur bois peint, ivoire, verre et corde.
A l’opposé, mais également dans cette veine historicisante, un émouvant Saint-François de Zacharie Astruc déploie une polychromie toute discrète sur bois peint, ivoire, verre et corde.


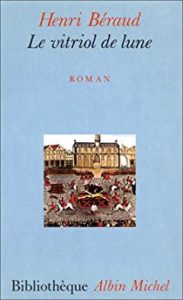 Le vitriol de lune est un poison qui aurait été utilisé par les assassins de Louis XV, selon Henri Béraud qui obtint par ce roman historique le Goncourt 1922. Curieusement le livre a été pour ce même prix couplé à un autre roman du même auteur, Le Martyre de l’obèse, alors que la qualité du Vitriol de lune suffit au plaisir du lecteur.
Le vitriol de lune est un poison qui aurait été utilisé par les assassins de Louis XV, selon Henri Béraud qui obtint par ce roman historique le Goncourt 1922. Curieusement le livre a été pour ce même prix couplé à un autre roman du même auteur, Le Martyre de l’obèse, alors que la qualité du Vitriol de lune suffit au plaisir du lecteur.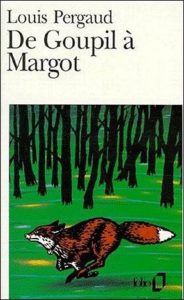 Les histoires de bêtes de Louis Pergaud (prix Goncourt 1910) ne sont pas des fables. Il nous conte la vie des animaux dans leur cadre naturel, confrontés à leurs semblables ou aux humains, dans un monde où règne la sauvagerie, à peu près la même qui a fait perdre la vie à Pergaud à Verdun, en 1915.
Les histoires de bêtes de Louis Pergaud (prix Goncourt 1910) ne sont pas des fables. Il nous conte la vie des animaux dans leur cadre naturel, confrontés à leurs semblables ou aux humains, dans un monde où règne la sauvagerie, à peu près la même qui a fait perdre la vie à Pergaud à Verdun, en 1915.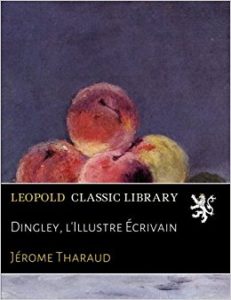 Le quatrième Prix Goncourt, en 1906, a été un ouvrage des frères Tharaud. Connus pour avoir toujours écrit à quatre mains plus de cinquante livres, ils sont entrés à l’Académie Française dans les années 40. Celui-ci est un court roman, qui évoque pour nous une guerre lointaine, celle des Boers en Afrique du Sud.
Le quatrième Prix Goncourt, en 1906, a été un ouvrage des frères Tharaud. Connus pour avoir toujours écrit à quatre mains plus de cinquante livres, ils sont entrés à l’Académie Française dans les années 40. Celui-ci est un court roman, qui évoque pour nous une guerre lointaine, celle des Boers en Afrique du Sud. Le Goncourt de l’an 2000 n’a pas inauguré une nouvelle ère de la littérature : on a du mal à s’intéresser à ces personnages publics des années 70, artistes qui ont certes marqué leur temps mais dont les anecdotes qui les font vivre sous nos yeux ne réussissent pas à réaliser des portraits qui les rendent vraiment attachants.
Le Goncourt de l’an 2000 n’a pas inauguré une nouvelle ère de la littérature : on a du mal à s’intéresser à ces personnages publics des années 70, artistes qui ont certes marqué leur temps mais dont les anecdotes qui les font vivre sous nos yeux ne réussissent pas à réaliser des portraits qui les rendent vraiment attachants. Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France.
Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France. C’est avec intérêt qu’on lit ce roman prix Goncourt de 1980, et avec amusement que l’on découvre certaines formules (« peindre des natures vivantes », ou « la place qui respire à plein poumons morts » ou encore lorsque les malentendus sont plutôt des « mal écoutés ») ; mais malgré ces clins d’œil, le climat du livre reste très pesant, car on assiste, pour la plupart des personnages, à l’impossibilité de faire leur deuil de la perte d’un proche.
C’est avec intérêt qu’on lit ce roman prix Goncourt de 1980, et avec amusement que l’on découvre certaines formules (« peindre des natures vivantes », ou « la place qui respire à plein poumons morts » ou encore lorsque les malentendus sont plutôt des « mal écoutés ») ; mais malgré ces clins d’œil, le climat du livre reste très pesant, car on assiste, pour la plupart des personnages, à l’impossibilité de faire leur deuil de la perte d’un proche. Est-il une occasion plus merveilleuse de découvrir Alcina, de Haendel, que dans une telle production ? Difficile à imaginer. Le Théâtre des Champs-Elysées était plein à craquer ce vendredi soir pour cette deuxième représentation (sur quatre seulement), et le dense public n’a pas été déçu.
Est-il une occasion plus merveilleuse de découvrir Alcina, de Haendel, que dans une telle production ? Difficile à imaginer. Le Théâtre des Champs-Elysées était plein à craquer ce vendredi soir pour cette deuxième représentation (sur quatre seulement), et le dense public n’a pas été déçu. Un Philippe Jaroussky qui, pour en revenir à ce mémorable Alcina, partageait l’affiche avec l’immense star du lyrique Cecilia Bartoli. La belle romaine impressionna par une interprétation tout en subtilité de cette reine cruelle, particulièrement émouvante en amoureuse abandonnée par son amant dans le superbe « Ah, mio cor ! ». L’amant en question, Ruggiero, n’était autre que Philippe Jaroussky soi-même. Sa célèbre voix de contre-alto, d’une virtuosité époustouflante, séduit tant dans les solos que dans les ensembles avec les voix féminines, dont il faut signaler la mezzo Varduhi Abrahamyan dans le rôle de sa promise, Bradamante. Jouant d’abord un rôle d’homme pour dissimuler à Alcina sa véritable identité, elle révèle ensuite à Ruggiero qui elle l’est et le convainc de la suivre et d’abandonner la terrible Alcina. La plasticité et la suavité de sa voix la mettaient parfaitement à sa place au sein d’une distribution si enlevée.
Un Philippe Jaroussky qui, pour en revenir à ce mémorable Alcina, partageait l’affiche avec l’immense star du lyrique Cecilia Bartoli. La belle romaine impressionna par une interprétation tout en subtilité de cette reine cruelle, particulièrement émouvante en amoureuse abandonnée par son amant dans le superbe « Ah, mio cor ! ». L’amant en question, Ruggiero, n’était autre que Philippe Jaroussky soi-même. Sa célèbre voix de contre-alto, d’une virtuosité époustouflante, séduit tant dans les solos que dans les ensembles avec les voix féminines, dont il faut signaler la mezzo Varduhi Abrahamyan dans le rôle de sa promise, Bradamante. Jouant d’abord un rôle d’homme pour dissimuler à Alcina sa véritable identité, elle révèle ensuite à Ruggiero qui elle l’est et le convainc de la suivre et d’abandonner la terrible Alcina. La plasticité et la suavité de sa voix la mettaient parfaitement à sa place au sein d’une distribution si enlevée. Un Goncourt 1974 vite lu car très court, mais qui laisse bien songeur. Car ce portrait de cette jeune femme, Pomme, nous semble à la fois très suggestif (nous avons l’impression de l’avoir rencontrée), et aussi très incomplet car, comme le narrateur le reconnaît à la fin du roman, nous avons le sentiment d’avoir manqué Pomme.
Un Goncourt 1974 vite lu car très court, mais qui laisse bien songeur. Car ce portrait de cette jeune femme, Pomme, nous semble à la fois très suggestif (nous avons l’impression de l’avoir rencontrée), et aussi très incomplet car, comme le narrateur le reconnaît à la fin du roman, nous avons le sentiment d’avoir manqué Pomme.