
Cent ans après la naissance de l’artiste suisse Gérard de Palézieux (1919-2012), la Fondation Custodia lui rend un très bel hommage avec un accrochage centré sur son œuvre graphique. L’exposition déploie plus d’une centaine d’œuvres sur papier dans les techniques privilégiées par Palézieux : l’estampe, le dessin, le lavis et l’aquarelle.
Né à Vevey (Suisse), Palézieux commença des études classiques qu’il interrompit à seize ans pour s’inscrire à l’Ecole des Beaux-Arts de Lausanne. En 1939, il étudia à l’Académie de Florence, où il s’initia à l’art de la Renaissance et découvrit le paysage toscan. C’est à ce moment qu’il fit la découverte de la peinture de Giorgio Morandi, à qui il rendit visite plus tard, et qui eut une importance décisive sur sa propre production.
De retour en Suisse en 1943, Palézieux s’établit à Veyras, près de Sierre, dans le Valais, dans une petite maison vigneronne qu’il habitera jusqu’à sa mort. Exception faite de ses excursions régulières en Provence et en Italie, il ne quittera pratiquement plus le Valais. Ses lavis, dessins et eaux-fortes représentent collines et forêts, bâtiments et corps de ferme, calmes et solides, baignés dans une lumière frémissante, paysages de neige… Autre thème privilégié de son art, les natures mortes avec leurs compositions sobres, presque minimalistes.

A partir de 1975, l’artiste s’exerça assidûment à l’aquarelle, technique coïncidant avec la découverte de Venise où Palézieux se rendit désormais régulièrement.
L’exposition fournit un bel aperçu de ce trajet. On constatera les progrès accomplis par le graveur depuis ses premières eaux-fortes encore tributaires de l’exemple admiré de Morandi, jusqu’aux ultimes essais à l’aquatinte. On admirera les variations du crayon qui vont d’une approche scrupuleuse à la pointe jusqu’aux grandes craies lithographiques. Enfin, sommet de l’œuvre sur papier, les aquarelles dans lesquelles Palézieux exprime la saisie de l’instant : paysages et villages du Valais enfouis dans la neige, dont l’artiste pressent qu’ils sont voués à une dégradation inéluctable, Venise dans la brume bleue de la lagune…
Les poètes dont il était l’ami, et avec lesquels il a beaucoup dialogué dans de superbes livres d’artiste (Philippe Jaccottet bien sûr, Yves Bonnefoy, Gustave Roud), ont été les premiers à aimer l’œuvre de Palézieux, la commentant volontiers, dans l’indifférence presque générale des historiens de l’art.
Si on accepte de se laisser saisir par cette œuvre « aussi évidemment attachée aux perceptions silencieuses, aux sentiments et aux expériences qui répugnent à se dire » (Yves Bonnefoy), on ne pourra qu’apprécier l’exposition de ce travail discret qui, dans le calme et le recueillement, loin des bouleversements et des modes, vise à préserver une harmonie qui peu à peu nous échappe.
Jean-Yves
Fondation Custodia 121, rue de Lille, Paris 7ème
Jusqu’au 15 décembre 2019 – heures d’ouverture : tous les jours sauf le lundi, de 12h à 18h
L’exposition Palézieux (1919-2012). Œuvres sur papier est organisée en partenariat avec le Musée Jenisch Vevey (Suisse), où elle sera montrée du 7 février au 10 mai 2020.
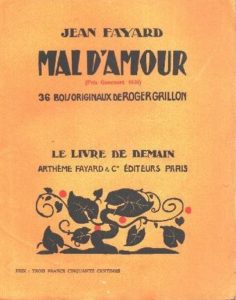 Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit…
Mais quelles qualités ont bien pu trouver les jurés du Goncourt 1931 à ce roman ? Peut-être celles de son éditeur, Arthème Fayard, le grand-père de Jean Fayard qui lui-même, quelques années après prendra la tête des éditions Fayard ? L’histoire de ces pauvres hommes séduits et abandonnés par l’ingrate et inconstante Florence méritait-elle de figurer au palmarès des plus beaux ratages de l’histoire du Prix ? Ce Mal d’amour a gagné contre Saint Exupéry et son Vol de Nuit…


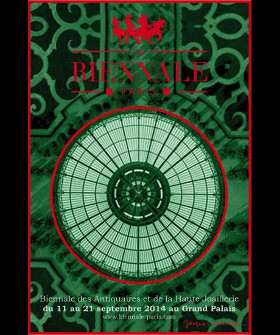

 Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café.
Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café. La maîtrise de la fabrique de la porcelaine fut une histoire longue et compliquée en Europe.
La maîtrise de la fabrique de la porcelaine fut une histoire longue et compliquée en Europe.