
Si vous vous rendez à New-York, vous visiterez certainement le MET, le MOMA et/ou le Guggenheim… Mais profitez-en aussi pour découvrir la Frick Collection, qui recèle une foule de merveilles, peintures, sculptures et arts décoratifs, notamment du XVIII° siècle.
L’autre intérêt de ce musée situé à quelques mètres de Central Park est que ces chefs-d’œuvre sont restés dans le décor voulu par leur collectionneur, Henry Clay Frick (1849-1919), magnat du charbon et de l’acier, qui fit construire en 1913 ce palais néoclassique où il vécut les cinq dernières années de sa vie. On admire les décors intérieurs, d’une extrême élégance comme l’est l’hôtel particulier lui même conçu par Thomas Hastings (architecte de la New-York public Library), tout en s’extasiant devant l’enchaînement d’œuvres de tout premier plan.
Dès le vestibule, on tombe en arrêt devant un Officier et jeune fille souriante de Vermeer, l’un des trois tableaux du maître de Delf que compte la collection (sur une trentaine conservés dans le monde au total). Présence des personnages, beauté de la lumière, douceur et mystère… un petit bijou.

Une des premières salles expose des toiles de Boucher sur le thème des arts et des sciences. Elles proviennent du château de Crécy-Couvé de Mme de Pompadour, aujourd’hui détruit. Boiseries et mobilier sont aussi du XVIII° français, de même que les porcelaines de Sèvres. Une Diane chasseresse de Houdon surveille le tout. La salle à manger, elle, reprend le décor d’une maison de campagne anglaise du XVIII° siècle et présente des portraits de Gainsborough. Le couloir nous fait retrouver Boucher, avec quatre toiles peintes pour Mme de Pompadour et illustrant les quatre saisons, de délicieuses scènes amoureuses. Celles-ci nous préparent à s’immerger dans le salon Fragonard, où s’étalent les Quatre âges de l’amour que le peintre de Grasse a exécutées pour Mme du Barry (qui du reste les refusa, les trouvant démodées).

La salle de séjour, en boiseries de chêne, laisse la légèreté sur son seuil, mais non l’émotion : alors qu’un grave Saint Jérôme du Greco se dresse au dessus de la cheminée, lui fait face le chef d’œuvre de Bellini L’extase de Saint François. On reste dans cette pièce un moment. D’autant que Saint François est flanqué de deux portraits du Titien, un charmant jeune homme à gauche et, à droite, le vieil Aretin. Le contraste entre les deux est saisissant : d’un côté la douceur et la sensibilité, de l’autre la puissance et la richesse…

Dans le couloir suivant se mêlent Degas, Manet, Monet mais surtout un petit tableau de Watteau, La porte de Valenciennes, intéressant par le traitement du sujet de la guerre qu’en fait le peintre, ainsi qu’une superbe Comtesse d’Haussonville d’Ingres. La galerie ouest, de style Renaissance italienne avec marbre et plafond à caissons, a été voulue par le collectionneur comme une galerie d’exposition : Vermeer, Turner, Velasquez, Rembrandt, Véronèse, Corot, Claude Lorrain (magnifique Sermon sur la montagne) régalent ainsi le visiteur. Il n’oubliera pas d’aller dans la petite galerie du fond où l’attendent de ravissants émaux de Limoges datant de la fin du XV° au début du XVII° siècles ainsi que des tableaux de la Renaissance italienne dont les panneaux du polyptyque de Saint Augustin de Piero della Francesca… Aperçu non exhaustif bien sûr !






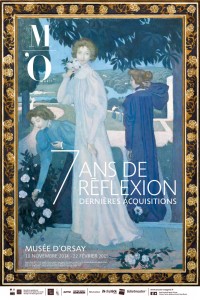
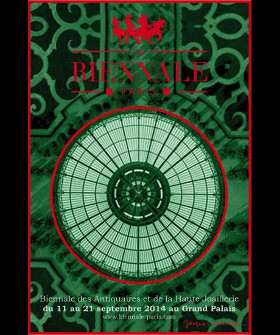

 L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite.
L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite. Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets.
Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets. Jamais exposition au Grand Palais n’avait, semble-t-il, été à ce point mise en scène.
Jamais exposition au Grand Palais n’avait, semble-t-il, été à ce point mise en scène. Grande beauté en revanche autour d’elle sur le plan des arts décoratifs : le goût éclectique et raffiné de la Reine associé au savoir-faire des artisans de l’époque – et à des dépenses inconsidérées ! – est l’occasion d’admirer aujourd’hui des pièces exceptionnelles.
Grande beauté en revanche autour d’elle sur le plan des arts décoratifs : le goût éclectique et raffiné de la Reine associé au savoir-faire des artisans de l’époque – et à des dépenses inconsidérées ! – est l’occasion d’admirer aujourd’hui des pièces exceptionnelles.