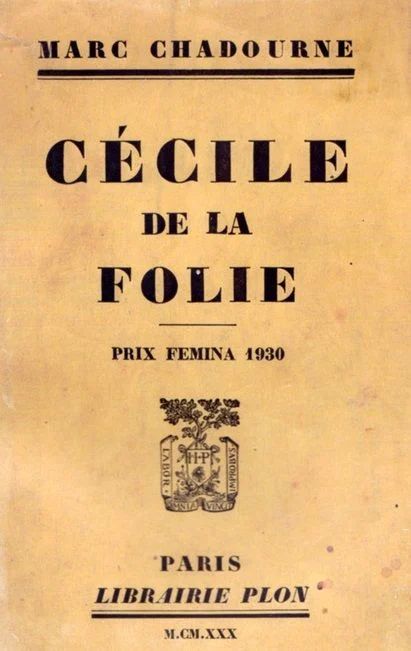
L’auteur n’insiste pas beaucoup sur ce qui apparaît pourtant comme le thème majeur de ce roman oublié, prix Fémina en 1930 : les conséquences traumatisantes de la guerre, qui agissent en sourdine sur l’individu qui a subit cinq ans de combats, entre 1914 et 1919. Marc Chadourne lui-même a connu pareil destin, et sa biographie dit qu’il a mené « une vie errante » après cette guerre. Il est entré au Ministère des colonies, et a terminé sa carrière comme professeur aux Etats-Unis. Traducteur de Joseph Conrad, il a produit 17 livres, couronnés par le grand prix de l’Académie Française en 1950.
Le roman conte l’histoire d’amour entre François Mesnace et Cécile de La Folie. Ils se sont fréquentés jeunes et avant de partir au front il lui demande une relation davantage charnelle, qu’elle refuse. On ne sait rien de ce qu’il vit pendant ces années, mais il n’est plus le même homme à son retour. Ainsi, à la fête du 14 juillet 1919 : « Qu’avaient-elles apporté ces cinq années ? Elles s’achevaient en fumées, rumeurs et pétarades. Une liesse funèbre célébrait le retour dans la fourmilière. Que valait de revenir se perdre, insignifiante unité, dans cette masse d’êtres tous assujettis au destin de se suivre, de se presser, de s’imiter, de se recommencer ? » Et aussi : « L’idée de mort, née de l’expérience de la guerre, le hantait de nouveau, obstinée à le convaincre que tout effort allait au néant ».
De retour chez Cécile, même interrogation : « Qu’est-il revenu faire ici ? Etre là ou ailleurs aujourd’hui. Oui, mais pourquoi en lui cette dolence, cette envie de prendre sa tête dans ses mains, de s’abandonner à des rêves ? ». Cécile n’a pas changé dans ses sentiments, qui restent d’une remarquable ténacité malgré les errements de François. Elle connaît pourtant bien des déboires : pianiste, elle s’use à donner des leçons de piano qui entravent ses possibilités de carrière plus prestigieuse ; elle doit aussi prendre soin de son père malade ; son frère n’est qu’un fardeau de plus.
Sans rompre véritablement, François se détache, et même la complicité des débuts autour de la culture (« Ils ont ouvert ensemble un livre merveilleux. Du côté de chez Swann, d’un auteur inconnu ») tend à disparaître. La patience de l’une ne peut suffire aux penchants erratiques de l’autre et chacun avance vers son destin tragique.
Le roman est agréable à suivre, dans un style sans graisse superflue, ponctué de références littéraires bienvenues : Goethe, l’Arioste, François Villon, et le philosophe Schopenhauer, qui nous laisse méditer sa sentence : « L’essentiel est ce qui dure, non ce qui devient toujours ».
Andreossi
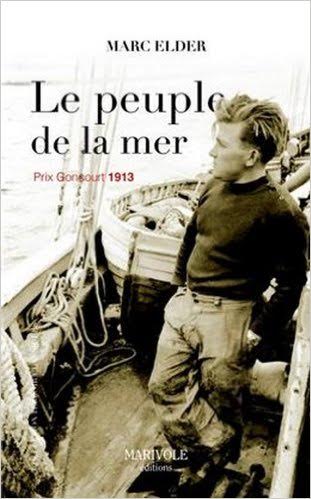
 Le narrateur, cet enfant, puis ce jeune homme, puis cet homme mûr qui voulait devenir écrivain sans jamais y parvenir trouve par hasard, au moment de sa vie où il a renoncé à son projet, la matière de son livre.
Le narrateur, cet enfant, puis ce jeune homme, puis cet homme mûr qui voulait devenir écrivain sans jamais y parvenir trouve par hasard, au moment de sa vie où il a renoncé à son projet, la matière de son livre. A la fameuse matinée Guermantes, au cours de laquelle des réminiscences successives lui donnent enfin la clé du livre à écrire, le narrateur est frappé par la transformation physique des convives qui, comme lui, pendant ces longues années où il ne les a pas vus, éloigné de Paris qu’il était dans une maison de santé, ont terriblement vieilli.
A la fameuse matinée Guermantes, au cours de laquelle des réminiscences successives lui donnent enfin la clé du livre à écrire, le narrateur est frappé par la transformation physique des convives qui, comme lui, pendant ces longues années où il ne les a pas vus, éloigné de Paris qu’il était dans une maison de santé, ont terriblement vieilli. A la toute fin de A la recherche du temps perdu, alors qu’il est malade et craint de ne pas avoir la force d’écrire son oeuvre, le narrateur évoque ce moment de réminiscences où, lorsqu’il était dans l’hôtel des Guermantes, un tintement de sonnette lui fit "entendre" celui qui, quand il était enfant, à Combray, marquait le signal du départ de M. Swann que ses parents venaient de raccompagner à l’entrée du jardin, c’est-à-dire celui du moment où il pourrait embrasser sa mère avant de dormir.
A la toute fin de A la recherche du temps perdu, alors qu’il est malade et craint de ne pas avoir la force d’écrire son oeuvre, le narrateur évoque ce moment de réminiscences où, lorsqu’il était dans l’hôtel des Guermantes, un tintement de sonnette lui fit "entendre" celui qui, quand il était enfant, à Combray, marquait le signal du départ de M. Swann que ses parents venaient de raccompagner à l’entrée du jardin, c’est-à-dire celui du moment où il pourrait embrasser sa mère avant de dormir. Le narrateur a le désir de devenir écrivain dès son enfance, époque où il entreprend de décrire les clochers de Martinville (1).
Le narrateur a le désir de devenir écrivain dès son enfance, époque où il entreprend de décrire les clochers de Martinville (1). Dans Elles, succession de courts récits sur les femmes que J.-B. Pontalis a connues, aimées, dont il a lu ou entendu l’histoire, le célèbre psychanalyste parle-t-il véritablement des femmes ?
Dans Elles, succession de courts récits sur les femmes que J.-B. Pontalis a connues, aimées, dont il a lu ou entendu l’histoire, le célèbre psychanalyste parle-t-il véritablement des femmes ? Lors de son séjour de « retour » à Combray, au cours duquel il n’éprouve pas l’émotion qu’il avait espérée, le narrateur séjourne chez Gilberte, la fille de Swann, devenue Mme de Saint-Loup.
Lors de son séjour de « retour » à Combray, au cours duquel il n’éprouve pas l’émotion qu’il avait espérée, le narrateur séjourne chez Gilberte, la fille de Swann, devenue Mme de Saint-Loup. Dans La prisonnière, le narrateur, épris d’Albertine, la tient chez lui en liberté très surveillée.
Dans La prisonnière, le narrateur, épris d’Albertine, la tient chez lui en liberté très surveillée. En observant les amours de ses amis, celui de Swann pour Odette, celui de Saint-Loup pour Rachel, le narrateur, à de nombreuses occasions, a mesuré l’importance de l’habitude dans la persistance d’une histoire amoureuse.
En observant les amours de ses amis, celui de Swann pour Odette, celui de Saint-Loup pour Rachel, le narrateur, à de nombreuses occasions, a mesuré l’importance de l’habitude dans la persistance d’une histoire amoureuse.