 C’est un texte sur la Révolution, sur les bouleversements politiques et sociaux, mais aussi sur l’exil et les passions, vus à hauteur d’homme. Un texte magnifique et d’une grande justesse qui fait une entrée magistrale à la Comédie-Française grâce à une mise en scène des plus fines et une troupe au sommet de son art.
C’est un texte sur la Révolution, sur les bouleversements politiques et sociaux, mais aussi sur l’exil et les passions, vus à hauteur d’homme. Un texte magnifique et d’une grande justesse qui fait une entrée magistrale à la Comédie-Française grâce à une mise en scène des plus fines et une troupe au sommet de son art.
Au début du XXème siècle, quelque part dans la vieille Europe de l’Empire Austro-hongrois, la Révolution éclate. Le Comte et la Comtesse Almaviva fuient leur pays, accompagnés de Figaro et de Suzanne, devenus époux. Privé de biens, l’aristocrate continue malgré tout à mener grand train, persuadé qu’il reviendra bien vite "dormir dans son lit". Mais Figaro sait qu’il n’en sera rien, et sent qu’il est temps de prendre son indépendance et de s’établir. Retrouvant l’un de ses nombreux anciens métiers, il s’installe coiffeur dans une petite ville de Bavière. Là, il flatte la petite-bourgeoisie locale par ses façons empressées, et prospère. Mais Suzanne, qui ne reconnaît plus son Figaro sous tant d’hypocrisie le quitte. Le Compte Almaviva est lui ruiné, las, mais atteint d’une certaine douceur. D’une façon ou d’une autre, tous traverseront à nouveau la frontière.
Chassé de l’Allemagne nazie dans les années 1930, Odon von Horvath a écrit Figaro divorce alors qu’il errait en Europe avec l’espoir de gagner les Etats-Unis. Il ne put aller plus loin, tué à l’âge de 37 ans par la chute d’une branche d’arbre à la sortie du théâtre Marigny à Paris.
Imprégné des craintes nées de la montée de la révolution brune, son texte dénonce autant les ravages de l’autoritarisme politique que ceux des mentalités petites bourgeoises, xénophobes et hypocrites.
Il fallait beaucoup d’intelligence pour monter ce texte subtil et en donner à voir toutes les facettes. Un pari que Jacques Lassalle a absolument réussi, avec des comédiens qui font ressortir tout ce que cette pièce a de bouleversant, sur cette humanité bien sombre, sur la douleur de l’exil et la permanence des passions.
Figaro divorce
Comédie en trois actes d’Odon von Horvath
Traduit de l’allemand par Henri Christophe et Louis Le Goeffic
Avec Bruno Raffaelli, Michel Vuillermoz, Florence Viala, Claude Mathieu, Denis Podalydès… Jusqu’au 19 juillet 2008
Reprise à la rentrée, du 3 octobre au 15 décembre 2008
Comédie-Française
A 20 h 30, matinée à 14 h
Durée : 3 h env. avec entracte
De 5 € à 37 €
 L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence.
L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence. Il faut le reconnaître, une aquarelle ne séduit pas forcément du premier coup d’oeil. Contrairement à la peinture à l’huile et à la gouache, plus hautes en couleurs, plus pleines, plus aguicheuses, le fin lavis de l’aquarelle a le charme si discret que l’on pourrait passer devant sans le remarquer.
Il faut le reconnaître, une aquarelle ne séduit pas forcément du premier coup d’oeil. Contrairement à la peinture à l’huile et à la gouache, plus hautes en couleurs, plus pleines, plus aguicheuses, le fin lavis de l’aquarelle a le charme si discret que l’on pourrait passer devant sans le remarquer. Ample, passionnante, l’exposition consacrée à Annie Leibovitz jusqu’au 14 septembre à la Maison européenne de la photographie est aussi très surprenante. La célèbre photographe des couvertures glacées américaines, de Rolling Stone à Vogue en passant par Vanity Fair a choisi de mêler à ses portraits les plus connus toute une série d’images personnelles.
Ample, passionnante, l’exposition consacrée à Annie Leibovitz jusqu’au 14 septembre à la Maison européenne de la photographie est aussi très surprenante. La célèbre photographe des couvertures glacées américaines, de Rolling Stone à Vogue en passant par Vanity Fair a choisi de mêler à ses portraits les plus connus toute une série d’images personnelles. A l’initiative d’un groupe d’amis ibériques auxquels se sont joints professionnels et amateurs de cinéma, les soirées Espagnolas en Passy ont réuni chaque dernier lundi du mois depuis janvier 2008 Espagnols d’origine et d’affinité au Majestic Passy autour de films espagnols inédits. (1)
A l’initiative d’un groupe d’amis ibériques auxquels se sont joints professionnels et amateurs de cinéma, les soirées Espagnolas en Passy ont réuni chaque dernier lundi du mois depuis janvier 2008 Espagnols d’origine et d’affinité au Majestic Passy autour de films espagnols inédits. (1) Avec la très belle exposition autour des premières photographies sur papier britanniques,
Avec la très belle exposition autour des premières photographies sur papier britanniques,  Lorsqu’une fée de la robe prend ses quartiers dans le palais d’un fou de tissus et de décors, le séjour promet d’être heureux.
Lorsqu’une fée de la robe prend ses quartiers dans le palais d’un fou de tissus et de décors, le séjour promet d’être heureux.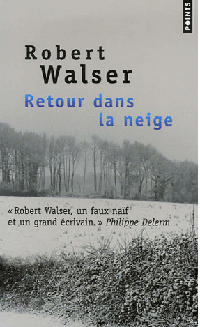 Vous lisez la première courte histoire de Robert Walser, Une rue de grande ville et vous vous dites : c’est agréable, bien décrit, léger, mais où veut-il en venir ?
Vous lisez la première courte histoire de Robert Walser, Une rue de grande ville et vous vous dites : c’est agréable, bien décrit, léger, mais où veut-il en venir ? En finir avec le mythe d’une origine exclusivement romaine de l’Europe en montrant les apports des peuples dits Barbares, tel est le propos de la vaste exposition présentée jusqu’au 20 juillet au Palazzo Grassi de Venise.
En finir avec le mythe d’une origine exclusivement romaine de l’Europe en montrant les apports des peuples dits Barbares, tel est le propos de la vaste exposition présentée jusqu’au 20 juillet au Palazzo Grassi de Venise. Sarcophages, mosaïques, sculptures, textiles, statues, bijoux, manuscrits enluminés, armes, vaisselle, le tout magnifiquement mis en valeur témoignent de ce foisonnement et de ces interpénétrations, tenant toutefois éloignées les sources qui pourraient venir de l’autre rive de la Méditerranée, au demeurant vaguement qualifiées "d’éléments exogènes". Il s’agit de raconter l’histoire de la naissance de l’Europe, entre Italie, où est présentée l’exposition, France (par son commissaire d’exposition, Jean-Jacques Aillagon et son mécène) et Allemagne (manifestation organisée en association avec la Kunst und Ausstellungshalle de Bon). Le propos est on ne peut plus clair.
Sarcophages, mosaïques, sculptures, textiles, statues, bijoux, manuscrits enluminés, armes, vaisselle, le tout magnifiquement mis en valeur témoignent de ce foisonnement et de ces interpénétrations, tenant toutefois éloignées les sources qui pourraient venir de l’autre rive de la Méditerranée, au demeurant vaguement qualifiées "d’éléments exogènes". Il s’agit de raconter l’histoire de la naissance de l’Europe, entre Italie, où est présentée l’exposition, France (par son commissaire d’exposition, Jean-Jacques Aillagon et son mécène) et Allemagne (manifestation organisée en association avec la Kunst und Ausstellungshalle de Bon). Le propos est on ne peut plus clair. François Morel ne quitte plus les planches du Théâtre du Rond-Point : après Collection particulière en 2006 et Les Diablogues l’année dernière, il revient ce printemps avec Bien des choses, conçu et interprété avec son complice des Deschiens Olivier Saladin.
François Morel ne quitte plus les planches du Théâtre du Rond-Point : après Collection particulière en 2006 et Les Diablogues l’année dernière, il revient ce printemps avec Bien des choses, conçu et interprété avec son complice des Deschiens Olivier Saladin.