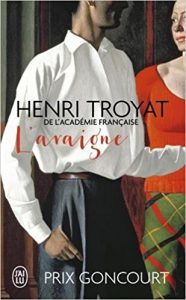 Ce n’est pas que le prix Goncourt 1938 ne se lise pas sans intérêt, car tout au long du roman l’on se demande jusqu’où ira Gérard dans son odieux comportement vis-à-vis de ses sœurs. Mais qu’un tel personnage est pénible à suivre dans les méandres de ses bassesses !
Ce n’est pas que le prix Goncourt 1938 ne se lise pas sans intérêt, car tout au long du roman l’on se demande jusqu’où ira Gérard dans son odieux comportement vis-à-vis de ses sœurs. Mais qu’un tel personnage est pénible à suivre dans les méandres de ses bassesses !
Troyat nous plonge dans un tel huis clos familial qu’on en oublie vite où les événements se passent. Ne cherchons pas de paysages quelque peu ouverts qui aideraient à notre respiration, l’environnement privilégié est celui des chambres, celle de notre héros en particulier, dont on inhale les relents morbides et l’atmosphère étouffante du ressassement. Car Gérard n’a qu’une obsession : garder auprès de lui, non seulement sa mère veuve, mais aussi ses trois sœurs, en âge de se marier, et qui ne se gênent pas pour en avoir les projets.
L’une après l’autre elles subissent les manigances de leur frère visant à faire échouer leur relation avec un homme. Il y parvient presque, mais heureusement pour le lecteur sa dernière tentative pour ramener toute ces faibles femmes autour de son lit d’apprenti suicidé (« Hors de sa présence, elles courraient mille dangers précis dont il les eût protégées »), il évalue mal la dose de médicaments avalés.
Le roman est écrit essentiellement à l’aide de dialogues, ce qui lui donne son ton vif, et on a plaisir à remarquer de temps à autre des formules surprenantes : « Ils s’installèrent dans un minuscule fumoir surchauffé, encombré de sièges bas pour derrières de kangourous et de petites tables approximativement arabes à incrustations de nacre ».
Au-delà du rapport à ses sœurs, les relations aux femmes de Gérard débordent sur la question de la chair, pas simple pour le bonhomme. Ainsi à propos du mariage : « Pouvait-on lutter contre cette alliance que crée entre deux êtres la franchise bestiale du repos en commun, des repas en commun, des communes défaites de la chair ? ». Ainsi à propos de sa sœur enceinte : « Gérard ne pouvait plus détacher les yeux de cette grosseur respirante, de cette poche immonde, de ce fardeau abhorré, qui gonflait Elisabeth et la rendait semblable à une cuillère ».
Mais la dévalorisation ne va-t-elle pas au-delà encore, lorsqu’il s’agit de décrire les femmes faisant leurs courses : « Une foule de ménagères se bousculaient autour des étalages, telles des mouches sur une flaque de miel. Elles avançaient, reculaient, clabaudaient, le porte-monnaie serré contre le ventre, la tête occupée de calculs infimes, l’œil pilleur. Dans ce fade relent de mangeaille, elles préparaient de quoi bourrer leur famille pour le soir. Leur laideur, leur indigence, leur empressement de poules voraces lui giclaient au visage ».
L’araigne, Henri Troyat
Andreossi
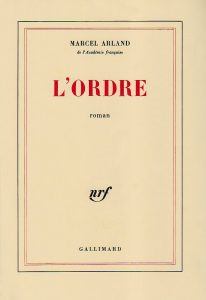 Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.
Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.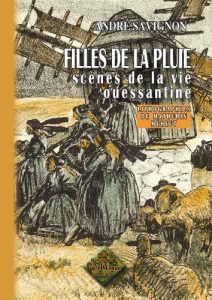 Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain.
Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain.