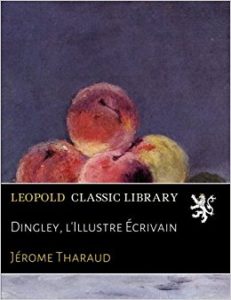 Le quatrième Prix Goncourt, en 1906, a été un ouvrage des frères Tharaud. Connus pour avoir toujours écrit à quatre mains plus de cinquante livres, ils sont entrés à l’Académie Française dans les années 40. Celui-ci est un court roman, qui évoque pour nous une guerre lointaine, celle des Boers en Afrique du Sud.
Le quatrième Prix Goncourt, en 1906, a été un ouvrage des frères Tharaud. Connus pour avoir toujours écrit à quatre mains plus de cinquante livres, ils sont entrés à l’Académie Française dans les années 40. Celui-ci est un court roman, qui évoque pour nous une guerre lointaine, celle des Boers en Afrique du Sud.
Nous devons sortir du roman pour situer l’action dans l’espace et dans le temps, car les auteurs restent sur ce point assez allusifs, supposant une histoire connue de tous. C’est au tournant des années 1880-1881 que les Anglais tentent d’assurer leur domination sur le Transvaal, alors occupé depuis un siècle par les Boers, fermiers d’origine essentiellement hollandaise. Les auteurs font parfois allusion aussi aux Zoulous, qui eux sont enracinés en Afrique depuis fort longtemps mais qui semblent tenir une place modeste dans le conflit.
L’accent est mis sur la personnalité de l’illustre écrivain Dingley, qui, fort de son autorité d’auteur à succès, part sur le front des combats afin d’écrire un roman à la gloire du soldat anglais engagé à étendre la suprématie de la civilisation anglaise : « nous ne sommes pas des conquérants ; nous sommes les aménageurs de la terre, des entrepreneurs qui construisent des maisons sur des terrains vagues, des télégraphistes, des conducteurs de locomotives, des chercheurs d’or, des éleveurs de moutons ».
Est mise en parallèle la position de son épouse qui représente des valeurs d’humanité. D’abord par le fait qu’elle s’occupe de son enfant malade alors que son mari court les batailles. Et puis surtout par l’influence qu’elle tente d’exercer sur lui pour qu’il intervienne auprès des autorités anglaises afin de sauver la vie du jeune Lucas condamné à mort. Car Lucas vient d’une famille d’Africander loyaliste qui accepte la domination anglaise, mais lui-même a pris le parti des Boers qui se révoltent. Or, Dingley avait été fait prisonnier par les Boers, et Lucas, magnanimement, l’avait libéré.
Dingley ne cède pas devant les pressions et répond à sa femme : « Pourquoi voulez-vous qu’une aventure personnelle et qui n’intéresse que moi intervienne dans les affaires de l’Empire ? ». Lucas est exécuté et l’écrivain, déjà illustre, aura beaucoup de succès avec son roman sur la guerre des Boers.
Malgré sa critique du colonialisme anglais le livre a de la peine à offrir des arguments pour le faire sortir de l’oubli, tant les personnages ne paraissent que comme des portraits types voulant soutenir une thèse.
Andreossi
Dingley l’illustre écrivain, Jérôme et Jean Tharaud
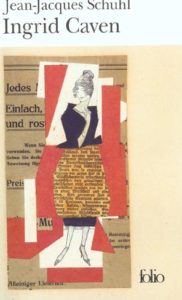 Le Goncourt de l’an 2000 n’a pas inauguré une nouvelle ère de la littérature : on a du mal à s’intéresser à ces personnages publics des années 70, artistes qui ont certes marqué leur temps mais dont les anecdotes qui les font vivre sous nos yeux ne réussissent pas à réaliser des portraits qui les rendent vraiment attachants.
Le Goncourt de l’an 2000 n’a pas inauguré une nouvelle ère de la littérature : on a du mal à s’intéresser à ces personnages publics des années 70, artistes qui ont certes marqué leur temps mais dont les anecdotes qui les font vivre sous nos yeux ne réussissent pas à réaliser des portraits qui les rendent vraiment attachants. Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France.
Marie Sophie Laborieux est l’héroïne du roman de Patrick Chamoiseau qui a remporté le prix Goncourt en 1992. Elle confie son récit au Marqueur de paroles, et elle a de quoi raconter, car elle commence par les souvenirs laissés par son cher papa Esternome et sa manman Idomédée nés esclaves dans la Martinique, colonie française d’alors, pour terminer sur sa victoire bien à elle : faire reconnaître comme quartier à part entière le bidonville qu’elle a initié près de Fort de France.