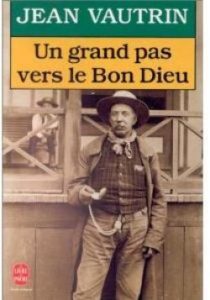 Il faut d’abord s’habituer au français du Goncourt 1989 : « En moins que rien il avait grab son vieille carabine et, craignant plus la nuit, se jeta au hasard des fardoches. Tant pis les ramponeaux, les griffures des broussailles sur ses mollets de kildi, il sentait pas son sang ». Sauf à consulter un dictionnaire du langage cajun, le sens de certains mots restera secret, mais quelque connaissance de l’anglais aidera souvent, tant le parler de la Louisiane emprunte à la langue voisine.
Il faut d’abord s’habituer au français du Goncourt 1989 : « En moins que rien il avait grab son vieille carabine et, craignant plus la nuit, se jeta au hasard des fardoches. Tant pis les ramponeaux, les griffures des broussailles sur ses mollets de kildi, il sentait pas son sang ». Sauf à consulter un dictionnaire du langage cajun, le sens de certains mots restera secret, mais quelque connaissance de l’anglais aidera souvent, tant le parler de la Louisiane emprunte à la langue voisine.
La première partie de ce gros roman relève de la performance par cette ténacité de l’auteur à rendre compte de l’histoire d’Edius Raquin à l’aide de ce vocabulaire si expressif : « Le vieux avait un sac-à-pite retourné sur les épaules pour se protéger de la mouillure. Une raide redingote tissée dans une plante fibreuse que nouzaut, icite, dans les campagnes de la Louisiane, appellent ‘baïonnette espagnole’ ».
Les aventures d’Edius, dans cette fin du XIXe siècle, relèvent du western, avec bandits hauts en couleurs, shérifs, assassinats racistes, revolvers. Il devient ami de Farouche Ferraille Crowley, un pilleur de banque, lui-même poursuivi par un tueur, et ne trouve pas mieux que de marier sa fille Azeline de 16 ans (par ailleurs très consentante) à ce bel homme recherché par toutes les polices. Le jour du mariage, le shérif arrive avec ses hommes, dont l’alcool semble être l’arme la mieux partagée, et c’est le carnage.
Nous sommes à la moitié du roman et nous avons lu, et de loin, la meilleure partie, essentiellement grâce au pittoresque des personnages, (comme la Noire Mom’zelle Grand-Doigt ou l’Indien Jody McBrown) et des scènes très enlevées. Mais la suite est bien décevante. Nous avons quitté la campagne pour La Nouvelle Orléans au temps des débuts du jazz et nous suivons la jeunesse du fils issu des amours de Farouche Ferraille Crowley et d’Azeline. Mais, malgré le caractère très documenté sur cette époque importante pour l’histoire de la musique, le roman devient ennuyeux.
Il vaut mieux se souvenir du charme de certains dialogues de la première partie du roman, tel celui qui relate la confession d’Azeline au curé du village : « -Ah, père ! père ! Même si j’vous parais folle, verte et naïve, pardonnez ! J’l’ai aimé en un jour. Et l’lendemain, c’était pire ! (…) –Disez- moi si vous avez « glissé », ma fille dit-il simplement. Aussi combien de fois le serpent a mordu. Et à quelle hauteur, s’il vous plaît ? Azeline égrenait à nouveau son rosaire sans déblater. Les mots nouaient dans sa gorge. Ils étaient mayère trop étouffants pour pouvoir passer son bec doux ».
Andreossi
Un grand pas vers le Bon Dieu. Jean Vautrin
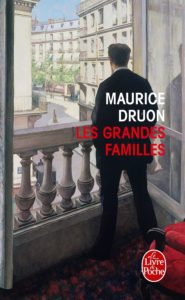 Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.
Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.
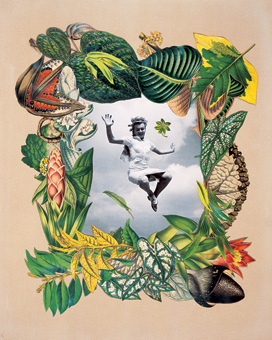 Il reste peu de temps pour aller voir les expositions Prévert et Guibert à la Maison européenne de la photographie à Paris : précipitez-vous-y d’ici le 10 avril car l’ensemble est absolument magnifique.
Il reste peu de temps pour aller voir les expositions Prévert et Guibert à la Maison européenne de la photographie à Paris : précipitez-vous-y d’ici le 10 avril car l’ensemble est absolument magnifique. Changement d’ambiance radical avec la superbe exposition de photographies d’Hervé Guibert. Petit format, noir et blanc, beaucoup de scènes d’intérieur, d’autoportraits et d’images de proches : on est ici dans le royaume de l’intime.
Changement d’ambiance radical avec la superbe exposition de photographies d’Hervé Guibert. Petit format, noir et blanc, beaucoup de scènes d’intérieur, d’autoportraits et d’images de proches : on est ici dans le royaume de l’intime. Lorsque les habitants de l’Arles du deuxième siècle (Arelate) devaient aller assister aux courses de char, ils quittaient le haut de la ville pour cette zone de marais en bord de Rhône où venait d’être construit le cirque.
Lorsque les habitants de l’Arles du deuxième siècle (Arelate) devaient aller assister aux courses de char, ils quittaient le haut de la ville pour cette zone de marais en bord de Rhône où venait d’être construit le cirque. On peut apprendre aussi beaucoup de choses sur la vie dans une colonie romaine, en particulier par les maquettes, patiemment réalisées, qui nous montrent par exemple la façon dont le velum protégeait les 20 000 spectateurs du soleil, dans l’amphithéâtre. Ou celle de la meunerie hydraulique de Barbegal, véritable industrie minotière qui produisait jusqu’à quatre tonnes et demie de farine par jour.
On peut apprendre aussi beaucoup de choses sur la vie dans une colonie romaine, en particulier par les maquettes, patiemment réalisées, qui nous montrent par exemple la façon dont le velum protégeait les 20 000 spectateurs du soleil, dans l’amphithéâtre. Ou celle de la meunerie hydraulique de Barbegal, véritable industrie minotière qui produisait jusqu’à quatre tonnes et demie de farine par jour.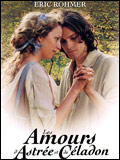 Nous sommes dans la verte et pastorale Gaule du V° siècle. L’histoire nous est contée par Honoré Urfé, écrivain du XVIIème siècle totalement oublié.
Nous sommes dans la verte et pastorale Gaule du V° siècle. L’histoire nous est contée par Honoré Urfé, écrivain du XVIIème siècle totalement oublié.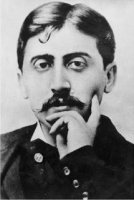 En observant les amours de ses amis, celui de Swann pour Odette, celui de Saint-Loup pour Rachel, le narrateur, à de nombreuses occasions, a mesuré l’importance de l’habitude dans la persistance d’une histoire amoureuse.
En observant les amours de ses amis, celui de Swann pour Odette, celui de Saint-Loup pour Rachel, le narrateur, à de nombreuses occasions, a mesuré l’importance de l’habitude dans la persistance d’une histoire amoureuse.