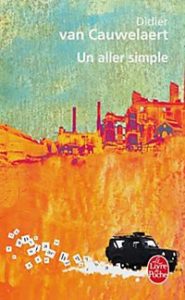 Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages.
Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages.
On l’a appelé Aziz parce qu’on l’a trouvé bébé dans une Ami 6. Elevé par une famille Tsigane, il a des (faux) papiers d’identité marocains et gagne sa vie dans les quartiers Nord de Marseille en travaillant dans le recyclage des autoradios volés. Repéré comme clandestin, il est renvoyé dans un pays, le Maroc, qu’il n’a aucune raison de considérer comme le sien.
C’est un fonctionnaire français, Jean-Pierre, qui le reconduit « chez lui », mais son village d’origine ayant été inventé pour cause d’identité factice, la quête se révèle difficile. Aziz, qui aime raconter des histoires, arrive facilement à convaincre son accompagnateur qu’il vient d’une vallée montagnarde de l’Atlas marocain quasi secrète. Ils sont aidés dans leur recherche par une guide, Valérie, dont les deux hommes tombent amoureux.
A partir du voyage au Maroc, l’histoire devient davantage celle de Jean-Pierre que celle d’Aziz. Récemment abandonné par sa femme, il remet en cause sa vie antérieure et, à l’occasion de l’écriture de son « carnet de mission », envisage d’écrire un roman qu’il baptisera « Un aller simple », car il n’est plus question pour lui de revenir en arrière. Pourtant, lorsque la maladie l’atteint, c’est son passé d’enfance et de jeunesse qui revient, dans sa Lorraine natale victime de la désindustrialisation.
Aziz revient en France ramener le corps de Jean-Pierre, finalement mort avant de découvrir la vallée mystérieuse. Partis d’une affaire de migrant renvoyé « chez lui », nous arrivons en Lorraine et ses anciens hauts fourneaux : « Le savoir-faire centenaire des meilleurs hauts-fournistes d’Europe, qui vendaient leur fonte jusqu’en Amérique, s’est transformé en préretraite, dispense d’activité, reclassement ».
Ainsi le roman dévoile son ambition sociologique, dont nous avions eu un aperçu sans nuances dans les premières pages à propos de certains quartiers de Marseille : « La vie est calme, à Vallon-Fleuri, et les descentes sont rares. Il faut dire qu’un policier qui se mettrait en tête de contrôler les identités dans les quartiers nord, d’abord il serait immédiatement reconduit à la frontière, et puis le préfet lui passerait un savon, parce que la mesure qu’il a prise pour faire baisser la criminalité, le préfet, c’est de décider qu’on n’existe pas ».
Andreossi
Un aller simple. Didier Van Cauwelaert
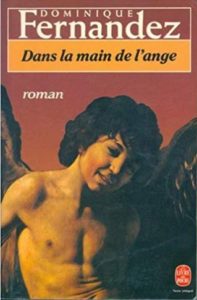 C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70.
C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70.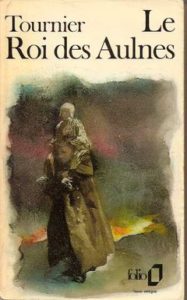 Un livre puissant que ce Goncourt 1970, qui pose la question de la relation de l’adulte mâle à l’enfant dans des termes parfois dérangeants, mais aussi très travaillés. Il s’agit bien de l’histoire d’une fascination et de l’accès à des fantasmes lointains. Abel Tiffauges se défend de tout geste à caractère sexuel mais peut-il écarter la question du désir ? « Il n’y a sans doute rien de plus émouvant dans une vie d’homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué ».
Un livre puissant que ce Goncourt 1970, qui pose la question de la relation de l’adulte mâle à l’enfant dans des termes parfois dérangeants, mais aussi très travaillés. Il s’agit bien de l’histoire d’une fascination et de l’accès à des fantasmes lointains. Abel Tiffauges se défend de tout geste à caractère sexuel mais peut-il écarter la question du désir ? « Il n’y a sans doute rien de plus émouvant dans une vie d’homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué ».
 Dans le même temps, l’exposition montre, et l’intérêt est plus grand encore, l‘invention progressive d’un style personnel, une patte, une sensibilité. A remonter les sections, le sentiment se dégage que cette découverte par l’artiste (qui est d’emblée à la fois dessinateur, peintre et sculpteur) de sa propre voie a pour passage crucial sa période dite bleue, faite de douleur et d’intériorité, à la suite du suicide de son ami Casagemas. D’un expressionnisme poignant, il peint le portrait de son ami mort, puis son enterrement ; on est soudain à un jet de pierre de Tolède et de l’Enterrement du Comte d’Orgaz du Greco. C’est dire l’hommage que Picasso entend faire à son compagnon défunt, mais aussi l’audace du jeune peintre. Au cours de ces années, il est comme entièrement tourné vers ceux qui souffrent : prostituées enfermées à Saint-Lazare pour cause de maladies vénériennes, aveugles, mères esseulées avec enfants.
Dans le même temps, l’exposition montre, et l’intérêt est plus grand encore, l‘invention progressive d’un style personnel, une patte, une sensibilité. A remonter les sections, le sentiment se dégage que cette découverte par l’artiste (qui est d’emblée à la fois dessinateur, peintre et sculpteur) de sa propre voie a pour passage crucial sa période dite bleue, faite de douleur et d’intériorité, à la suite du suicide de son ami Casagemas. D’un expressionnisme poignant, il peint le portrait de son ami mort, puis son enterrement ; on est soudain à un jet de pierre de Tolède et de l’Enterrement du Comte d’Orgaz du Greco. C’est dire l’hommage que Picasso entend faire à son compagnon défunt, mais aussi l’audace du jeune peintre. Au cours de ces années, il est comme entièrement tourné vers ceux qui souffrent : prostituées enfermées à Saint-Lazare pour cause de maladies vénériennes, aveugles, mères esseulées avec enfants.
 Par un samedi de septembre, alors que les journées du patrimoine battaient leur plein sous un soleil radieux, nous avons délaissé monuments historiques, ouvertures exceptionnelles et files d’attente pour découvrir ce qui nous attendait toute l’année et depuis des années : les serres d’Auteuil.
Par un samedi de septembre, alors que les journées du patrimoine battaient leur plein sous un soleil radieux, nous avons délaissé monuments historiques, ouvertures exceptionnelles et files d’attente pour découvrir ce qui nous attendait toute l’année et depuis des années : les serres d’Auteuil. laisser intriguer, attirer, séduire par telle ou telle espèce, sans jamais se sentir pris dans un programme.
laisser intriguer, attirer, séduire par telle ou telle espèce, sans jamais se sentir pris dans un programme. La jeune femme narratrice du prix Goncourt 1962 est un personnage attachant, bien qu’elle apparaisse assez compliquée à son entourage. On sait peu de choses sur elle, mais on sait l’essentiel : une douleur fondamentale, un deuil indépassable, qui lui font refuser les relations avec ceux qui l’approchent. C’est qu’elle est hantée par les fantômes de ses parents et de son ami, qu’elle a perdus en Pologne, durant la guerre.
La jeune femme narratrice du prix Goncourt 1962 est un personnage attachant, bien qu’elle apparaisse assez compliquée à son entourage. On sait peu de choses sur elle, mais on sait l’essentiel : une douleur fondamentale, un deuil indépassable, qui lui font refuser les relations avec ceux qui l’approchent. C’est qu’elle est hantée par les fantômes de ses parents et de son ami, qu’elle a perdus en Pologne, durant la guerre. Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre.
Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre. Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.
Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.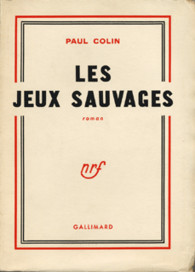 L’auteur du Goncourt 1950 est complètement oublié, et on ne voit pas comment il aurait pu en être autrement. Que son roman ait devancé cette année-là Marguerite Duras et son « Barrage contre le Pacifique » relève d’un des plus grands mystères de l’attribution du Goncourt. Mais Paul Colin a peut-être été assez lucide sur ses talents pour se retirer, sitôt le prix obtenu, sur une propriété viticole et ne publier qu’un seul autre roman une dizaine d’années plus tard.
L’auteur du Goncourt 1950 est complètement oublié, et on ne voit pas comment il aurait pu en être autrement. Que son roman ait devancé cette année-là Marguerite Duras et son « Barrage contre le Pacifique » relève d’un des plus grands mystères de l’attribution du Goncourt. Mais Paul Colin a peut-être été assez lucide sur ses talents pour se retirer, sitôt le prix obtenu, sur une propriété viticole et ne publier qu’un seul autre roman une dizaine d’années plus tard.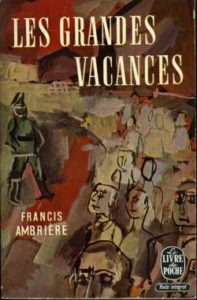 Drôle de titre pour ce prix Goncourt 1940, décerné en fait en 1946, pour cause de perturbation due à la guerre 39-40 : il s’agit du récit de la vie d’un prisonnier de guerre français sous le régime nazi, soit cinquante six mois de vie en camp décrits avec une précision journalistique.
Drôle de titre pour ce prix Goncourt 1940, décerné en fait en 1946, pour cause de perturbation due à la guerre 39-40 : il s’agit du récit de la vie d’un prisonnier de guerre français sous le régime nazi, soit cinquante six mois de vie en camp décrits avec une précision journalistique.
 De l’autre côté de la place, en glissant le long de l’antique grille, on arrive au château, qui nous renvoie au riche passé de Capestang et plus largement du Narbonnais. Edifié à partir du XII°, mais principalement au XIII° siècle, le château était l’une des demeures seigneuriales de l’archevêque de Narbonne, dont la province ecclésiastique, aussi vaste que prospère, s’étendait de la Garonne au Rhône et de la Méditerranée aux contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes.
De l’autre côté de la place, en glissant le long de l’antique grille, on arrive au château, qui nous renvoie au riche passé de Capestang et plus largement du Narbonnais. Edifié à partir du XII°, mais principalement au XIII° siècle, le château était l’une des demeures seigneuriales de l’archevêque de Narbonne, dont la province ecclésiastique, aussi vaste que prospère, s’étendait de la Garonne au Rhône et de la Méditerranée aux contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes. Si l’on y vient aujourd’hui, c’est pour admirer les poutres de la salle d’apparat décorées au XV° siècle sous l’archiépiscopat des Harcourt, Jean puis Louis. Le bestiaire regorge d’oiseaux de l’étang tout proche (dont le village tire son nom), tels coqs, échassiers, cigognes, mais aussi de lévriers et d’animaux fantastiques. Les scènes de société illustrent les danses et l’amour courtois de la noblesse autant que les activités quotidiennes des classes modestes. Les scènes religieuses quant à elles montrent les tourments de l’Enfer promis aux pécheurs et la Rédemption aux justes, mais aussi une Vierge à l’enfant et saint Jean l’Evangéliste, saint patron de l’archevêque Jean d’Harcourt.
Si l’on y vient aujourd’hui, c’est pour admirer les poutres de la salle d’apparat décorées au XV° siècle sous l’archiépiscopat des Harcourt, Jean puis Louis. Le bestiaire regorge d’oiseaux de l’étang tout proche (dont le village tire son nom), tels coqs, échassiers, cigognes, mais aussi de lévriers et d’animaux fantastiques. Les scènes de société illustrent les danses et l’amour courtois de la noblesse autant que les activités quotidiennes des classes modestes. Les scènes religieuses quant à elles montrent les tourments de l’Enfer promis aux pécheurs et la Rédemption aux justes, mais aussi une Vierge à l’enfant et saint Jean l’Evangéliste, saint patron de l’archevêque Jean d’Harcourt.