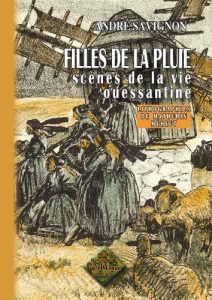 Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain.
Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain.
Les différents textes sont autant de portraits de femmes qui le plus souvent ont eu une histoire tragique. Certaines ont subi la violence masculine, d’autres une cruelle solitude. Les histoires d’amour qui commencent ne se terminent jamais dans le bonheur. C’est qu’un fossé énorme sépare les filles des garçons, comme s’il était donné à l’avance qu’une vraie rencontre entre les deux est impossible : « Trois fois elle avait été de noces. Or, ici, ces cérémonies ne sont pas, comme ailleurs, des occasions fournies aux jeunes gens de se réunir et de lier connaissance. Les noces ouessantines se réduisent à un cortège chantant d’îliennes qui promènent à travers le pays le marié et deux ou trois garçons d’honneur, tous gênés, au milieu de ces filles qui, dans leur innocence effrontée, ont l’air de célébrer une prise ».
Si certaines de ces femmes font preuve d’initiative, de courage, d’une grande volonté, Savignon insiste peu sur les solidarités féminines dont on peut supposer qu’elles ont pu être nécessaires sur une île à la vie si rude. L’absence d’hommes semble ouvrir la voie à des fantasmes masculins que l’auteur semble partager : ces femmes sont prêtes à accueillir les étrangers dans une liberté sexuelle rarement connue ailleurs. Pourtant, à l’époque du récit, ce sont surtout des soldats d’un régiment colonial qui débarquent en garnison à Ouessant, et on peut imaginer quel type d’offre ces hommes proposent.
Le pittoresque n’est pas absent de l’évocation de cette vie à Ouessant au début du vingtième siècle, et la dénonciation des changements que Savignon observe n’est pas exempte d’une idéalisation d’une vie plus « naturelle » qui serait propre à la condition d’isolement : « (…) savez-vous, fichez nous la paix !… F…-nous le camp, avec vos progrès et vos inventions du diable, vos journaux, vos phares, votre télégraphie sans fil et vos soldats et votre argent qui a corrompu notre île. Laissez-nous nos anciens usages et, que vous veniez de France ou d’ailleurs, partez, allez coloniser plus loin : nous en avons assez d’être traités comme des nègres ou des canaques !… ».
Exotisme et rêves de disponibilités amoureuses ne suffisent pas à assurer l’adhésion à ces neuf histoires.
Andreossi
Filles de la pluie. André Savignon
 Il y a trois ans, on avait beaucoup aimé, du même auteur, Comment vous racontez la partie vue dans ce même théâtre du Rond-Point à Paris. Le propos y était corrosif, la mise en scène efficace, le jeu des acteurs excellent.
Il y a trois ans, on avait beaucoup aimé, du même auteur, Comment vous racontez la partie vue dans ce même théâtre du Rond-Point à Paris. Le propos y était corrosif, la mise en scène efficace, le jeu des acteurs excellent. Autour d’elle, dans une atmosphère devenue étouffante et tendue à l’extrême, chacun des personnages sent le sol tanguer sous ses pieds, Boris-le-sans-vaillance vacille sous la menace d’une liquidation judiciaire, Yvonne la veuve a toujours peur d’avoir perdu son sac devenu, avec son petit calepin dedans, son (seul) compagnon. Quant au couple d’amis, il finit par céder aussi, abandonnant son souci du prochain et sa bien-séance de bon aloi, remuant la vieille mère, jetant le dessert du grand restaurant, se dessoudant un instant… La Bella figura finit par craquer de toute part. Seule Andrea, assurément la plus esseulée de tous, parvient, grâce à son apparence de légèreté et de fantaisie, à continuer à faire Belle figura. Et apparaît en définitive comme la plus lucide de tous.
Autour d’elle, dans une atmosphère devenue étouffante et tendue à l’extrême, chacun des personnages sent le sol tanguer sous ses pieds, Boris-le-sans-vaillance vacille sous la menace d’une liquidation judiciaire, Yvonne la veuve a toujours peur d’avoir perdu son sac devenu, avec son petit calepin dedans, son (seul) compagnon. Quant au couple d’amis, il finit par céder aussi, abandonnant son souci du prochain et sa bien-séance de bon aloi, remuant la vieille mère, jetant le dessert du grand restaurant, se dessoudant un instant… La Bella figura finit par craquer de toute part. Seule Andrea, assurément la plus esseulée de tous, parvient, grâce à son apparence de légèreté et de fantaisie, à continuer à faire Belle figura. Et apparaît en définitive comme la plus lucide de tous.


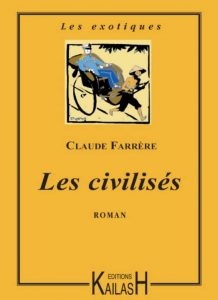 Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.
Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.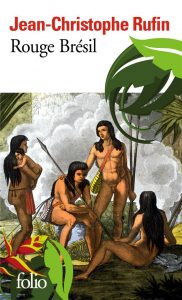 Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant.
Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant. Un livre fort que ce prix Goncourt 1996. Dans le genre plutôt court, après une lecture sans pause, il laisse le sentiment que tout est encore à comprendre dans la fascination de la narratrice pour le pilote kamikaze Tsurukawa.
Un livre fort que ce prix Goncourt 1996. Dans le genre plutôt court, après une lecture sans pause, il laisse le sentiment que tout est encore à comprendre dans la fascination de la narratrice pour le pilote kamikaze Tsurukawa. Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.
Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème. Bien sûr, il nous faut accepter de lire ce français étrange, image de l’acadien du XVIIIème siècle, qui fait toute la saveur du Goncourt 1979, si on veut en apprécier toute la richesse. Il faudra renoncer à comprendre tous les mots tout de suite, et patienter en comptant sur la répétition pour saisir le sens de « bâsir », « devanteau » ou « dumeshui ». La plupart de ces mots toutefois se laisse découvrir aisément (« asteur », « obstineux », « défricheter »).
Bien sûr, il nous faut accepter de lire ce français étrange, image de l’acadien du XVIIIème siècle, qui fait toute la saveur du Goncourt 1979, si on veut en apprécier toute la richesse. Il faudra renoncer à comprendre tous les mots tout de suite, et patienter en comptant sur la répétition pour saisir le sens de « bâsir », « devanteau » ou « dumeshui ». La plupart de ces mots toutefois se laisse découvrir aisément (« asteur », « obstineux », « défricheter »). C’est dans la tête de Sigismond Pons que se passe presque toute l’action de ce roman prix Goncourt 1967. Sigismond déambule dans le quartier « des putes » de Barcelone, durant quarante huit heures, a une relation avec l’une d’entre elles, entre dans les bars, restaurants, lieux de prostitution, qu’il nous décrit avec beaucoup de détails.
C’est dans la tête de Sigismond Pons que se passe presque toute l’action de ce roman prix Goncourt 1967. Sigismond déambule dans le quartier « des putes » de Barcelone, durant quarante huit heures, a une relation avec l’une d’entre elles, entre dans les bars, restaurants, lieux de prostitution, qu’il nous décrit avec beaucoup de détails.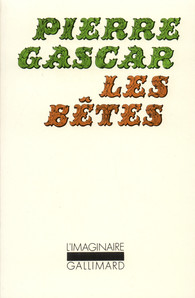 Le Goncourt 1953 n’est pas un roman mais un recueil de six histoires qui ont pour point commun des relations entre hommes et animaux. Le propos est explicite dans les toutes dernières pages du livre : « A chaque instant la bête peut changer : nous sommes à la lisière. Il y le cheval dément, le mouton rage, le rat savant, l’ours impavide, sortes d’états seconds qui nous ouvrent l’enfer animal et où nous retrouvons, dans l’étonnement de la fraternité, notre propre face tourmentée, comme dans un miroir griffu ».
Le Goncourt 1953 n’est pas un roman mais un recueil de six histoires qui ont pour point commun des relations entre hommes et animaux. Le propos est explicite dans les toutes dernières pages du livre : « A chaque instant la bête peut changer : nous sommes à la lisière. Il y le cheval dément, le mouton rage, le rat savant, l’ours impavide, sortes d’états seconds qui nous ouvrent l’enfer animal et où nous retrouvons, dans l’étonnement de la fraternité, notre propre face tourmentée, comme dans un miroir griffu ».