 C’est une exposition de tout premier ordre que propose le Centre Pompidou jusqu’au 14 janvier prochain, tant la sélection est variée par les artistes représentés, passionnante par ses thèmes et homogène dans sa qualité.
C’est une exposition de tout premier ordre que propose le Centre Pompidou jusqu’au 14 janvier prochain, tant la sélection est variée par les artistes représentés, passionnante par ses thèmes et homogène dans sa qualité.
Trois cents photos organisées en cinq sections que l’on découvre l’intérêt toujours en éveil et le regard émerveillé.
Voici Paris est la présentation d’une partie de l’exceptionnelle collection de Christian Bouqueret, riche de quelques 7000 photos – des tirages originaux pour l’essentiel – que le Centre Pompidou a acquise en 2011.
Embrassant l’une des périodes les plus fructueuses de la photographie, elle témoigne de la vitalité de cet art pendant l’entre-deux-guerres à Paris, où les grands photographes français tels que Henri-Cartier Bresson ou Claude Cahun étaient rejoints par leurs collègues étrangers, américains (Man Ray), allemands (Germaine Krull, Erwin Blumenfeld), hongrois (Kertész, Brassaï)…
Parmi les sections les plus impressionnantes, celle consacrée au surréalisme : Man Ray et Dora Maar bien sûr mais aussi Lotar et Blumenfeld multiplient les expérimentations et le jeu. Les corps sont déformés, des parties en sont découpées et remontées en d’étranges collages ; tout est vu avec un œil décalé, cherchant la surprise, repoussant les limites, et suscitant chez le spectateur choc ou amusement.
Très créatif aussi est le mouvement Nouvelle vision qui se développe à Paris dans les années 1920 : il s’agit d’aborder la photographie sans plus aucune référence à la tradition picturale, et en choisissant les sujets les plus contemporains qui soient, notamment l’architecture de fer ou de béton. Les prises de vues sont novatrices, très graphiques, les cadrages chamboulés par plongées et contre-plongées.
 La section dédiée à la photo documentaire rappelle l’importance de la démarche de tous ceux qui se sont attachés, à partir des an nées 1930, à montrer la réalité sociale, notamment dans le contexte de crise, avec les travailleurs (par exemple, Sortant des mines d’Aurel Bauh), mais aussi les moments de loisirs, avec l’avènement des congés payés – on rencontre ici fort naturellement Henri-Cartier Bresson.
La section dédiée à la photo documentaire rappelle l’importance de la démarche de tous ceux qui se sont attachés, à partir des an nées 1930, à montrer la réalité sociale, notamment dans le contexte de crise, avec les travailleurs (par exemple, Sortant des mines d’Aurel Bauh), mais aussi les moments de loisirs, avec l’avènement des congés payés – on rencontre ici fort naturellement Henri-Cartier Bresson.
L’imagier moderne regorge de découvertes : ici sont montrés le travail préparatoire et le résultat final de photographes œuvrant dans le monde de l’édition et de la publicité. C’était alors le plein essor de la presse illustrée, mais l’on plaçait aussi des photographies en couvertures de romans, de pochettes de disques… c’était classe et léché, parfois somptueux (voir la publicité pour Poiret de Germaine Krull).
Enfin, une tendance souvent moins valorisée : celle du retour à l’ordre dans les années 1920-30, en réaction contre les excès du modernisme. Autrement dit, l’âge Néo-classique de la photo, avec des nus, des natures mortes, des portraits. Mais le résultat, loin d’être ennuyeux (sauf peut-être pour certains portraits) est le plus souvent superbe, comme l’émouvant Masque de pierre d’André Steiner.
Voici Paris, Modernités photographiques 1920-1950
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 75004 Paris
Tous les jours sauf le mardi, 11h-21h
Entrée 11 € (tarif réduit : 9€)
Jusqu’au 14 janvier 2013
Images :
Germaine Krull, Publicité pour P. Poiret, 1926 © Mnam, Centre Pompidou, Paris, 2011
Marianne Breslauer, La Rotonde, 1930 © Marianne Breslauer / Fotostiftung Schweiz
 La galerie Frédéric Moisan, rue Mazarine à Paris, a ouvert ses portes début 2007 avec l’exposition de Bernard Guillot
La galerie Frédéric Moisan, rue Mazarine à Paris, a ouvert ses portes début 2007 avec l’exposition de Bernard Guillot 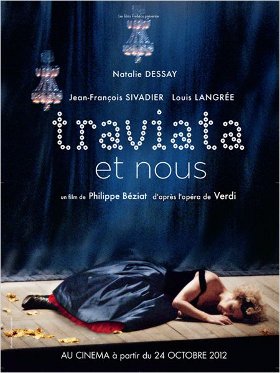 Comment met-on en scène un opéra ? Comment créer encore, à partir d’un opéra aussi célèbre, aussi joué que La Traviata de Verdi ? C’est un peu la situation d’un metteur en scène face à une pièce de Molière… Mais en pire : ici, il doit compter non seulement avec le livret, mais encore avec la musique, et tout ce qu’elle est censée exprimer. Et il s’appuie sur des acteurs qui sont des chanteurs avant d’être des comédiens…
Comment met-on en scène un opéra ? Comment créer encore, à partir d’un opéra aussi célèbre, aussi joué que La Traviata de Verdi ? C’est un peu la situation d’un metteur en scène face à une pièce de Molière… Mais en pire : ici, il doit compter non seulement avec le livret, mais encore avec la musique, et tout ce qu’elle est censée exprimer. Et il s’appuie sur des acteurs qui sont des chanteurs avant d’être des comédiens… En une petite centaine d’œuvres, dont plus de la moitié de tableaux, l’exposition du Louvre se concentre sur les dernière partie de la riche carrière de Raphaël (1483-1520), de 1513 à sa mort.
En une petite centaine d’œuvres, dont plus de la moitié de tableaux, l’exposition du Louvre se concentre sur les dernière partie de la riche carrière de Raphaël (1483-1520), de 1513 à sa mort. C’est d’ailleurs dans ces deux sections, l’une consacrée aux Vierges et l’autre aux portraits que l’on retrouve les œuvres à la fois les plus belles et les plus touchantes de Raphaël : la Madone à la rose du Prado (partenaire de l’exposition) et surtout l’inoubliable Madone de l’Amour divin du musée Capodimonte à Naples. Outre leur perfection esthétique, ces tableaux véhiculent, à travers l’expression des visages, les mouvements des corps et les couleurs, d’immenses sentiments de tendresse.
C’est d’ailleurs dans ces deux sections, l’une consacrée aux Vierges et l’autre aux portraits que l’on retrouve les œuvres à la fois les plus belles et les plus touchantes de Raphaël : la Madone à la rose du Prado (partenaire de l’exposition) et surtout l’inoubliable Madone de l’Amour divin du musée Capodimonte à Naples. Outre leur perfection esthétique, ces tableaux véhiculent, à travers l’expression des visages, les mouvements des corps et les couleurs, d’immenses sentiments de tendresse.

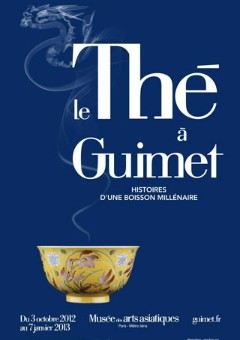 Présentée au musée Guimet, Le thé, histoires d’une boisson millénaire est la première exposition consacrée en France à l’histoire du thé.
Présentée au musée Guimet, Le thé, histoires d’une boisson millénaire est la première exposition consacrée en France à l’histoire du thé. Quoi de plus naturel qu’une exposition exclusivement consacrée à Chaïm Soutine (1893-1943) au Musée de l’Orangerie à Paris, où est conservée la plus grande collection d’Europe du célèbre peintre Russe, soit 22 tableaux réunis par le marchand d’art Paul Guillaume ?
Quoi de plus naturel qu’une exposition exclusivement consacrée à Chaïm Soutine (1893-1943) au Musée de l’Orangerie à Paris, où est conservée la plus grande collection d’Europe du célèbre peintre Russe, soit 22 tableaux réunis par le marchand d’art Paul Guillaume ? Né dans la misère, rongé par l’angoisse toute sa vie, Chaïm Soutine fut l’auteur d’une peinture certes tourmentée et souvent incomprise, mais qui assurément trouva tôt son public.
Né dans la misère, rongé par l’angoisse toute sa vie, Chaïm Soutine fut l’auteur d’une peinture certes tourmentée et souvent incomprise, mais qui assurément trouva tôt son public. La Pinacothèque de Paris propose jusqu’au 17 mars 2013 deux expositions en parallèle : l’une consacrée à Vincent van Gogh (1853-1890) et l’autre à Hiroshige (1786 -1864). La première présente une trentaine de tableaux du peintre hollandais en s’attachant à montrer l’influence du japonisme dans son oeuvre. La seconde – inédite à Paris, où aucune exposition dédiée à ce maître de l’estampe japonaise n’avait jamais été organisée – expose quelques deux cents œuvres prêtées par le musée de Leyde aux Pays-Bas.
La Pinacothèque de Paris propose jusqu’au 17 mars 2013 deux expositions en parallèle : l’une consacrée à Vincent van Gogh (1853-1890) et l’autre à Hiroshige (1786 -1864). La première présente une trentaine de tableaux du peintre hollandais en s’attachant à montrer l’influence du japonisme dans son oeuvre. La seconde – inédite à Paris, où aucune exposition dédiée à ce maître de l’estampe japonaise n’avait jamais été organisée – expose quelques deux cents œuvres prêtées par le musée de Leyde aux Pays-Bas. Une sérénité que l’on retrouve en poursuivant avec l’exposition consacrée à Hiroshige, intitulée L’art du voyage. Après la scénographie chatoyante du premier parcours, ici l’ambiance est plus sobre – les estampes souffriraient irrémédiablement d’un excès de lumière – mais l’ensemble présenté est d’une très grande richesse.
Une sérénité que l’on retrouve en poursuivant avec l’exposition consacrée à Hiroshige, intitulée L’art du voyage. Après la scénographie chatoyante du premier parcours, ici l’ambiance est plus sobre – les estampes souffriraient irrémédiablement d’un excès de lumière – mais l’ensemble présenté est d’une très grande richesse. Guy Cogeval, le président du musée d’Orsay, aime faire vibrer les arts entre eux ; pour preuve, la partie dédiée aux arts décoratifs inaugurée l’an dernier (voir
Guy Cogeval, le président du musée d’Orsay, aime faire vibrer les arts entre eux ; pour preuve, la partie dédiée aux arts décoratifs inaugurée l’an dernier (voir  Ceci est une lecture de l’exposition : elle pourrait être la seule, on serait déjà ravi. Mais sa profonde originalité vient de ce qu’à la mode elle fait répondre les Impressionnistes, ces grands fous du XIXème qui se sont mis en tête de peindre l’air du temps, la vibration de la lumière, la sensation fugitive et l’émotion de l’instant… Scènes de la vie urbaine croquée sur le vif, attitudes naturelles et spontanées, ils renouvellent la scène de genre et le portrait. Ce faisant, ils rendent aux étoffes leurs mouvements, leurs reflets, leur transparence, qu’il s’agisse d’une modiste chez Degas, d’un costume masculin chez Caillebotte, d’une riche robe chez Renoir et d’une blanche mousseline chez Monet… tout cela vit, prend la lumière éclatante du soleil ou joue avec la fée électricité sous les lambris du soir et, en définitive, montre toute une société – huppée – dans son époque au quotidien.
Ceci est une lecture de l’exposition : elle pourrait être la seule, on serait déjà ravi. Mais sa profonde originalité vient de ce qu’à la mode elle fait répondre les Impressionnistes, ces grands fous du XIXème qui se sont mis en tête de peindre l’air du temps, la vibration de la lumière, la sensation fugitive et l’émotion de l’instant… Scènes de la vie urbaine croquée sur le vif, attitudes naturelles et spontanées, ils renouvellent la scène de genre et le portrait. Ce faisant, ils rendent aux étoffes leurs mouvements, leurs reflets, leur transparence, qu’il s’agisse d’une modiste chez Degas, d’un costume masculin chez Caillebotte, d’une riche robe chez Renoir et d’une blanche mousseline chez Monet… tout cela vit, prend la lumière éclatante du soleil ou joue avec la fée électricité sous les lambris du soir et, en définitive, montre toute une société – huppée – dans son époque au quotidien.