 Sur le plateau du Jura, enneigé et isolé, un petit village ne compte plus que sur l’épicerie, l’église et la mairie pour survivre.
Sur le plateau du Jura, enneigé et isolé, un petit village ne compte plus que sur l’épicerie, l’église et la mairie pour survivre.
Le curé et le maire : les voici réunis autour de la table pour résoudre une cruciale question : trouver quelqu’un pour reprendre l’épicerie.
C’est ce moment que Rosa, jeune fille fraîchement sortie de prison, choisit pour demander de l’aide et du travail à son visiteur de prison, qui n’est autre que Jean-François, notre curé de campagne… La nouvelle épicière semble toute trouvée.
Il faut ajouter que Rosa en pince un peu pour Jean-François, qu’elle prenait pour une homme tout à fait « civil », que le petit sacristain, de son côté, en pince pour Rosa et que la bonne du curé, Jeanine, n’est pas indifférente au plumage et au ramage du maire-instituteur qui, évidemment, le lui rend plutôt bien.
Pièce bien écrite et mise en scène avec ressort, Chacun sa croix a tous les atouts pour divertir et amuser efficacement le spectateur.
Côté distribution, rien à redire si ce n’est une mention spéciale à Carole Massana (Jeanine), comédienne singulière et passionnante, dotée d’un physique, d’une force et d’un talent comique exceptionnels, et à Julien Cafaro, qui fait des merveilles dans le rôle du maire-instituteur mou et indécis, malmené par un curé, lui, tout à fait énergique.
Mais la fin de la pièce verra la situation basculer en quelque sorte, quand le maire-instituteur nouvellement fiancé à Jeanine va se trouver tout ragaillardi alors que le prêtre, troublé, résiste aux charmes de l’ex-taularde avec un peu moins de détermination…
Chacun sa croix !
Comédie Bastille
Une pièce de Jean-Christophe Barc
Mise en scène : Thierry Lavat
Avec : Julien Cafaro, Didier Constant, Manon Rony, Carole Massana, Erwan Creignou
Du mardi au samedi à 21h30, matinées samedi et dimanche à 17h
Prix des places : 26 euros
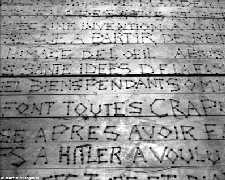 Si l’histoire est désormais connue, elle mérite d’être racontée une nouvelle fois et surtout montrée.
Si l’histoire est désormais connue, elle mérite d’être racontée une nouvelle fois et surtout montrée. Ils sont des adolescents et de jeunes adultes aux cheveux mi-longs ; parfois souriants, beaux souvent.
Ils sont des adolescents et de jeunes adultes aux cheveux mi-longs ; parfois souriants, beaux souvent. Martine Barrat a quitté Paris pour New-York en 1968. Ce sont les quartiers pauvres de Harlem et de South Bronx, où elle s’est investie pendant des années, qu’elle a choisi de photographier.
Martine Barrat a quitté Paris pour New-York en 1968. Ce sont les quartiers pauvres de Harlem et de South Bronx, où elle s’est investie pendant des années, qu’elle a choisi de photographier.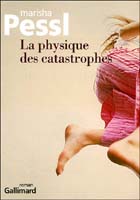 Bleue van Meer a seize ans. Sa mère, qui ne parvenait à attraper que les papillons les plus rares, est morte dans un accident alors que Bleue était toute petite.
Bleue van Meer a seize ans. Sa mère, qui ne parvenait à attraper que les papillons les plus rares, est morte dans un accident alors que Bleue était toute petite. Dès l’entrée, on sent qu’on va avoir le champ libre.
Dès l’entrée, on sent qu’on va avoir le champ libre. Le mot "tapisseries" évoque aujourd’hui pour beaucoup des vieilleries aux couleurs fanées et aux motifs historiques un peu assommants.
Le mot "tapisseries" évoque aujourd’hui pour beaucoup des vieilleries aux couleurs fanées et aux motifs historiques un peu assommants. La manufacture des Gobelins a été créée sous le règne d’Henri IV en 1601.
La manufacture des Gobelins a été créée sous le règne d’Henri IV en 1601.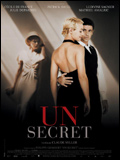 Il y a le corps aux rondeurs sculptées par la natation de Cécile de France et le corps large tout en muscles de Patrick Bruel.
Il y a le corps aux rondeurs sculptées par la natation de Cécile de France et le corps large tout en muscles de Patrick Bruel.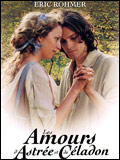 Nous sommes dans la verte et pastorale Gaule du V° siècle. L’histoire nous est contée par Honoré Urfé, écrivain du XVIIème siècle totalement oublié.
Nous sommes dans la verte et pastorale Gaule du V° siècle. L’histoire nous est contée par Honoré Urfé, écrivain du XVIIème siècle totalement oublié.