 L’exposition présentée au Grand Palais jusqu’au 13 juillet (que ceux qui n’y sont pas encore allés se dépêchent !) est une grande réussite. Elle est co-organisée avec le Musée du Louvre – le commissariat est assuré par Guillaume Kientz, l’un de ses conservateurs – et cela se voit : clarté du propos, intelligence du parcours, sobriété de la scénographie. Les institutions françaises ont été appuyées par de grands musées internationaux (le Kunsthistorisches Museum de Vienne et le Prado de Madrid), ce qui se traduit par un parcours particulièrement riche, où les chefs-d’œuvres de Velàsquez côtoient des peintures mais aussi des sculptures de certains de ses contemporains, dans une approche comparative toujours très instructive. Plein de raisons d’y aller !
L’exposition présentée au Grand Palais jusqu’au 13 juillet (que ceux qui n’y sont pas encore allés se dépêchent !) est une grande réussite. Elle est co-organisée avec le Musée du Louvre – le commissariat est assuré par Guillaume Kientz, l’un de ses conservateurs – et cela se voit : clarté du propos, intelligence du parcours, sobriété de la scénographie. Les institutions françaises ont été appuyées par de grands musées internationaux (le Kunsthistorisches Museum de Vienne et le Prado de Madrid), ce qui se traduit par un parcours particulièrement riche, où les chefs-d’œuvres de Velàsquez côtoient des peintures mais aussi des sculptures de certains de ses contemporains, dans une approche comparative toujours très instructive. Plein de raisons d’y aller !
1. Il s’agit de la première rétrospective consacrée à Diego Velàsquez (1599-1660) jamais organisée en France. D’ailleurs, le Louvre ne possède pas une seule toile de l’auteur des Ménines… A leur sujet, précisons d’emblée qu’étant intransportables, elles sont restées au chaud à Madrid. C’est dommage évidemment, mais ce n’est pas si grave : pour cette exposition historique, le Grand Palais et le Louvre ont fait le plein. La variété des musées ayant prêté des œuvres (y compris français, tout de même !), en plus du Prado, est impressionnante.
2. Velàsquez – contemporain de Van Dyck et du Bernin – est LE grand maître du Siècle d’or espagnol, surdoué qui a commencé très jeune dans sa ville natale de Séville et qui, dès 1623 est entré à la cour du roi Philippe IV à Madrid où il connut un très grand succès, s’épanouissant toujours davantage au fil du temps.
3. Velàsquez marqua profondément l’histoire de la peinture, en particulier par sa façon audacieuse d’exécuter les portraits. Pour n’en citer que trois dans la période récente, Manet au XIX°, Picasso et Bacon au XX° étudièrent ses œuvres et s’en imprégnèrent en profondeur, au point de livrer à leur tour des réinterprétations de sa manière et/ou des sujets de ses tableaux.
4. Le parcours chronologique – mais solidement pensé autour d’axes thématiques – montre que le maître espagnol excellait dans tous les genres : natures mortes, peinture religieuse, scène de genre, peinture d’histoire, et bien sûr portraits. Peintre efficace, il n’a pourtant, tout au long de sa brillante carrière, réalisé qu’une centaine de tableaux.
5. Mais s’il n’y a qu’une chose à retenir de l’œuvre de Diego Velàsquez, et qui fait sa force, traversant ses toiles de tous genres et de toutes époques, c’est le rendu de l’expression des visages.
On le voit tout de suite avec son Immaculée Conception de 1618-19 (celle de la National Gallery), dont les traits, tout humains, empreints d’une douceur méditative, ne pouvaient que toucher les fidèles. Plus loin, ce sont Saint Antoine abbé et Saint Paul Ermite (1633-34, Prado) qui, dans un paysage grandiose, ne peuvent qu’inspirer la piété. Et que dire de Saint Pierre pénitent (1623), tableau dans lequel on retrouve la simplicité et l’économie de moyens propres au style de Velàsquez, mises au service de l’expression du sentiment, qui jaillit de son visage et de ses yeux tournés vers le ciel d’une façon très émouvante.
 D’ailleurs, les tableaux de cour et officiels sont frappants « d’authenticité » : on a l’impression de voir des personnes incarnées, c’est-à-dire dotées d’un caractère propre (celui du Pape Innocent X n’a pas l’air facile) et d’attributs physiques pris comme tels, même s’ils ne sont pas toujours très flatteurs. A commencer par le roi Philippe IV soi-même, qui n’était pas exactement un « canon ». On est loin de l’idéalisation. Si Velàsquez rend bien la richesse des vêtements des puissants, on sent que là n’est pas sa préoccupation principale : ceux-ci sont davantage montrés dans leur volume que dans leurs détails, qui ne sont pas léchés comme chez les Nordiques. Lui préférait concentrer ses soins sur les visages et les regards. D’où cette impression frappante d’être happé par chaque tableau.
D’ailleurs, les tableaux de cour et officiels sont frappants « d’authenticité » : on a l’impression de voir des personnes incarnées, c’est-à-dire dotées d’un caractère propre (celui du Pape Innocent X n’a pas l’air facile) et d’attributs physiques pris comme tels, même s’ils ne sont pas toujours très flatteurs. A commencer par le roi Philippe IV soi-même, qui n’était pas exactement un « canon ». On est loin de l’idéalisation. Si Velàsquez rend bien la richesse des vêtements des puissants, on sent que là n’est pas sa préoccupation principale : ceux-ci sont davantage montrés dans leur volume que dans leurs détails, qui ne sont pas léchés comme chez les Nordiques. Lui préférait concentrer ses soins sur les visages et les regards. D’où cette impression frappante d’être happé par chaque tableau.
Avant les portraits de cour, naturellement posés, ses œuvres montraient souvent des sujets pris à un moment de surprise, d’étonnement, d’interrogation. Chez ses personnages, on sent qu’il y a un avant et un après le moment précis et fort que Velàsquez a saisi. Sa Mulata (1617-18), appuyée au rebord de la table de sa main droite, sa gauche tenant encore une cruche, semble en arrêt devant quelque chose qu’elle vient d’entendre ou de voir, extérieurement ou intérieurement (qui est peut-être liée à la scène du repas à Emmaüs peinte au fond de l’une des versions du tableau). Saint-Thomas (1619-20, Orléans), est lui aussi interpellé, de profil et penché vers l’avant (vers quoi ?), un livre et une lance à la main. Avec La forge de Vulcain (1630, Prado), cet étonnement atteint son paroxysme : à voir l’expression pétrifiée de Vulcain et de ses assistants, on croirait entendre Apollon annoncer à Vulcain l’infidélité de son épouse. Quant à la Venus au miroir (1647-51, National Gallery), autre chef d’œuvre, judicieusement présenté au cœur du parcours, outre sa beauté, elle recèle un insondable mystère : vers où se porte le regard de Venus dans le reflet du miroir ? Vers elle-même, vers nous-mêmes spectateurs ?…
Velàsquez
Galeries Nationales du Grand Palais
Jusqu’au 13 juillet 2015
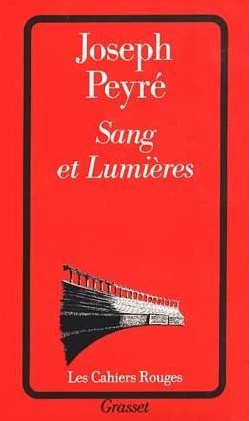
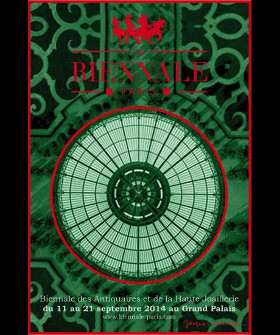
 Magnifique exposition à la Fondation La Caixa à Madrid, qui, autour d’une sélection de cent-quatre-vingt oeuvres issues de la collection du futur Musée de l’Aga Khan de Toronto, embrasse l’art des différentes dynasties historiques du monde islamique.
Magnifique exposition à la Fondation La Caixa à Madrid, qui, autour d’une sélection de cent-quatre-vingt oeuvres issues de la collection du futur Musée de l’Aga Khan de Toronto, embrasse l’art des différentes dynasties historiques du monde islamique. Comment clôturer cette série de billets dédiés à au festival
Comment clôturer cette série de billets dédiés à au festival  Festival de photographie et d’arts visuels réunissant grands noms et jeunes découvertes, PHotoEspaña célèbre cette année sa 12ème édition.
Festival de photographie et d’arts visuels réunissant grands noms et jeunes découvertes, PHotoEspaña célèbre cette année sa 12ème édition. On pourra également parcourir jusqu’au 6 septembre Vida de una fotógrafa 1990-2005 d’Annie Leibovitz à la Communidad de Madrid, rétrospective de près de 200 photos que les Parisiens ont eu l’occasion de voir à la Maison européenne de la photographie l’été dernier (
On pourra également parcourir jusqu’au 6 septembre Vida de una fotógrafa 1990-2005 d’Annie Leibovitz à la Communidad de Madrid, rétrospective de près de 200 photos que les Parisiens ont eu l’occasion de voir à la Maison européenne de la photographie l’été dernier (