 « Mademoiselle Albertine est partie ! ».
« Mademoiselle Albertine est partie ! ».
C’est sur ces mots de Françoise, la servante du narrateur, que s’ouvre La fugitive, l’avant-dernier tome de A la recherche du temps perdu.
Or, le narrateur, s’il avait envisagé bien des fois de rompre lui-même, sans jamais mettre son projet à exécution, n’aurait jamais imaginé qu’Albertine eût pu le quitter.
Le choc est des plus vifs, car « Pour se représenter une situation inconnue, l’imagination emprunte des éléments connus et, à cause de cela, ne se la représente pas. »
La douleur, immense rappelle les angoisses les plus profondes et les plus anciennes :
Que le désir de Venise était loin de moi maintenant ! Comme autrefois à Combray, celui de connaître Mme de Guermantes, quand venait l’heure où je ne tenais plus qu’à une seule chose, avoir maman dans ma chambre. Et c’était bien en effet toutes les inquiétudes éprouvées depuis mon enfance qui, à l’appel de l’angoisse nouvelle, avaient accouru la renforcer, s’amalgamer à elle en une masse homogène qui m’étouffait.
Résolu à faire revenir Albertine au plus vite, le narrateur décide de lui écrire une lettre feignant l’indifférence, à savoir une lettre d’adieux, tout en envoyant en parallèle en Tourraine son ami Robert de Saint-Loup faire pression sur Mme Bontemps, afin qu’elle lui renvoie son amie au plus vite.
Cette stratégie échouera. Il aurait pu, pourtant, prévoir son insuccès puisque des lettres semblablement hypocrites écrites en son temps à Gilberte n’avaient fait qu’achever le dénouement de leur lien :
Et cette expérience aurait dû m’empêcher d’écrire à Albertine des lettres du même caractère que celles que j’avais écrites à Gilberte. Mais ce qu’on appelle expérience n’est que la révélation à nos propres yeux d’un trait de notre caractère, qui naturellement reparaît (…) le mouvement spontané qui nous avait guidé la première fois se trouve renforcé par toutes les suggestions du souvenir.
Constatant la répétition de ses échecs, le narrateur a alors cette réflexion magnifique :
Le plagiat humain auquel il est le plus difficile d’échapper (…), c’est le plagiat de soi-même.
Belles lectures et beau bronzage à tous…
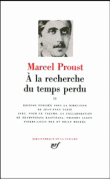 Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.
Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.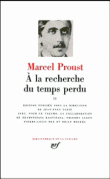 On sait à quel point le narrateur est attaché à sa grand’mère maternelle, qui est la délicatesse même.
On sait à quel point le narrateur est attaché à sa grand’mère maternelle, qui est la délicatesse même.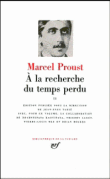 Place est aujourd’hui réservée à la demande de Sola sur « l’imagination » dans l’œuvre de Proust (commentaire du billet
Place est aujourd’hui réservée à la demande de Sola sur « l’imagination » dans l’œuvre de Proust (commentaire du billet 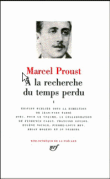 En novembre 1913, Marcel Proust publie à compte d’auteur le premier volume de la Recherche, Du côté de chez Swann.
En novembre 1913, Marcel Proust publie à compte d’auteur le premier volume de la Recherche, Du côté de chez Swann.