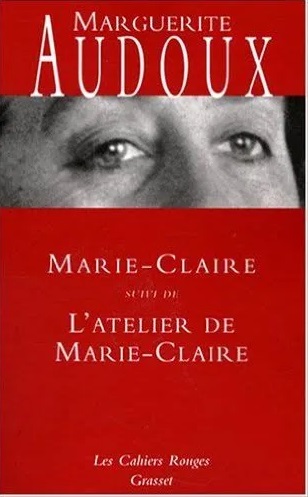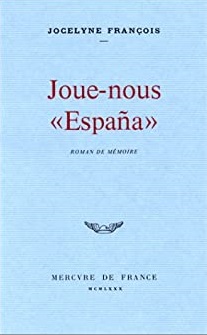
Le livre se présente comme un « roman de mémoire », parce qu’il est autobiographique, parce qu’il fait appel au souvenir d’événements d’enfance et de jeunesse, parce que la vie est souvent un roman. Toutefois la modestie domine l’écriture : « (…) ma propre histoire, par avancées successives, a gagné ce territoire étroit, sans nom, où je me trouve réduite et obligée à écrire ces choses du passé. Il s’agit pourtant d’une histoire sans aucune espèce d’importance mais je n’ai qu’elle ». La tonalité douce du roman, malgré la puissance des sentiments, la force des caractères, fait beaucoup pour nous rendre très touchant ce prix Fémina 1980.
La narratrice a eu du mal à trouver sa place au sein de sa famille, entre le frère Pierre mort et le frère Pierre vivant : « Je suis la fille au lieu du fils, celle qui n’a pas remplacé le petit mort, je suis donc violemment, radicalement autre ». Nous la devinons volontiers rebelle car elle est souvent punie par le mépris de la mère et le martinet du père. Elle aime la musique, et apprend le piano, mais déteste « España » de Chabrier, que lui réclament ses parents à toute occasion. Elle trouve ses bonheurs dans la campagne lorraine, chez ses grands-parents, où sa sensualité peut s’épanouir : « Chemise relevée, les jambes rouge sombre jusqu’à ma culotte bateau, je ne sais plus rien d’autre que le contact avec le raisin. Je me dis aujourd’hui que c’est ainsi que j’ai voulu vivre. Comme j’écrasais le raisin j’aime l’amour, comme j’écrasais le raisin je sens le dehors ».
Après la difficile période de l’Occupation elle s’adapte à la rigueur, faite aussi de bienveillance, de l’internat catholique où elle effectue ses études secondaires. L’ambition d’ascension sociale des parents l’a placée dans un établissement de bonne réputation, et surtout elle y trouve le sourire, l’exemplarité, et le respect que les religieuses portent aux élèves. Certes, elle essaie toujours de faire entendre sa voix, ne serait-ce que pour obtenir les livres a priori interdits. Mais dans un cadre apaisé, loin des tensions familiales.
Et surtout, en fin de scolarité, elle découvre l’amour avec Marie-Claire. C’est avec une grande délicatesse que Jocelyne François nous décrit les étapes qui la conduisent vers elle : l’amitié, l’amour, la sexualité. « Le lendemain c’est moi qui me lève et ce n’est pas moi. Ce vide aux contours brûlants qui s’est installé dans ma poitrine et qui respire à ma place, cette alerte de tout le corps, il me faut m’y ajuster et je ne sais pas »; « Tu y es. Je sais tout de suite. Tu m’embrasses à en mourir. Nous ne pouvons plus rester debout, nous nous couchons ».
Sa foi la pousse à se confier à l’aumônier des étudiants, lequel commet « tranquillement un crime » en lui conseillant d’abandonner cette relation. Nous sommes en 1952. Après des années, elle peut léguer à ses enfants « un trésor que les vers ne peuvent ravir : la volonté de ne jamais vous laisser déposséder de vous-mêmes puisqu’en vous est enfoui ce dont vous avez besoin ». Avant de tirer de trop hâtives conclusions, il faut lire ce beau roman de mémoire.
Andreossi
Joue-nous « España ». Jocelyne François