 Le Goncourt 2004 nous ramène dans les Pouilles, (comme Roger Vailland nous y avait conduit en 1957), avec l’histoire d’une famille qui se déploie sur un siècle. Le fondateur de la lignée des Scorta est plutôt de naissance modeste, né « d‘un père vaurien, assassiné deux heures après son étreinte, et d’une vieille fille qui s’ouvrait à un homme pour la première fois ». Ses descendants ne feront jamais fortune, mais apprendront quelques saveurs que la vie peut apporter, surtout si le soleil d’Italie y met du sien.
Le Goncourt 2004 nous ramène dans les Pouilles, (comme Roger Vailland nous y avait conduit en 1957), avec l’histoire d’une famille qui se déploie sur un siècle. Le fondateur de la lignée des Scorta est plutôt de naissance modeste, né « d‘un père vaurien, assassiné deux heures après son étreinte, et d’une vieille fille qui s’ouvrait à un homme pour la première fois ». Ses descendants ne feront jamais fortune, mais apprendront quelques saveurs que la vie peut apporter, surtout si le soleil d’Italie y met du sien.
Rocco, devenu plus brigand encore que son père, épouse la Muette dont il a trois enfants, deux garçons et une fille, Carmela qui nous laisse, à la fin de sa vie et à chaque fin de chapitre, quelques confidences. C’est elle qui a l’énergie pour guider la fratrie après une aventure newyorkaise ratée, qui a l’idée d’ouvrir un Tabac dans leur village de Montepuccio, et qui sait donner l’élan nécessaire pour se relancer après les malheurs.
Cette fratrie n’est pas qu’unie par les liens du sang, car elle compte aussi Rafaele, gamin du village qui s’est attaché aux Scorta : quatrième « frère », il doit faire le deuil de son amour d’une autre nature pour Carmela. La malédiction de l’origine joue son rôle, orientée par les personnalités des curés qui se succèdent au village, de manière parfois néfaste, ou au contraire salutaire.
La narration est limpide et sait nous faire voir : « Le trabucco remonte ses filets avec lenteur et majesté tel un grand homme maigre qui plonge les mains dans l’eau et les remonte lentement comme s’il portait les trésors de la mer ». De belles scènes nous évoquent la chaleur du sud italien et celle qui émane de l’union de ces frères et sœur.
Au centre du roman, la fête que donne Rafaele pour les siens sur son trabucco fait figure de seconde fondation familiale : « Nous sommes nés du soleil, Elia. Sa chaleur, nous l’avons en nous. D’aussi loin que nos corps se souviennent, il était là, réchauffant nos peaux de nourrissons. Et nous ne cessons de le manger, de le croquer à pleines dents. Il est là, dans les fruits que nous mangeons. Les pêches. Les olives. Les oranges. C’est son parfum. Avec l’huile que nous buvons, il coule dans nos gorges. Il est en nous. Nous sommes les mangeurs de soleil ».
Et au moment d’évoquer son plus beau souvenir devant son frère, Giuseppe n’hésite pas : « Il y avait du risotto aux fruits de mer qui fondait dans la bouche. Ta Giuseppina portait une robe bleu ciel. Elle était belle comme un cœur et s’activait de la table à la cuisine, sans cesse. Je me souviens de toi, au four, suant comme un travailleur à la mine. Et le bruit des poissons qui sifflaient sur le gril. Tu vois. Après une vie entière, c’est le souvenir le plus beau de tous. Est-ce que cela ne fait pas de moi le plus misérable des hommes ? » Le lecteur aura répondu.
Andreossi
Le soleil des Scorta Laurent Gaudé
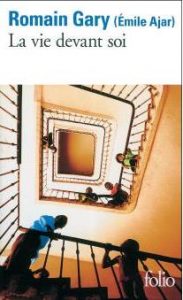 Phénomène unique dans l’histoire du prix Goncourt, Romain Gary, après
Phénomène unique dans l’histoire du prix Goncourt, Romain Gary, après 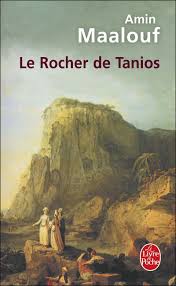 « En ce temps-là, le ciel était si bas qu’aucun homme n’osait se dresser de toute sa taille. Cependant, il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l’on n’attendait jamais le meilleur en ce monde, on espérait chaque jour échapper au pire ». C’est du Liban dont nous parle le Goncourt 1993 d’Amin Maalouf, pour nous conter l’histoire d’une disparition, celle du légendaire Tanios. Avant la disparition mystérieuse, une vie est reconstituée, dans une langue que l’on suivrait sur tous les chemins de l’imaginaire historique.
« En ce temps-là, le ciel était si bas qu’aucun homme n’osait se dresser de toute sa taille. Cependant, il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l’on n’attendait jamais le meilleur en ce monde, on espérait chaque jour échapper au pire ». C’est du Liban dont nous parle le Goncourt 1993 d’Amin Maalouf, pour nous conter l’histoire d’une disparition, celle du légendaire Tanios. Avant la disparition mystérieuse, une vie est reconstituée, dans une langue que l’on suivrait sur tous les chemins de l’imaginaire historique. La dernière représentation de la saison au Théâtre du Rond-Point a été jouée dimanche 12 mars, mais le spectacle part ensuite en tournée en province, avant de revenir à Paris au Théâtre Monfort.
La dernière représentation de la saison au Théâtre du Rond-Point a été jouée dimanche 12 mars, mais le spectacle part ensuite en tournée en province, avant de revenir à Paris au Théâtre Monfort.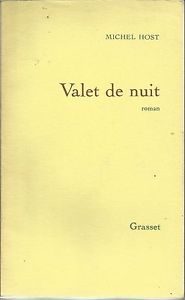 Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.
Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.
 Commençons par celle-ci, la musique. Sous la direction posée et sûre d’Emmanuelle Haïm, sa formation resserré, dont l’osmose avec son chef est palpable, joue une interprétation sobre : le travail de Mme Haïm offre à la délicatesse de la musique baroque un écrin de calme et de raffinement dont rien ne semble dépasser.
Commençons par celle-ci, la musique. Sous la direction posée et sûre d’Emmanuelle Haïm, sa formation resserré, dont l’osmose avec son chef est palpable, joue une interprétation sobre : le travail de Mme Haïm offre à la délicatesse de la musique baroque un écrin de calme et de raffinement dont rien ne semble dépasser. Le reste de la distribution émerveille tant vocalement que scéniquement. Citons d’abord Magdalena Kožená dont la Pénélope est au-dessus même de ce qu’on attend, tant elle restitue la tristesse et la dignité, puis l’alternance de la détermination et du doute, avant que, in fine, l’allégresse des retrouvailles chasse de ses traits et de sa voix les vingt années d’attente écoulées. Puis l’Eumée, le fidèle berger d’Ulysse, de Kresimir Spicer, dont le chant doux et mélodieux n’a d’égal que la justesse du geste. Jörg Schneider est également parfait dans le rôle de son opposé, Irus, bouffon des Prétendants, au-delà du ventru : si dans la première partie il brille par ses talents comiques conformément au rôle, mais aussi par sa voix à la puissance rugissante, celle-ci s’exprime dans de beaux aigus dans le solo de la seconde partie où il pleure, avec la mort des Prétendants, le retour de la faim. Parmi les Prétendants justement, tous très bien, c’est surtout Maarten Engeltjes en Pissandre que l’on a envie de mentionner, tant sa voix de contre-ténor est rafraîchissante et rend l’ensemble plus savoureux encore. Enfin, l’un des plus grands bonheurs de la soirée vient d’Anne-Catherine Gillet, qui campe Minerve / Amour de sa voix cristalline, pleine d’aisance et colorée, et offre une interprétation scénique fort remarquée, tant elle pétille et surprend.
Le reste de la distribution émerveille tant vocalement que scéniquement. Citons d’abord Magdalena Kožená dont la Pénélope est au-dessus même de ce qu’on attend, tant elle restitue la tristesse et la dignité, puis l’alternance de la détermination et du doute, avant que, in fine, l’allégresse des retrouvailles chasse de ses traits et de sa voix les vingt années d’attente écoulées. Puis l’Eumée, le fidèle berger d’Ulysse, de Kresimir Spicer, dont le chant doux et mélodieux n’a d’égal que la justesse du geste. Jörg Schneider est également parfait dans le rôle de son opposé, Irus, bouffon des Prétendants, au-delà du ventru : si dans la première partie il brille par ses talents comiques conformément au rôle, mais aussi par sa voix à la puissance rugissante, celle-ci s’exprime dans de beaux aigus dans le solo de la seconde partie où il pleure, avec la mort des Prétendants, le retour de la faim. Parmi les Prétendants justement, tous très bien, c’est surtout Maarten Engeltjes en Pissandre que l’on a envie de mentionner, tant sa voix de contre-ténor est rafraîchissante et rend l’ensemble plus savoureux encore. Enfin, l’un des plus grands bonheurs de la soirée vient d’Anne-Catherine Gillet, qui campe Minerve / Amour de sa voix cristalline, pleine d’aisance et colorée, et offre une interprétation scénique fort remarquée, tant elle pétille et surprend. Voilà pour le geste, voilà pour la voix, voici pour la mise en scène : Mariame Clément mixe les codes et les époques autour de grands décors qui mettent bien en place l’essentiel de l’intrigue et de détails qui viennent la titiller avec humour. On pourrait résumer ainsi : du classique de bon goût réveillé par des surgissements plus pop art – et donc moins consensuels – mais le tout suivant une veine très poétique. Idée inventive et judicieuse : l’Olympe est bien surélevé, mais… n’est autre qu’un troquet où dieux et déesses occupent leur désœuvrement et observent les mortels dont ils font du destin leur joujou en picolant et en jouant aux fléchettes. On est bien loin de l’Olympe de nos imaginaires ! Mais l’ensemble fonctionne fort bien, et l’on s’enchante de ce mariage parfait du chant, de la musique baroque et d’un théâtre plein de merveilleux.
Voilà pour le geste, voilà pour la voix, voici pour la mise en scène : Mariame Clément mixe les codes et les époques autour de grands décors qui mettent bien en place l’essentiel de l’intrigue et de détails qui viennent la titiller avec humour. On pourrait résumer ainsi : du classique de bon goût réveillé par des surgissements plus pop art – et donc moins consensuels – mais le tout suivant une veine très poétique. Idée inventive et judicieuse : l’Olympe est bien surélevé, mais… n’est autre qu’un troquet où dieux et déesses occupent leur désœuvrement et observent les mortels dont ils font du destin leur joujou en picolant et en jouant aux fléchettes. On est bien loin de l’Olympe de nos imaginaires ! Mais l’ensemble fonctionne fort bien, et l’on s’enchante de ce mariage parfait du chant, de la musique baroque et d’un théâtre plein de merveilleux. Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur !
Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur ! L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt…
L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt… Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille.
Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille. L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.
L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle. Ils s’aiment. Elle lui annonce qu’elle attend un enfant. Il sourit. Il achète un terrain pour construire une maison près de sa famille à elle, et quand il le lui montre, là, en plein champ, il la demande en mariage.
Ils s’aiment. Elle lui annonce qu’elle attend un enfant. Il sourit. Il achète un terrain pour construire une maison près de sa famille à elle, et quand il le lui montre, là, en plein champ, il la demande en mariage.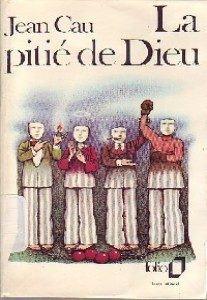 Retour à la littérature cette semaine, avec le prix Goncourt 1961 : assez difficile « à vendre », il faut le reconnaître ! L’occasion une fois de plus de redécouvrir avec le recul des années les choix du célèbre jury… et de prendre du recul par rapport à ceux-ci ! Bonne lecture quand même !
Retour à la littérature cette semaine, avec le prix Goncourt 1961 : assez difficile « à vendre », il faut le reconnaître ! L’occasion une fois de plus de redécouvrir avec le recul des années les choix du célèbre jury… et de prendre du recul par rapport à ceux-ci ! Bonne lecture quand même !  Les mots manquent pour rendre compte de l’émotion éprouvée lors du magnifique concert de Christophe à la salle Pleyel vendredi dernier, ultime étape parisienne avant la reprise de sa tournée Les vestiges du Chaos, du nom de son très réussi dernier album.
Les mots manquent pour rendre compte de l’émotion éprouvée lors du magnifique concert de Christophe à la salle Pleyel vendredi dernier, ultime étape parisienne avant la reprise de sa tournée Les vestiges du Chaos, du nom de son très réussi dernier album.