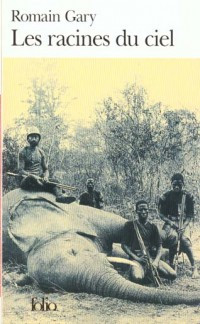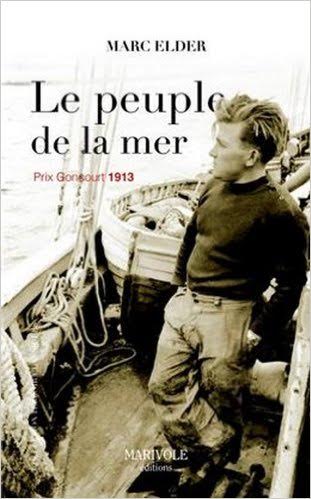Grimper la volée de marches qui surplombe la piazza di Spagna, se caler sur les horaires de l’une des nombreuses visites organisées tout au long de la semaine (sauf le lundi), en français, en italien ou en anglais… et nous voilà prêt à découvrir une partie des lieux dont jouissent au quotidien les heureux pensionnaires de la Villa Médicis.
Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome, placée depuis Malraux sous la tutelle du ministère de la Culture et aujourd’hui dirigée par Muriel Mayette-Holtz, fête cette année ses 350 ans. Elle accueille, pour une durée de 12 à 18 mois des artistes (les anciens « Prix de Rome ») mais aussi des chercheurs, tous francophones et de toutes nationalités, qui peuvent ainsi approfondir leurs travaux. Des résidences de courte durée sont également proposées pour des projets de création et de recherche spécifiques. Des expositions, des concerts, des projections de films, des colloques y sont aussi organisés.

Le voyageur de passage dans la ville éternelle pour quelques jours ne peut hélas pas profiter de tout ce programme, mais la visite de la Villa est vraiment une étape conseillée. En effet, non seulement la vue sur la ville depuis la colline du Pincio est imprenable, mais ce n’est qu’une fois à l’intérieur, depuis les magnifiques jardins Renaissance, que la façade de la villa révèle toute son élégance.
A l’origine propriété de la famille Ricci, son aspect actuel est l’œuvre du cardinal Ferdinand de Médicis qui en fit l’acquisition en 1576. Il orna la façade d’authentiques bas-reliefs romains : taureau sacrifié, Hercule qui a tué le lion de Némée, guirlandes (parties qui remontent à – 9 av. J.-C.), etc sont ainsi disposés autour du blason des Médicis (alors constitué de 6 boules) surmonté du chapeau cardinal.
Les jardins à l’italienne, avec leur partie sans fleur, symbole d’éternité (les fleurs passent…) et leur partie labyrinthique (non pas pour se perdre, mais pour mieux penser…) abritent notamment une monumentale statue de Roma (de l’époque de l’empereur Hadrien), qui ressemble à Athéna, mais reconnaissable aux deux louves sur son casque. Dans sa main droite, elle tient la sphère, symbole de perfection (car sans début ni fin). Deux grands masques Renaissance l’entourent, exécutés par l’atelier de Michel-Ange.

Plus loin, on découvre une étonnante installation, œuvre de Balthus (qui fut directeur de la Villa Medici de 1961 à 1977). Réalisée avec des copies en plâtres de copies (qui sont à Florence) de statues romaines en bronze aujourd’hui disparues (car transformées en canons), elle illustre le mythe de Niobé, mère de nombreux enfants, qui voulait se mesurer à la déesse Léto, qui n’en avait que deux. Pour punir cet affront, Apollon et Artémis, les enfants de Léto tuèrent tous ses enfants à coups de flèches. L’installation montre l’épisode d’une façon saisissante : pris dans les herbes folles du jardin, certains des enfants sont déjà à terre, d’autres, effrayés, les yeux tournés vers le ciel, essaient de se protéger des flèches meurtrières. Niobé quant à elle entourant sa dernière fille finit pétrifiée. Un cheval accompagne la scène en tant que symbole de la mort dans le monde grec ancien.
La gypsothèque expose des pièces de la collection des plâtres de l’Académie comme le célèbre torse du Belvédère (l’original se trouve dans les musées du Vatican) ou encore des sculptures de la colonne Trajane (piazza Venezia à Rome toujours).
Dans le prétendu studiolo (qui en réalité devait servir à d’autres études que strictement littéraires), on découvre des fresques réalisées en 1576 par Jacopo Zucchi (un élève de Vasari) représentant des volières avec de nombreux oiseaux, y compris exotiques, quand le stanzino d’Aurora à côté révèle, du même peintre, une illustration des fables d’Ésope, que Jean de La Fontaine mit en vers bien des siècles plus tard.

On termine le parcours aux talons d’un guide local en verve et plein d’humour par la visite d’une partie de la villa proprement dite. Le plafond de la chambre du cardinal par exemple mérite quelques explications : Zucchi, toujours lui, y a illustré ce que serait la théorie néo-platonicienne de la création du monde à partir de la fusion des quatre éléments. Le feu et l’air ont ainsi créé l’éclair, l’eau et l’air l’arc-en-ciel. Mais on ne verra pas la création de l’homme à partir du feu et de la terre, car un descendant du cardinal Ferdinand de Médicis a fait brûler cette partie-là pour non-conformité au récit biblique. Le même héritier a fait détruire tout le plafond de la chambre des Amours, alors orné de nus… Une constellation de papillons, œuvre du plasticien contemporain Claudio Parmiggiani les remplace aujourd’hui.
Académie de France à Rome, Villa Medici
Uniquement en visite guidée, voir les horaires sur le site
Durée 1h30 environ, tarif 12 euros (TR 6 euros)



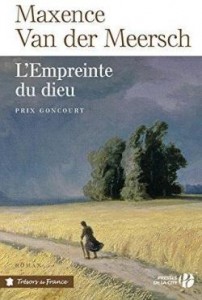 « L’empreinte du dieu », prix Goncourt 36, a inspiré Andreossi. Un billet qui donne bien envie d’aller y voir de plus près… Bonne lecture !
« L’empreinte du dieu », prix Goncourt 36, a inspiré Andreossi. Un billet qui donne bien envie d’aller y voir de plus près… Bonne lecture !

![Die Orden der Nacht [Les Ordres de la nuit] (1996), acrylique, émulsion et Shellac sur toile, 356 x 463 cm, Seattle Art Museum, Photo : © Atelier Anselm Kiefer](http://www.maglm.fr/wp-content/uploads/2016/02/anselm_kiefer_die_orden_der_nacht-300x234.jpg)
 Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée.
Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée. Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ».
Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ». La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène.
La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène.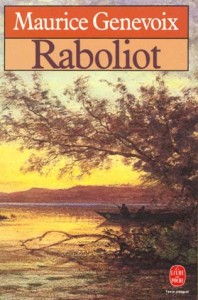 Voici la 13ème livraison du feuilleton des Prix Goncourt signé Andreossi. Il nous emmène cette fois à la campagne… il y a près d’un siècle. Bonne (re)découverte ! Mag
Voici la 13ème livraison du feuilleton des Prix Goncourt signé Andreossi. Il nous emmène cette fois à la campagne… il y a près d’un siècle. Bonne (re)découverte ! Mag Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée,
Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée, Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré.
Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré. Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.
Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.