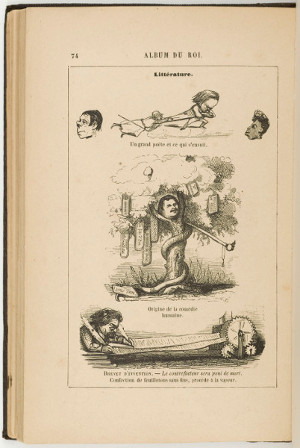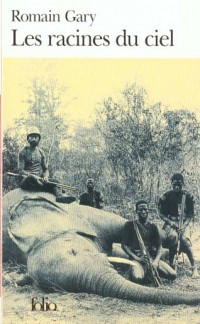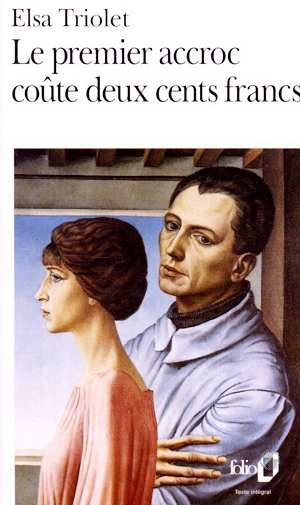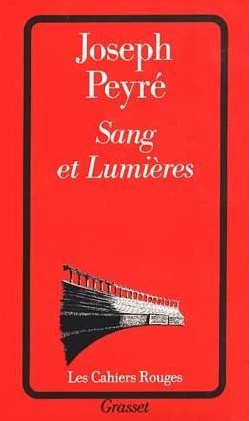Oslo, musée Munch
Photo © Munch Museum
Ouverte au public en octobre dernier, la Fondation Louis Vuitton installée dans l’extraordinaire « vaisseau » que Frank Gehry a amarrée entre le Jardin d’Acclimatation et le Bois de Boulogne, inaugure sa troisième exposition, visible jusqu’au 6 juillet 2015.
Exceptionnelle, Les clefs d’une passion présente une soixantaine d’œuvres, signées des plus grands artistes de la première moitié du XX° siècle, dont certaines rarement prêtées, et plus rarement encore réunies. Les plus grands musées du monde, ainsi que certains collectionneurs ont en effet accepté de prêter leur concours au grand mécène Bernard Arnault. A titre d’exemple, on peut voir le fameux Cri de Munch, qui n’avait pas quitté Olso depuis près de dix ans, après avoir été volé à Vienne et retrouvé deux ans plus tard.
L’exposition a pour ambition de mettre en avant les artistes qui ont révolutionné la peinture dans le premier XX° siècle. Peu d’œuvres, on l’a vu, pour un programme si vaste qu’il compte forcément de grands absents. Pas de litanie de « -ismes » non plus, nombreux à cette période, mais un choix thématique dont la cohérence est dans l’ensemble assurée et qui parfois correspond avec un mouvement de l’histoire de l’art du siècle dernier.
Tel est le cas du premier, expressionnisme subjectif, où le fameux Cri est précédé de trois Giacometti (deux œuvres graphiques, dont le Portrait de Jean Genet et L’Homme qui marche I, eux visibles en France), du Pressentiment complexe de Malévitch, de deux études de Francis Bacon (dont une impressionnante Etude pour un portrait, venu du Chicago), d’un Otto Dix et d’une convaincante série d’autoportraits de la Finlandaise Helene Schjerfbeck, dont les contours du visage perdent de leur netteté au fil des tableaux, nous faisant assister à une accélération du vieillissement et à l’inexorable marche du sujet vers la mort. Ontologique solitude, sentiment de disparition, enfermement, tout dans cette salle exprime de façon poignante l’angoisse fondamentale de l’Homme.

Les trois salles suivantes, dédiées à la ligne contemplative, sont un réconfort. S’y déploient d’abord les paysages, tous autour de l’eau, de Ferdinand Hodler, de Gallen-Kallela, d’Emil Nolde, de Monet. Leur succèdent les lignes abstraites de Malévitch et de Mondrian et l’intensité d’un rouge Rothko. Après les mers, les lacs et les nymphéas de la salle précédente, le contraste est fort ; mais, après tout, le début du XX° siècle est fait de tout cela. Retour au figuratif ensuite, avec un superbe (mais c’est presque un pléonasme) Eté de Bonnard. Il est entouré d’un remarquable ensemble de Picasso, une sculpture et trois tableaux, très sensuels, tous inspirés du modèle Marie-Thérèse Walter, dont le peintre espagnol a magnifié les courbes féminines dans les années 30. La première vient d’une collection particulière et les tableaux de New-York, Londres et Paris : jolie réunion au sommet.
La section suivante, dite popiste, fait entrer dans une autre dimension, celle de la culture populaire, avec des œuvres de Picabia et de Robert Delaunay, inspirées des illustrés de charme pour l’un et de la publicité pour l’autre. Dans la même section, mais d’un tout autre intérêt pictural, trois grandes toiles de Fernand Léger, sur ses thèmes classiques, dont Les constructeurs à l’aloès, qui a fait le chemin depuis Moscou.
La quatrième et dernière étape est dédiée à la musique, à travers des tableaux de Kandinsky, Kupka, Severini et, last but not least, Matisse : l’immense Danse, du Musée de l’Ermitage, maintes fois vu en reproduction, comme le Cri de Munch, mais dont l’original fait ici aussi l’effet d’une découverte, et La tristesse du Roi du Centre Pompidou, un très grand et beau collage sur la musique et la danse. Histoire de finir dans la joie, après avoir commencé dans l’angoisse. C’est sans doute mieux dans ce sens.
Les clefs d’une passion
Jusqu’au 6 juillet 2015