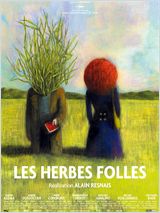 Quelle chance de trouver quelques salles qui projettent encore Les herbes folles, le dernier film d’Alain Resnais…
Quelle chance de trouver quelques salles qui projettent encore Les herbes folles, le dernier film d’Alain Resnais…
Dès les premiers plans au ras du sol, d’abord quelques herbes échappées du bitume, puis des paires de jambes et de souliers colorés qui trottinent fermement, une bouffée de plaisir envahit le spectateur : il sent bien là que le réalisateur va lui montrer du cinéma, du vrai, inventif et beau. A l’arrivée : un Resnais plus aérien que jamais.
La caméra tourne autour du visage de Sabine Azéma dans la Galerie du Palais-Royal, chevelure rouge sur fond de grille à pointes dorées dans un coin de ciel bleu d’hiver : flamboyant juste comme il faut, premier coup de pinceau de notre Resnais à son héroïne Marguerite, rouge et incandescente, désirable et désirante. Un sac jaune comme un soleil s’élance dans les airs, le sac à main de Marguerite, volé comme dans un courant d’air chaud ascendant : si cet incident, le vol de ce sac n’était pas arrivé, nous dit la voix off d’Edouard Baer, faussement ingénue, toute la suite, évidemment… On se rappelle Smoking / No smoking…
Car le rouge portefeuille du sac jaune dérobé finit par arriver, quelques kilomètres plus loin, aux pieds de Georges Palet (ce jeu avec les noms, quel régal), joué par André Dussollier, jeune retraité dont le calme apparent ne masque guère une agitation intérieure des plus troubles… et troublantes. Le voici dans le halo de lumière de la lampe en verre vert de son bureau, prêt à appeler Marguerite nuitamment pour la prévenir, déjà obsédé par deux photos d’identité, un nom et un prénom…
Une drôle d’histoire d’amour est en route, très vite démarrée dans la tête de Georges. Les faits, eux, mettent plus de temps à venir. Tout le monde a le droit de se faire des idées lui écrit Marguerite pour clore l’affaire. Croirez-vous qu’elle s’arrête là ? Gardons à l’esprit l’incandescence de Marguerite ; qui plus est, pas du tout du genre à se laisser consumer…
Autour d’eux, Alain Resnais fait vivre des personnages secondaires tout aussi parfaits ; il les aime autant que les premiers. Des flics (Mathieu Almaric et Michel Vuillermoz) nommés Bernard de Bordeaux et Lucien d’Orange que l’on adore. Une Emmanuelle Devos les deux pieds sur terre qui décolle au premier courant d’air frais entré par la fenêtre de sa voiture. Anne Consigny en épouse plan-plan qui s’abandonne elle aussi à la passion de Georges pour Marguerite.
Il y a au sol et dans le ciel un avion façon Saint-Exupéry de très grande importance aussi ; des fleurs autres que Marguerite, jusque dans les lieux ; des herbes folles et une pelouse tondue de près qui ne trompe personne. Sur la route qui sépare Marguerite et Georges, il y a des feux qui passent au rouge, puis au vert, puis au rouge ; et aussi du cinéma, un film de cinéma dans une salle de cinéma, et un baiser de cinéma avec une musique de cinéma. Il y a… mille choses, les mille reflets de la fantaisie d’Alain Resnais (87 ans) : brillante, colorée, follement réjouissante.
Les herbes folles
Un thriller amoureux d’Alain Resnais
Avec Sabine Azéma, André Dussollier, Anne Consigny, Mathieu Almaric, Emmanuelle Devos…
Durée 1 h 44
Les herbes folles est adapté du roman de Christian Gailly L’incident. Il a reçu le Prix exceptionnel du Jury au dernier festival de Cannes et est nominé dans 4 catégorie pour les César 2010, dont le César du meilleur film.

 La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes.
La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes. Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence.
Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence. C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui.
C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui. Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes.
Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes.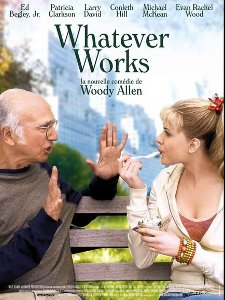 Beaucoup ont applaudi le retour de Woody Allen à Manhattan, se sont réjouis du côté délicieusement vintage de Whatever Works.
Beaucoup ont applaudi le retour de Woody Allen à Manhattan, se sont réjouis du côté délicieusement vintage de Whatever Works. Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures.
Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures. Walt Kowalski, vieil homme à l’ancienne, droit comme un i (incarné par Clint Eastwood soi-même), planté de longue date dans ses principes, enterre son épouse.
Walt Kowalski, vieil homme à l’ancienne, droit comme un i (incarné par Clint Eastwood soi-même), planté de longue date dans ses principes, enterre son épouse. Il Divo, c’est aussi Belzébuth, le Renard, le Sphinx, la Salamandre, le Bossu, l’Eternité… dites simplement Giulio Andreotti et vous rassemblez sur ce nom cinquante ans de la vie politique italienne d’après-guerre.
Il Divo, c’est aussi Belzébuth, le Renard, le Sphinx, la Salamandre, le Bossu, l’Eternité… dites simplement Giulio Andreotti et vous rassemblez sur ce nom cinquante ans de la vie politique italienne d’après-guerre.