
L’art a ceci de merveilleux qu’il ne finit jamais de nous révéler ses splendeurs, et notamment celles issues des grands maîtres du passé que les siècles ont quelque peu éclipsées.
Tel est le cas du Pérugin, de son vrai nom Pietro di Christoforo Vannucci, né vers 1450 près de Pérouse et mort en 1523, grand peintre de la Renaissance italienne dont le musée Jacquemart-André a réuni une cinquantaine d’œuvres.
Si la plupart des tableaux ont été prêtés par de grandes institutions italiennes, d’autres viennent de Washington (magnifique Vierge à l’enfant), du Royaume-Uni, de musées français, notamment du Louvre, comme un Apollon et Daphnis, longtemps attribué à tort à Raphaël. D’ailleurs, le musée Jacquemart-André donne en quelque sorte tout son sens à cette confusion, en soulignant, en fin de parcours, l’influence du Pérugin sur le jeune Raphaël, dont on ne ne sait pas s’il fut directement le maître, mais dont l’héritage est visible à travers les dix œuvres de Raffaello Sanzio exposées. On admire notamment une douceur des traits qui semble relever d’une commune parenté. Si par la suite Raphaël ira plus loin dans ce soin apporté au dessin des visages et des corps, Pérugin n’est pas allé jusqu’à cette idéalisation, privilégiant quant à lui un certain naturel. Et c’est tant mieux ! Malgré les nombreuses influences des artistes entre eux à cette époque d’ébullition artistique, d’échanges, d’enrichissements mutuels et d’émulation, chacun a développé son art, son propre style.
Celui de Il Perugino, tel que le restitue la très belle exposition concoctée par Vittoria Garibaldi, ex directrice de la Galleria Nazionale d’Ombrie, apparaît comme une heureuse synthèse des différents apports du Quattrocento renaissant. La perspective et le recours à l’architecture initié par Piero della Francesca et des maîtres florentins, le modelé de Botticelli, le sfumato des paysages de Léonard, la lumière et les gammes chromatiques des Vénitiens et notamment de Bellini… et même la virtuosité que permettait l’usage de la peinture à l’huile venue des maîtres flamands.

Avec cela, un sens de la composition tout en souplesse et une expressivité des traits tout humaine. Pas étonnant qu’il ait été, au tournant du XVI° siècle, le peintre de la péninsule le plus admiré de ses contemporains. Laurent de Medicis et Isabelle d’Este furent de ses nombreux commanditaires. Le pape lui-même, Sixte IV, le fit venir à Rome sur le grand chantier de la chapelle Sixtine, où il peint des épisodes de la Vie de Moïse et de la Vie du Christ, œuvres dont témoigne un petit film en introduction à l’exposition. En témoignent également à leur façon les portraits exécutés par certains des peintres ayant participé avec lui à la décoration de la célèbre chapelle de Saint-Pierre-de-Rome : Botticelli et Rosselli. Ils sont présentés à côté de portraits du Pérugin, parmi lesquels celui représentant Francesco delle Opere, dont il place avec modernité une main sur le bord du tableau. Le spectateur ne saurait en être plus près.
Huit salles, dont les dernières sont plus spécifiquement consacrées au rapprochement avec Raphaël, retracent les grandes étapes de la carrière du peintre de Pérouse. Des vierges pleines de grâce et de douceur sur arrière-fonds paysagers empreints de sérénité. Une Marie-Madeleine on ne peut plus méditative. Un diptyque composé d’un Christ en couronne d’épine et d’une Vierge d’une remarquable efficacité : simplicité, beauté, émotion, tout y est. Des saints poignants, tels ce Saint-Jérôme pénitent. Citons encore le splendide polyptyque de San Pietro, qui réunit avec bonheur des tableaux venus de Nantes et de Rouen, notamment un Baptême et une Résurrection dont la clarté, l’harmonie des couleurs, l’humanité des expressions et la perfection de la composition n’en finissent pas d’enchanter le regard.
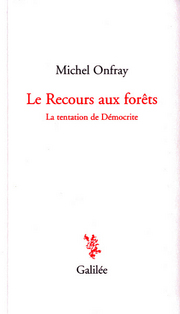 A l’issue de sa conférence
A l’issue de sa conférence