
En voilà un roman ! Difficile d’en lâcher la lecture alors que la version en poche approche des 1000 pages. Il est vrai que l’autrice a eu recours aux procédés littéraires les plus efficaces pour réussir son roman, prix Fémina 1990. Une construction rigoureuse qui lui permet, avec des allers-retours temporels, de semer des indices jusqu’au dénouement final ; donner un effet de réel en faisant croire que la narratrice confie son récit à une écrivaine chargée d’en tirer un livret d’opéra[1] ; une histoire d’amour et de folie perçue comme scandaleuse ; des scènes aux puissantes images qui frappent les esprits.
Nous pouvons présenter la famille Helleur telle qu’on nous en donne le portrait tout au long de presque tout le roman : un père avocat passionné de justice, qui tente d’amortir les secousses intrafamiliales et une mère, Nicole, qui se réfugie dans son garage tendu de bleu pour danser sur le boléro de Ravel. Une femme voilée, Tiresia, qu’on ne touche pas, qui vit dans la maison comme une référence indispensable à tous. Deux enfants, frère et sœur, Dan et Estelle, qui vivent un amour fou. D’autres personnages essentiels gravitent autour de ce monde : le jeune voisin Adrien Voisin, le docteur Minor dont le métier est de lutter contre sa Major.
L’action se passe dans une petite ville française, à New York, à Paris, dans un couvent. La mort de père, mère et frère permet de révéler le rôle de l’Histoire, tragique pour les Helleur, suite à la guerre 39-45. Auparavant nous assistons au trouble d’un jeune médecin à qui Estelle dit avoir tué son frère, à la rencontre avec deux policiers newyorkais à propos d’une chanson sur la salade, à l’extrait d’un cercueil du cimetière pour le cacher dans une grotte…
Nous avons apprécié la manière dont Pierrette Fleutiaux nous embarque dans un récit qui pourrait sembler rocambolesque. La narratrice s’adresse à l’écrivaine : « Comment raconter ces choses, madame, paraissent-elles étranges, paraissent-elles rebutantes, parle-t-on de ces choses dans le monde où vous êtes, je ne sais pas, madame, elles appartiennent au corps, pas aux mots, pas aux phrases… ». Nous avons gardé en mémoire les images de cette famille hors norme : « (…) puis ils se rejoindraient sur le perron derrière la balustrade, tous trois, mon père si jeune dans son costume blanc, Nicole sa rose jaune à un bras et Tiresia sa rose pourpre à l’autre, et devant la balustrade du perron, la pelouse monterait surnaturellement verte dans le clair de lune, chaque tige d’herbe finement liserée d’argent, et alors de dessous la terre se lèverait la chair la plus vivante, la plus éblouissante, oh mon frère… ».
Andreossi
[1] Et cela a marché : 28 ans après la publication du roman, un opéra a été composé à partir de « Nous sommes éternels » !
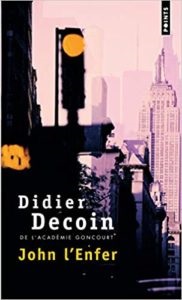
 Le Goncourt 1966 récompense Edmonde Charles-Roux pour son premier roman, Oublier Palerme. Deux pôles géographiques se partagent l’intrigue, New York et cette grande ville de Sicile que les protagonistes ne peuvent oublier. Mais si l’intérêt se soutient bien lorsque que l’action se déroule sur l’île, les épisodes new-yorkais provoquent un grand ennui, du fait d’une construction peu convaincante.
Le Goncourt 1966 récompense Edmonde Charles-Roux pour son premier roman, Oublier Palerme. Deux pôles géographiques se partagent l’intrigue, New York et cette grande ville de Sicile que les protagonistes ne peuvent oublier. Mais si l’intérêt se soutient bien lorsque que l’action se déroule sur l’île, les épisodes new-yorkais provoquent un grand ennui, du fait d’une construction peu convaincante.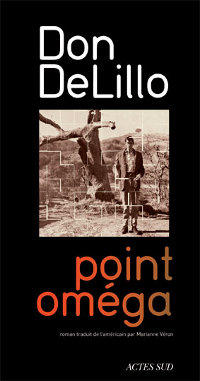 D’abord, après la page de titre, une information : « 2006 Fin d’été/début d’automne ». Le temps de l’action du roman est précis.
D’abord, après la page de titre, une information : « 2006 Fin d’été/début d’automne ». Le temps de l’action du roman est précis. Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !
Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !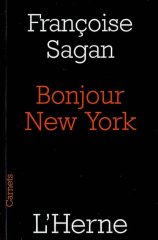 New York, Capri, Naples, Venise… elle y est allée, elle a vu, ressenti.
New York, Capri, Naples, Venise… elle y est allée, elle a vu, ressenti.