 Ces photographies sont présentées pour la première fois en France.
Ces photographies sont présentées pour la première fois en France.
Elles témoignent pourtant de l’un des conflits majeurs du XXème siècle : la Guerre civile d’Espagne.
Agustí Centelles est un jeune photographe de la presse catalane lorsqu’en 1936 le putsch militaire de Franco contre la République met le pays à feu et à sang.
Engagé auprès des Républicains, à Barcelone et sur le front d’Aragon, très mobile grâce à son Leica, Centelles enregistre les luttes et les drames : l’enthousiasme des miliciens (et des miliciennes, ce qui est une première et ne manque pas de surprendre en découvrant ces photos) partant en colonne défendre le gouvernement du Front populaire, les combats de rue dans Barcelone, la ville détruite par les bombardements, les cadavres d’hommes et de chevaux, la vie quotidienne sur le front, les équipements de fortune, mais aussi les sourires de ceux que l’espoir et la solidarité animent.
Ce regard humaniste n’est pas sans rappeler celui de Robert Capa qui a lui aussi – mais en tant qu’"extérieur" – témoigné de ce déchirant conflit intérieur.
Les photos et les journaux de l’époque de diverses tendances politiques rappellent les réactions de la communauté internationale : le soutien immédiat de l’Allemagne et de l’Italie à Franco ; la non-implication de la France et de la Grande-Bretagne ; l’appui des volontaires anti-fascistes (pour l’essentiel appartenant aux Brigades internationales), comme les écrivains André Malraux et George Orwell (que l’on peut voir ici, engagé dans les milices en 1937), et, à partir de la défaite des Républicains, la peur de la France de voir des Espagnols venir en masse s’y réfugier.
 La deuxième partie de l’exposition traite précisément de ce sujet, avec les photos que Centelles a prises dans les camps du sud de la France lorsqu’il a dû fuir le régime franquiste avec près d’un demi-million de ses compatriotes en février 1939.
La deuxième partie de l’exposition traite précisément de ce sujet, avec les photos que Centelles a prises dans les camps du sud de la France lorsqu’il a dû fuir le régime franquiste avec près d’un demi-million de ses compatriotes en février 1939.
Interné au centre d’Argelès-sur-mer puis à celui de Bram, dans l’Aude, il a gardé trace grâce à ses photos mais aussi à son journal des conditions de vie dans les camps. Dans son cahier d’écolier il écrit : "Chaque jour qui passe dans cette prison (on ne peut pas appeler cela un camp de réfugiés malgré le nom qu’il porte), le désespoir grandit : des hommes normaux à leur arrivée en France, beaucoup, la plupart, peut-être 70 %, ont dégénéré mentalement".
Entourés de hauts barbelés, gardés par des tirailleurs sénégalais, les abris étaient de simples baraquements en bois, dont on se demande comment Agustí Centelles a pu y installer un laboratoire photo.
C’est en tout cas ce qui lui a permis d’être libéré au bout de quelques mois, autorisé à aller exercer son métier à Carcassonne.
Mais en 1944, pour échapper à la Gestapo, il doit fuir une nouvelle fois et revient alors en Espagne, où il va travailler, d’abord clandestinement, puis très discrètement, jusqu’à la mort de Franco. Ce n’est qu’en 1976, soit près de quarante ans après qu’il les a prises, que Centelles ira à Carcassonne récupérer les négatifs de ces photos, laissés dans la famille qui l’avait hébergé à l’époque.
Visiblement, il a fallu attendre encore quelques trente années de plus pour les exposer en France.
Agustí Centelles
Journal d’une guerre et d’un exil, Espagne-France, 1936-1939
Jeu de Paume – site Sully
62, rue Saint-Antoine – Paris IVème
Jusqu’au 13 septembre 2009
Entrée 5 €
Images : Confraternisation de militants anarchistes et d’agents de la Guardia Civil, Barcelone, 19 juillet 1936, Agustí Centelles, Archives Centelles, Barcelone / © ADAGP, Paris, 2009
et Camp de réfugiés de Bram, 1939, Agustí Centelles, Archives Centelles, Barcelone / © ADAGP, Paris, 2009
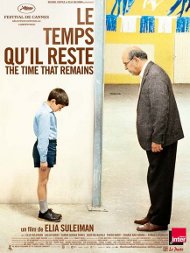 Tourné entièrement en plans fixes, avec une photo légèrement délavée qui évoque les vieilles pellicules, inondé de soleil et de longs moments de silence, Le temps qu’il reste plonge dans un univers d’immobilité et de réflexion.
Tourné entièrement en plans fixes, avec une photo légèrement délavée qui évoque les vieilles pellicules, inondé de soleil et de longs moments de silence, Le temps qu’il reste plonge dans un univers d’immobilité et de réflexion.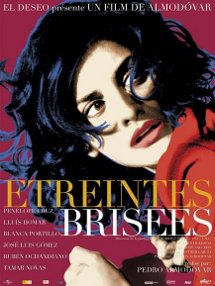 S’il est un petit bonheur qui réconcilie avec la Capitale à la rentrée, c’est bien la possibilité d’aller au cinéma voir les films qu’on a loupés au moment de leur sortie.
S’il est un petit bonheur qui réconcilie avec la Capitale à la rentrée, c’est bien la possibilité d’aller au cinéma voir les films qu’on a loupés au moment de leur sortie.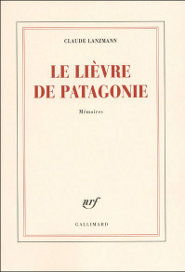 Le lièvre de Patagonie est une pierre précieuse aux facettes multiples.
Le lièvre de Patagonie est une pierre précieuse aux facettes multiples. Après avoir adoré sa belle Ellie toute sa vie, Carl, devenu veuf, se retrouve fort grincheux. D’autant que d’impitoyables promoteurs menacent de faire main basse sur son pavillon et que deux infirmiers l’attendent de pied ferme pour l’emmener fissa en maison de retraite. Qu’à cela ne tienne, Carl, comme s’il avait récupéré la malice et l’opiniâtreté de feue son épouse, s’envole un beau matin dans sa demeure, tous deux portés par une nuée de ballons multicolores.
Après avoir adoré sa belle Ellie toute sa vie, Carl, devenu veuf, se retrouve fort grincheux. D’autant que d’impitoyables promoteurs menacent de faire main basse sur son pavillon et que deux infirmiers l’attendent de pied ferme pour l’emmener fissa en maison de retraite. Qu’à cela ne tienne, Carl, comme s’il avait récupéré la malice et l’opiniâtreté de feue son épouse, s’envole un beau matin dans sa demeure, tous deux portés par une nuée de ballons multicolores. Planète Parr, à voir au site Concorde du Jeu de Paume et dans le jardin des Tuileries jusqu’au 27 septembre, n’est pas une simple exposition de photographies de Martin Parr.
Planète Parr, à voir au site Concorde du Jeu de Paume et dans le jardin des Tuileries jusqu’au 27 septembre, n’est pas une simple exposition de photographies de Martin Parr. Après avoir montré les milieux ouvriers et les classes moyennes, il a consacré ses derniers travaux aux privilégiés de la planète.
Après avoir montré les milieux ouvriers et les classes moyennes, il a consacré ses derniers travaux aux privilégiés de la planète.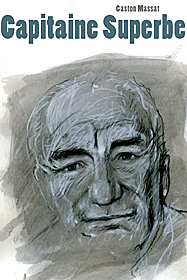 Poète, romancier, résistant, communiste, Gaston Massat aurait eu cent ans cette année.
Poète, romancier, résistant, communiste, Gaston Massat aurait eu cent ans cette année.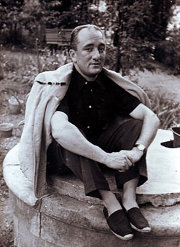 Seul roman qu’il ait écrit, Capitaine Superbe a été publié aux éditions Bordas en 1946 puis dans le journal Action en 1947. Il a fait dire à Aragon qu’il était à lire « avec une espèce de reconnaissance ». Il vient d’être réédité à l’initiative de sa nièce Catherine Massat aux éditions Libertaires avec des illustrations d’Ernest Pignon Ernest.
Seul roman qu’il ait écrit, Capitaine Superbe a été publié aux éditions Bordas en 1946 puis dans le journal Action en 1947. Il a fait dire à Aragon qu’il était à lire « avec une espèce de reconnaissance ». Il vient d’être réédité à l’initiative de sa nièce Catherine Massat aux éditions Libertaires avec des illustrations d’Ernest Pignon Ernest. Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes.
Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes. C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres infiniment beaux mais usés par le travail et l’humiliation. Sophia Loren incarne une mère de famille, Marcello Mastroianni un homme de lettres homosexuel. Rien de les prédisposait à se réunir, si ce n’est le hasard de cette « journée particulière ».
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres infiniment beaux mais usés par le travail et l’humiliation. Sophia Loren incarne une mère de famille, Marcello Mastroianni un homme de lettres homosexuel. Rien de les prédisposait à se réunir, si ce n’est le hasard de cette « journée particulière ». La personnalité d’Antonietta, bon sujet du régime, prête à faire un énième enfant pour recevoir la médaille du gouvernement touche par sa naïveté – facilement explicable compte tenu de sa condition et de l’ignorance pour ne pas dire le mensonge dans laquelle elle est tenue – mais aussi par sa façon, non dénuée d’humour, d’accepter son sort d’épouse, de mère et de fée du logis modèles : petits mensonges à son mari, commentaires in petto comme ce savoureux : « Il faudrait trois mamans, une pour faire la cuisine, une pour faire le ménage… et une pour se remettre au lit ».
La personnalité d’Antonietta, bon sujet du régime, prête à faire un énième enfant pour recevoir la médaille du gouvernement touche par sa naïveté – facilement explicable compte tenu de sa condition et de l’ignorance pour ne pas dire le mensonge dans laquelle elle est tenue – mais aussi par sa façon, non dénuée d’humour, d’accepter son sort d’épouse, de mère et de fée du logis modèles : petits mensonges à son mari, commentaires in petto comme ce savoureux : « Il faudrait trois mamans, une pour faire la cuisine, une pour faire le ménage… et une pour se remettre au lit ».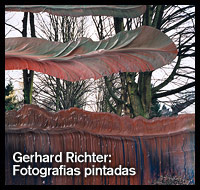 Dans le cadre de
Dans le cadre de