
Marguerite Audoux pouvait-elle publier sous son nom, celui de son père victime de l’imagination d’un employé de mairie ? Donquichote avait été donné comme patronyme à cet « enfant trouvé » mais Marguerite a choisi le nom de sa mère, pour signer son premier roman qui lui a valu le prix Fémina en 1910. L’anecdote nous situe dans l’univers très modeste de l’auteure, dont la carrière littéraire est tout à fait exceptionnelle, non pas par le nombre de ses écrits publiés, mais par sa trajectoire même, d’orpheline sortie d’un internat religieux pour devenir bergère, puis couturière, enfin écrivaine à succès.
Les hasards des rencontres avec des gens de lettres ont tiré de ses tiroirs le manuscrit de ses souvenirs écrits pour elle-même. Octave Mirbeau est subjugué : « Lisez Marie-Claire… Et quand vous l’aurez lue, sans vouloir blesser personne, vous vous demanderez quel est parmi nos écrivains –et je parle des plus glorieux- celui qui eût pu écrire un tel livre, avec cette mesure impeccable, cette pureté et cette grandeur rayonnantes ». C’est en effet le style qui séduit, très loin de l’emphase de bien des romans de l’époque. Une grande simplicité au service d’une évocation suggestive, un don d’observation des êtres qui l’amène à des formules très heureuses.
Ainsi la supérieure du couvent dans lequel elle passe son enfance : « Elle avait un sourire qui ressemblait à une insulte ». Ainsi la mère de l’homme qu’elle aime : « Elle disait des mots dont le sens m’échappait. Je trouvais seulement que ses paroles avaient une odeur insupportable ». Malgré les épreuves vécues dans son enfance puis comme jeune fille, elle n’apparaît pas comme essentiellement victime, insistant sur la complexité des personnes qui l’ont entourée, et sur la diversité des rapports entretenus avec elle. Les religieuses sont aimantes, distantes ou autoritaires, les patrons de la ferme ne sont pas des exploiteurs sans scrupules.
Certes la vie de Marie-Claire connaît de cruelles déceptions, mais elle est contée de telle manière que l’espoir vers des jours meilleurs paraît proche. « Les cris des moissonneurs semblaient parfois venir d’en haut, et je ne pouvais m’empêcher de lever la tête pour voir passer les chars de blé dans les airs ». Une autobiographie qui ne se soucie pas de mettre en valeur la narratrice, qui décrit avec délicatesse les situations provoquées par une vie modeste.
Nous pouvons poursuivre le devenir de Marie-Claire par la lecture de « L’atelier de Marie-Claire », paru dix ans après et couplé au prix Fémina dans certaines éditions : la vie d’un atelier de couture au début du XXe siècle y est très attachante et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir la justesse du regard de Marguerite Audoux.
Andreossi
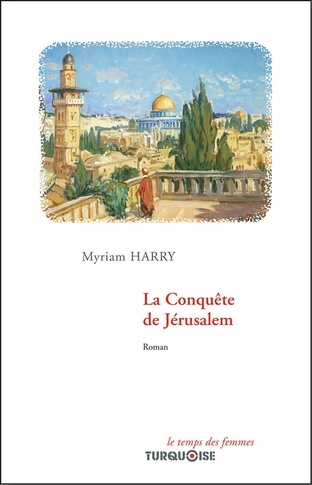
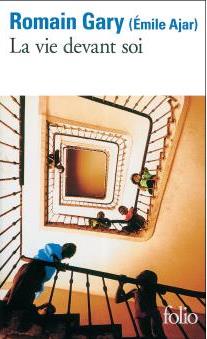

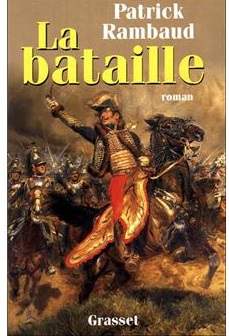
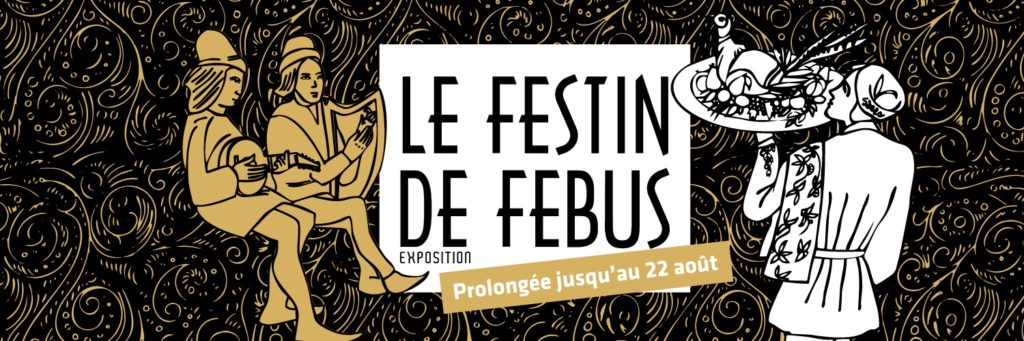
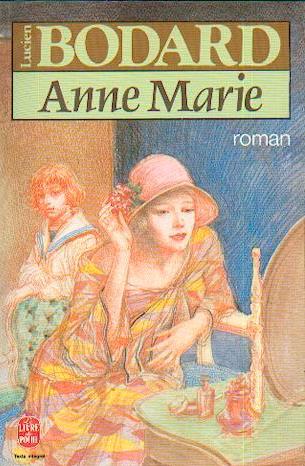
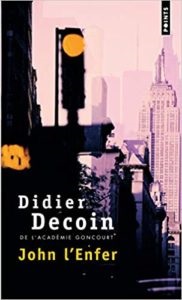
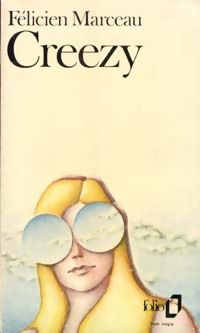
 C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.
C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.