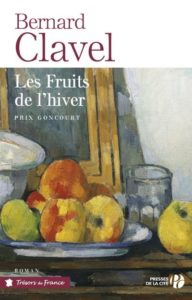 Il fait souvent froid dans le Jura de Bernard Clavel : Les Fruits de l’hiver, Goncourt 1968, sont ceux de l’occupation allemande, mais aussi ceux de la vieillesse du couple Dubois. En cinq chapitres plutôt lents, des premières difficultés à « fabriquer », comme on dit au pays, son bois de chauffage, jusqu’au lit de mort du père Dubois, diverses étapes du vieillissement nous sont décrites, dans un style « réaliste » qui ne parvient pas complètement à nous faire ressentir l’intimité du vieillir.
Il fait souvent froid dans le Jura de Bernard Clavel : Les Fruits de l’hiver, Goncourt 1968, sont ceux de l’occupation allemande, mais aussi ceux de la vieillesse du couple Dubois. En cinq chapitres plutôt lents, des premières difficultés à « fabriquer », comme on dit au pays, son bois de chauffage, jusqu’au lit de mort du père Dubois, diverses étapes du vieillissement nous sont décrites, dans un style « réaliste » qui ne parvient pas complètement à nous faire ressentir l’intimité du vieillir.
Pour cet ancien boulanger fort éloigné de la chose politique, c’est le travail bien fait, à base d’effort physique, qui était l’essentiel : « une vie sans ouvrage était dépourvue de sens ». Même sous la domination nazie, la vie aurait pu être tranquille si un autre froid n’avait perturbé la vie du couple : le père Dubois a deux fils, mais Paul, l’aîné, est issu d’un premier mariage et est peu apprécié, ni de sa seconde épouse ni de leur fils commun Julien.
Il est vrai que tout oppose les deux garçons, le premier est commerçant et fréquente la Milice, le deuxième est artiste et penche du côté de la Résistance : « Ces enfants-là, c’était un mal plus grand que la fatigue et la misère. Plus grand que les privations. Et ce mal était entre sa femme et lui, vivant comme ce feu d’éclapes qu’ils alimentaient sans cesse ».
Peu de lumière dans ce froid de l’hiver, si ce n’est la visite de la fiancée de Julien, une résistante communiste au regard doux. Même la libération de la ville n’apaise pas les soucis du père Dubois, car Paul, qui a trafiqué avec les Allemands, est un temps inquiété. Et puis sa « pauvre vieille » (il nous faut aujourd’hui oublier les âges de chacun, 71 ans pour lui, 57 pour elle !) meurt.
Cet homme têtu, avare en paroles, enfermé dans une vision très traditionnelle du couple, devient dépendant des bonnes et surtout mauvaises volontés de son aîné. Il entame son chemin solitaire, ponctué de moments où il retrouve quelque force ancienne (lorsqu’il refend son bois), et, plus souvent encore, se découvre de nouvelles faiblesses. Il fréquente de plus en plus le cimetière : « Je vais m’en retourner par l’autre allée, comme ça, je verrai un peu plus de monde. A présent, j’ai plus de connaissance ici que par la ville ».
Andreossi
Les fruits de l’hiver, Bernard Clavel
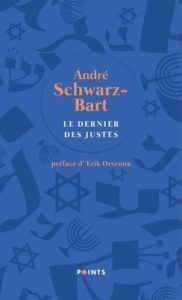 La lecture du Goncourt 1959 serait encore plus éprouvante si le style n’était pas autant teinté d’ironie. L’histoire d’Ernie Lévy, qui commence au XIIème siècle avec ses ancêtres, et se termine dans une chambre à gaz, qui fait le tour des humiliations et persécutions de cette famille Juive, sait allier l’empathie à une douce moquerie, particulièrement vis-à-vis de la religion : « Tuh tuh tuh, répéta Mardochée. Or il existe une multitude si infinie de tons, airs, chants, mélopées, mimiques, expressions, accents, avec lesquels l’idiotisme tuh tuh tuh peut être prononcé, que les talmudistes n’en ont pas distingué moins de trois cents variétés, sujettes ou non à discussion ».
La lecture du Goncourt 1959 serait encore plus éprouvante si le style n’était pas autant teinté d’ironie. L’histoire d’Ernie Lévy, qui commence au XIIème siècle avec ses ancêtres, et se termine dans une chambre à gaz, qui fait le tour des humiliations et persécutions de cette famille Juive, sait allier l’empathie à une douce moquerie, particulièrement vis-à-vis de la religion : « Tuh tuh tuh, répéta Mardochée. Or il existe une multitude si infinie de tons, airs, chants, mélopées, mimiques, expressions, accents, avec lesquels l’idiotisme tuh tuh tuh peut être prononcé, que les talmudistes n’en ont pas distingué moins de trois cents variétés, sujettes ou non à discussion ».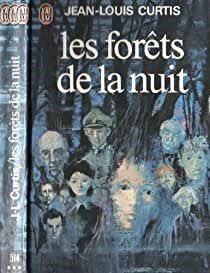 Le prix Goncourt 1947, qui décrit la vie d’une petite ville du sud- ouest de la France sous l’occupation nazie, n’est pas très convaincant. Sous une écriture sans relief, nous sommes tentés de suivre la trajectoire des personnages, mais nous les perdons trop facilement en route ; leur cohérence ne paraît pas non plus toujours évidente, même si on accepte l’idée qu’une période de grande crise bouleverse la vie des gens.
Le prix Goncourt 1947, qui décrit la vie d’une petite ville du sud- ouest de la France sous l’occupation nazie, n’est pas très convaincant. Sous une écriture sans relief, nous sommes tentés de suivre la trajectoire des personnages, mais nous les perdons trop facilement en route ; leur cohérence ne paraît pas non plus toujours évidente, même si on accepte l’idée qu’une période de grande crise bouleverse la vie des gens.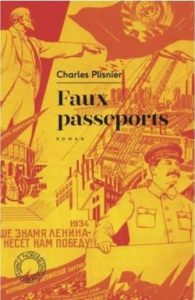 Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur.
Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur.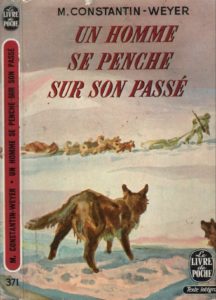 Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ».
Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ».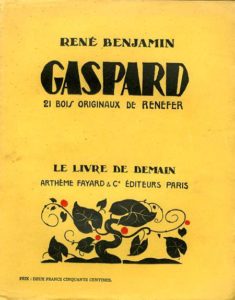 Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18.
Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18. Zelda Fitzgerald est l’héroïne du roman de Gilles Leroy couronné par le prix Goncourt 2007. C’est elle-même qui nous raconte sa vie, d’abord de jeune fille de bonne famille de l’Alabama, puis d’épouse du célèbre écrivain Scott Fitzgerald. Une vie que l’auteur a choisi avec justesse de présenter sous le thème de la difficulté pour une femme de l’époque de parvenir à exister pour elle-même.
Zelda Fitzgerald est l’héroïne du roman de Gilles Leroy couronné par le prix Goncourt 2007. C’est elle-même qui nous raconte sa vie, d’abord de jeune fille de bonne famille de l’Alabama, puis d’épouse du célèbre écrivain Scott Fitzgerald. Une vie que l’auteur a choisi avec justesse de présenter sous le thème de la difficulté pour une femme de l’époque de parvenir à exister pour elle-même.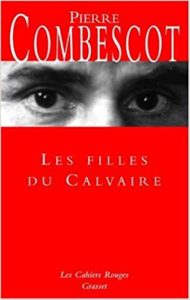 C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent).
C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent).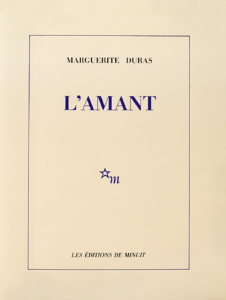 Le Goncourt 1984 se donne nettement comme autobiographique, voulant même prolonger certains écrits antérieurs : « Ici je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements ». Mais le titre choisi met l’accent sur une aventure qui paraît somme toute moins remarquable que révélatrice du rapport de l’auteure à sa famille.
Le Goncourt 1984 se donne nettement comme autobiographique, voulant même prolonger certains écrits antérieurs : « Ici je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements ». Mais le titre choisi met l’accent sur une aventure qui paraît somme toute moins remarquable que révélatrice du rapport de l’auteure à sa famille. Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964.
Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964. Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.
Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.