 C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.
C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.
On peut en savourer l’écriture, la précision des évocations paysagères, le vocabulaire parfois oublié. Nous passons des rivages « accores » à l’écume faiblement « effulgente ». Nous voici dans la chambre des cartes : « Les fenêtres débroussaillées laissaient miroiter sur les tables noircies une clarté plus vive, et parfois un rayon de soleil, qui tournait lentement avec les heures sa colonne de poussière, promenait comme un doigt de lumière sur le fouillis des cartes, tirait de l’ombre dans un tâtonnement ensommeillé un nom étranger ou le contour d’une côte inconnue ».
L’histoire que Gracq nous raconte est riche de plusieurs lectures possibles. Ce peut être celle du réveil d’une vieille cité endormie. Aldo est envoyé à l’Amirauté d’Orsenna comme Observateur. Il y trouve le capitaine Marino et ses lieutenants surveillant la côte des Syrtes, face à celles du Farghestan, ennemi héréditaire mais qui n’a pas bougé depuis trois siècles. Vanessa, maîtresse d’Aldo, issue d’une antique famille d’Orsenna, libère en son amant le désir de sortir le pays de l’inertie dans laquelle il s’est installé. Dans un geste intuitif, Aldo, aux commandes du navire Le Redoutable provoque les canons de la côte d’en face, débutant ainsi le processus vers la guerre.
Mais on peut y lire aussi une réflexion politique (et pessimiste) entre jeunesse et pouvoir. Ce sont bien les jeunes gens qui se lancent dans cette aventure bien risquée, mais au bout du compte ils sont manipulés par les vieilles familles et leurs manigances. A la fin du roman, Aldo est reçu par un membre influent de la Seigneurie, qui lui révèle à la fois comment toute l’opération était calculée par le pouvoir, mais aussi comment celui qui a été utilisé est lié désormais aux puissants : « Quand un homme s’est trouvé une fois vraiment mêlé à certains actes trop grands pour lui et qui le dépassent, la conviction qu’une part de lui est demeurée méconnue, puisque de telles choses en sont nées- qu’il peut y avoir sacrilège à séparer ce que l’événement a uni ».
De belles phrases dans Le Rivage des Syrtes, mais pas seulement.
Andreossi
Le rivage des Syrtes. Julien Gracq
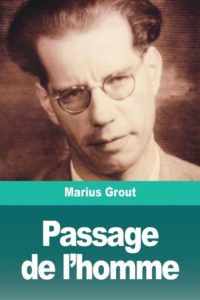 En 1943, les jurés du Goncourt ont distingué Marius Grout et son « Passage de l’homme », conte philosophique bien pessimiste, ce n’est sans doute pas un hasard en pleine occupation allemande. L’auteur reste attentif jusqu’au bout à respecter la forme qu’il s’est choisi pour développer ses arguments, mais il évite l’ennui du lecteur grâce à la brièveté de son roman.
En 1943, les jurés du Goncourt ont distingué Marius Grout et son « Passage de l’homme », conte philosophique bien pessimiste, ce n’est sans doute pas un hasard en pleine occupation allemande. L’auteur reste attentif jusqu’au bout à respecter la forme qu’il s’est choisi pour développer ses arguments, mais il évite l’ennui du lecteur grâce à la brièveté de son roman.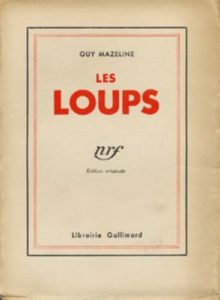 Parce que les jurés du Goncourt 1932 ont choisi « Les Loups » plutôt que « Voyage au bout de la nuit » de Céline, entré depuis dans l’histoire de la littérature, faut-il en refuser la lecture ? Le roman de Guy Mazeline est certes d’une écriture assez ordinaire, mais ce premier volume de la saga familiale des Jobourg se lit sans déplaisir et l’évocation du milieu havrais de la fin du XIXème siècle paraît vraisemblable.
Parce que les jurés du Goncourt 1932 ont choisi « Les Loups » plutôt que « Voyage au bout de la nuit » de Céline, entré depuis dans l’histoire de la littérature, faut-il en refuser la lecture ? Le roman de Guy Mazeline est certes d’une écriture assez ordinaire, mais ce premier volume de la saga familiale des Jobourg se lit sans déplaisir et l’évocation du milieu havrais de la fin du XIXème siècle paraît vraisemblable.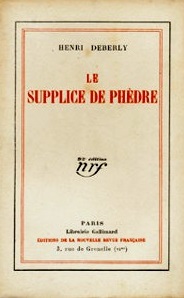 C’est un roman psychologique que les jurés du Goncourt ont choisi de couronner en 1926.
C’est un roman psychologique que les jurés du Goncourt ont choisi de couronner en 1926.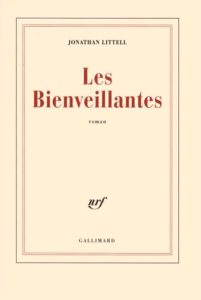 En 2006 le prix Goncourt a été attribué à un roman, Les Bienveillantes, qui laisse le lecteur bien perplexe : son côté « documentaire », qui met en scène une grande tragédie historique, peut apparaître comme le plus intéressant, même au prix d’une lecture éprouvante, tandis que le côté « romanesque », lorsqu’il s’agit du destin individuel du narrateur, a beaucoup de mal à passer le cap de la vraisemblance.
En 2006 le prix Goncourt a été attribué à un roman, Les Bienveillantes, qui laisse le lecteur bien perplexe : son côté « documentaire », qui met en scène une grande tragédie historique, peut apparaître comme le plus intéressant, même au prix d’une lecture éprouvante, tandis que le côté « romanesque », lorsqu’il s’agit du destin individuel du narrateur, a beaucoup de mal à passer le cap de la vraisemblance.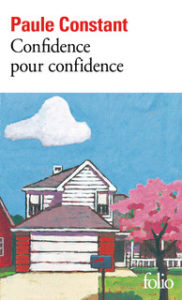 Les confidences entre Gloria, Babette, Lola et Aurore, révélées par le Goncourt 1998, ont du mal à nous intéresser vraiment. On peut penser qu’il s’agit d’une satire du milieu universitaire américain des années 90, mais tout cela paraît un peu court, n’évite pas la caricature abusive et ne fait que trop rarement sourire.
Les confidences entre Gloria, Babette, Lola et Aurore, révélées par le Goncourt 1998, ont du mal à nous intéresser vraiment. On peut penser qu’il s’agit d’une satire du milieu universitaire américain des années 90, mais tout cela paraît un peu court, n’évite pas la caricature abusive et ne fait que trop rarement sourire.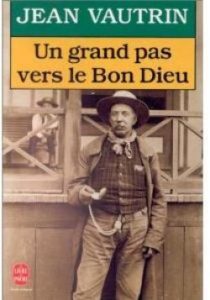 Il faut d’abord s’habituer au français du Goncourt 1989 : « En moins que rien il avait grab son vieille carabine et, craignant plus la nuit, se jeta au hasard des fardoches. Tant pis les ramponeaux, les griffures des broussailles sur ses mollets de kildi, il sentait pas son sang ». Sauf à consulter un dictionnaire du langage cajun, le sens de certains mots restera secret, mais quelque connaissance de l’anglais aidera souvent, tant le parler de la Louisiane emprunte à la langue voisine.
Il faut d’abord s’habituer au français du Goncourt 1989 : « En moins que rien il avait grab son vieille carabine et, craignant plus la nuit, se jeta au hasard des fardoches. Tant pis les ramponeaux, les griffures des broussailles sur ses mollets de kildi, il sentait pas son sang ». Sauf à consulter un dictionnaire du langage cajun, le sens de certains mots restera secret, mais quelque connaissance de l’anglais aidera souvent, tant le parler de la Louisiane emprunte à la langue voisine.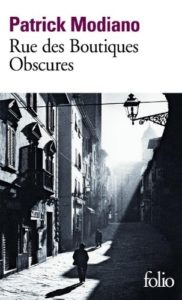 Le Goncourt de l’année 1978 est plus intéressant que captivant. L’interrogation de Guy Roland sur son passé ne s’effectue pas sous le registre de l’émotionnel, car il agit plutôt comme si une simple curiosité le motivait dans ses recherches. Cette distance avec une quête qu’on aurait pu imaginer vécue avec davantage de trouble donne sa portée originale au roman.
Le Goncourt de l’année 1978 est plus intéressant que captivant. L’interrogation de Guy Roland sur son passé ne s’effectue pas sous le registre de l’émotionnel, car il agit plutôt comme si une simple curiosité le motivait dans ses recherches. Cette distance avec une quête qu’on aurait pu imaginer vécue avec davantage de trouble donne sa portée originale au roman.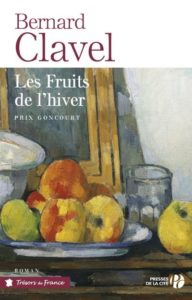 Il fait souvent froid dans le Jura de Bernard Clavel : Les Fruits de l’hiver, Goncourt 1968, sont ceux de l’occupation allemande, mais aussi ceux de la vieillesse du couple Dubois. En cinq chapitres plutôt lents, des premières difficultés à « fabriquer », comme on dit au pays, son bois de chauffage, jusqu’au lit de mort du père Dubois, diverses étapes du vieillissement nous sont décrites, dans un style « réaliste » qui ne parvient pas complètement à nous faire ressentir l’intimité du vieillir.
Il fait souvent froid dans le Jura de Bernard Clavel : Les Fruits de l’hiver, Goncourt 1968, sont ceux de l’occupation allemande, mais aussi ceux de la vieillesse du couple Dubois. En cinq chapitres plutôt lents, des premières difficultés à « fabriquer », comme on dit au pays, son bois de chauffage, jusqu’au lit de mort du père Dubois, diverses étapes du vieillissement nous sont décrites, dans un style « réaliste » qui ne parvient pas complètement à nous faire ressentir l’intimité du vieillir.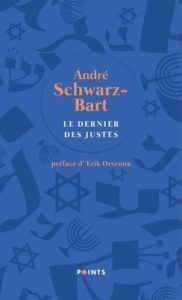 La lecture du Goncourt 1959 serait encore plus éprouvante si le style n’était pas autant teinté d’ironie. L’histoire d’Ernie Lévy, qui commence au XIIème siècle avec ses ancêtres, et se termine dans une chambre à gaz, qui fait le tour des humiliations et persécutions de cette famille Juive, sait allier l’empathie à une douce moquerie, particulièrement vis-à-vis de la religion : « Tuh tuh tuh, répéta Mardochée. Or il existe une multitude si infinie de tons, airs, chants, mélopées, mimiques, expressions, accents, avec lesquels l’idiotisme tuh tuh tuh peut être prononcé, que les talmudistes n’en ont pas distingué moins de trois cents variétés, sujettes ou non à discussion ».
La lecture du Goncourt 1959 serait encore plus éprouvante si le style n’était pas autant teinté d’ironie. L’histoire d’Ernie Lévy, qui commence au XIIème siècle avec ses ancêtres, et se termine dans une chambre à gaz, qui fait le tour des humiliations et persécutions de cette famille Juive, sait allier l’empathie à une douce moquerie, particulièrement vis-à-vis de la religion : « Tuh tuh tuh, répéta Mardochée. Or il existe une multitude si infinie de tons, airs, chants, mélopées, mimiques, expressions, accents, avec lesquels l’idiotisme tuh tuh tuh peut être prononcé, que les talmudistes n’en ont pas distingué moins de trois cents variétés, sujettes ou non à discussion ».