 Après une installation provisoire rue du Paradis, la Pinacothèque de Paris vient d’ouvrir définitivement ses portes au 28 place de la Madeleine dans le 8ème arrondissement.
Après une installation provisoire rue du Paradis, la Pinacothèque de Paris vient d’ouvrir définitivement ses portes au 28 place de la Madeleine dans le 8ème arrondissement.
Ses 2000 m2 répartis sur trois niveaux proposent des expositions temporaires au sous-sol et une boutique au rez-de-chaussée, le premier étage étant destiné à accueillir des artistes contemporains, peintres ou poètes.
L’exposition inaugurale, ouverte au public le 15 juin, est consacrée à Roy Lichtenstein (1923-1997), célèbre figure du Pop Art américain.
Le parcours de la visite, quelque peu dédaléen en raison des multiples cloisons mises en place pour optimiser l’espace d’exposition, propose à travers une sélection de quelques 97 oeuvres datées de 1966 à 1997, une découverte du processus créatif de l’artiste.
Ainsi, petits croquis et divers travaux préparatoires côtoient les peintures de grands formats, collages, sculptures et estampes.
A chaque section, une reproduction de la source d’inspiration figure en bonne place. Roy Lichtenstein a multiplié en effet les réinterprétations d’oeuvres ou d’éléments de tableaux de maîtres modernes : ici Matisse, là Picasso (l’influence cubiste est nette), ou encore Cézanne ; puis les tableaux peints à grands coups de brosse à partir d’un paysage de van Gogh …
Autre source de prédilection : les bandes dessinées, celles Hergé et Walt Disney, mais aussi les comics des années 1950, avec leurs jeunes femmes dénudées aux formes et aux bouches joliment dessinées.
Roy Lichtenstein n’hésitait pas davantage à recréer à sa manière les motifs traditionnels des paysages des estampes japonaises.
Le résultat de ces interprétations est connu : des oeuvres ludiques illuminées de couleurs franches et « artificielles » avec fonds de points de trame, sur des supports aussi divers que la toile, le bois ou le carton, utilisant tout autant la peinture à l’huile que le papier peint ou le plastique…
Tel fut le mouvement dans lequel l’artiste s’est épanoui, le Pop Art, né en Angleterre dans les années 1950, rendu célèbre aux Etats-Unis dans les années 1960 avec Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou encore Robert Rauschenberg : gai, populaire et sans complexe.
On attend l’automne avec impatience pour découvrir l’exposition que la Pinacothèque de Paris consacrera à partir du 10 octobre au peintre Soutine, insuffisamment montré à Paris depuis de nombreuses années. L’intérêt de ce nouveau musée 100 % privé résiderait bien là : « montrer au visiteur des oeuvres ou des collections privées invisibles habituellement » ainsi que son directeur Marc Restellini le propose. Bienvenue donc, et bonne chance à la Pinacothèque de Paris.
Roy Lichtenstein : Evolution
Pinacothèque de Paris
28 place de la Madeleine – Paris 8ème
Jusqu’au 23 septembre 2007
Tlj de 10 h 30 à 18 h 30
Métro Madeleine (lignes 8, 12 et 14), bus 42, 52, 24, 84, 94
Entrée 8 € (TR 6 €)
Commissaire : Jack Cowart, Directeur exécutif de la Fondation Lichtenstein, New-York
Catalogue : 176 p., 39 €
Image : Collage for Still Life with Picasso, 1973 © Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris (2007)
 L’influence du personnage de Carmen dans l’oeuvre de Picasso (1881-1973) : tel est le chemin que l’exposition Sol y Sombra organisée au Musée Picasso jusqu’au 24 juin propose de suivre.
L’influence du personnage de Carmen dans l’oeuvre de Picasso (1881-1973) : tel est le chemin que l’exposition Sol y Sombra organisée au Musée Picasso jusqu’au 24 juin propose de suivre.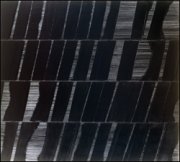 Suite et fin de la visite du musée Fabre avec le XXème siècle.
Suite et fin de la visite du musée Fabre avec le XXème siècle. Suite de la visite du musée Fabre commencée mardi dernier (
Suite de la visite du musée Fabre commencée mardi dernier ( Le musée Fabre, à Montpellier, a rouvert ses portes le 3 février 2007 après une restructuration complète.
Le musée Fabre, à Montpellier, a rouvert ses portes le 3 février 2007 après une restructuration complète. Arshile Gorky (1904-1948), peintre américain d’origine arménienne demeure assez peu connu en Europe.
Arshile Gorky (1904-1948), peintre américain d’origine arménienne demeure assez peu connu en Europe. La trajectoire individuelle de certains d’entre eux leur a valu une large renommée : César et ses compressions, Christo et ses empaquetages, Niki de Saint Phalle et ses Nanas …
La trajectoire individuelle de certains d’entre eux leur a valu une large renommée : César et ses compressions, Christo et ses empaquetages, Niki de Saint Phalle et ses Nanas … Poursuite de la visite de l’exposition
Poursuite de la visite de l’exposition  John Singer Sargent (1856-1925) et Joaquin Sorolla (1863-1923) ont tous deux rencontré le succès de leur vivant mais sont peu connus aujourd’hui.
John Singer Sargent (1856-1925) et Joaquin Sorolla (1863-1923) ont tous deux rencontré le succès de leur vivant mais sont peu connus aujourd’hui. Cabu a débarqué à Paris en 1956 et, depuis plus de 50 ans, entre celui qui a publié ses premiers dessins à Châlons-en-Champagne à l’âge de 15 ans – alors signés K-BU – et la capitale, c’est une véritable histoire d’amour.
Cabu a débarqué à Paris en 1956 et, depuis plus de 50 ans, entre celui qui a publié ses premiers dessins à Châlons-en-Champagne à l’âge de 15 ans – alors signés K-BU – et la capitale, c’est une véritable histoire d’amour.