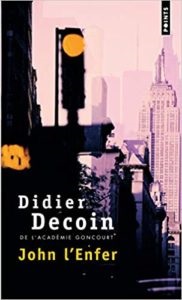
Le roman de Didier Decoin, prix Goncourt 1977, compte quatre personnages principaux : John l’Enfer, Amérindien laveur de carreaux sur les gratte- ciel, Ashton Mysha, Polonais officier de la marine marchande, Dorothy Kayne, sociologue urbaine, et la ville de New York, dans laquelle tout ce monde se retrouve dans une atmosphère de déliquescence manifeste.
Car la ville, dans ces années 70 du vingtième siècle, n’est pas en forme : « C’est la ville qui est vieille, crie Anderson. Elle tient plus sur ses pattes. Lui faites pas mal, l’Enfer. (…) L’un et l’autre ils ont vu la ville se contorsionner (…) Tous deux savent que la cité dissimule sous sa poussière et son clinquant une charpente qui se sclérose davantage de jour en jour ». Nos trois protagonistes épousent cette entropie urbaine : John et Ashton se retrouvent sans travail, Dorothy, à la suite d’un accident, perd la vue, au moins temporairement, et vit avec un bandeau sur les yeux en permanence.
Les deux hommes décident d’aider Dorothy dans son malheur et les trois vivent dans le même appartement, Ashton en tant qu’amant et John comme amoureux transi. La jeune femme elle-même semble subir les événements et elle n’est pas le personnage le plus crédible de l’affaire. Autour d’eux la ville continue de s’effriter, les immeubles pourrissent ou sont envahis par l’eau des canalisations qui éclatent, les clans politiques se déchirent, les chiens errants envahissent les rues. Sous la surface, la pourriture : le brillant animateur de télé se révèle graine de violeur.
Ce démantèlement finit par toucher les corps, non seulement ceux des laveurs de carreaux qui s’écrasent au sol mais aussi celui d’Ashton qui vend son corps à un médecin douteux qui récupèrera les morceaux, après un accident mortel, pour des greffes. Mais l’argent de la vente permet à nos trois amis de vivre luxueusement quelques temps.
Quel espoir dans cette ambiance si délétère ? John l’Enfer rêve d’un retour au passé : « S’il collait son oreille dans la poussière, le Cheyenne entendrait sous les massifs de Washington Square le souffle des eaux souterraines ébranlant les fondations de la ville à la manière d’une sève puissante. Parce qu’il y avait des rivières, ici ; des rivières et des forêts ; et ça revient du fond des temps, ça patiente, et ça s’empare- à la fin ».
Si l’on s’intéresse au devenir des personnages du roman, par contre l’auteur ne réussit pas complètement à nous faire ressentir le climat de délabrement urbain dont il nous parle. Il nous manque une écriture plus évocatrice, plus poétique.
Andreossi
John l’Enfer. Didier Decoin
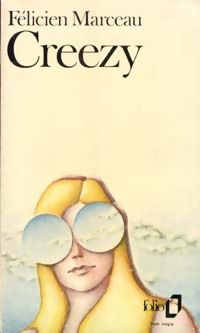
 C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.
C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.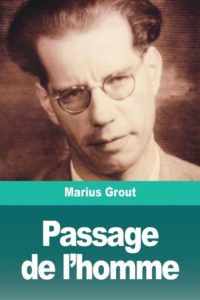 En 1943, les jurés du Goncourt ont distingué Marius Grout et son « Passage de l’homme », conte philosophique bien pessimiste, ce n’est sans doute pas un hasard en pleine occupation allemande. L’auteur reste attentif jusqu’au bout à respecter la forme qu’il s’est choisi pour développer ses arguments, mais il évite l’ennui du lecteur grâce à la brièveté de son roman.
En 1943, les jurés du Goncourt ont distingué Marius Grout et son « Passage de l’homme », conte philosophique bien pessimiste, ce n’est sans doute pas un hasard en pleine occupation allemande. L’auteur reste attentif jusqu’au bout à respecter la forme qu’il s’est choisi pour développer ses arguments, mais il évite l’ennui du lecteur grâce à la brièveté de son roman.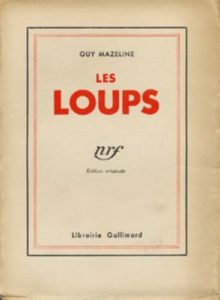 Parce que les jurés du Goncourt 1932 ont choisi « Les Loups » plutôt que « Voyage au bout de la nuit » de Céline, entré depuis dans l’histoire de la littérature, faut-il en refuser la lecture ? Le roman de Guy Mazeline est certes d’une écriture assez ordinaire, mais ce premier volume de la saga familiale des Jobourg se lit sans déplaisir et l’évocation du milieu havrais de la fin du XIXème siècle paraît vraisemblable.
Parce que les jurés du Goncourt 1932 ont choisi « Les Loups » plutôt que « Voyage au bout de la nuit » de Céline, entré depuis dans l’histoire de la littérature, faut-il en refuser la lecture ? Le roman de Guy Mazeline est certes d’une écriture assez ordinaire, mais ce premier volume de la saga familiale des Jobourg se lit sans déplaisir et l’évocation du milieu havrais de la fin du XIXème siècle paraît vraisemblable.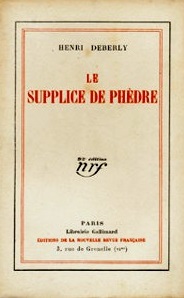 C’est un roman psychologique que les jurés du Goncourt ont choisi de couronner en 1926.
C’est un roman psychologique que les jurés du Goncourt ont choisi de couronner en 1926. En 2006 le prix Goncourt a été attribué à un roman, Les Bienveillantes, qui laisse le lecteur bien perplexe : son côté « documentaire », qui met en scène une grande tragédie historique, peut apparaître comme le plus intéressant, même au prix d’une lecture éprouvante, tandis que le côté « romanesque », lorsqu’il s’agit du destin individuel du narrateur, a beaucoup de mal à passer le cap de la vraisemblance.
En 2006 le prix Goncourt a été attribué à un roman, Les Bienveillantes, qui laisse le lecteur bien perplexe : son côté « documentaire », qui met en scène une grande tragédie historique, peut apparaître comme le plus intéressant, même au prix d’une lecture éprouvante, tandis que le côté « romanesque », lorsqu’il s’agit du destin individuel du narrateur, a beaucoup de mal à passer le cap de la vraisemblance. Les confidences entre Gloria, Babette, Lola et Aurore, révélées par le Goncourt 1998, ont du mal à nous intéresser vraiment. On peut penser qu’il s’agit d’une satire du milieu universitaire américain des années 90, mais tout cela paraît un peu court, n’évite pas la caricature abusive et ne fait que trop rarement sourire.
Les confidences entre Gloria, Babette, Lola et Aurore, révélées par le Goncourt 1998, ont du mal à nous intéresser vraiment. On peut penser qu’il s’agit d’une satire du milieu universitaire américain des années 90, mais tout cela paraît un peu court, n’évite pas la caricature abusive et ne fait que trop rarement sourire.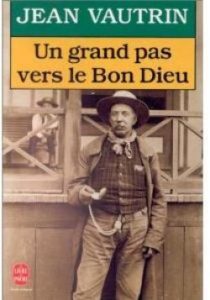 Il faut d’abord s’habituer au français du Goncourt 1989 : « En moins que rien il avait grab son vieille carabine et, craignant plus la nuit, se jeta au hasard des fardoches. Tant pis les ramponeaux, les griffures des broussailles sur ses mollets de kildi, il sentait pas son sang ». Sauf à consulter un dictionnaire du langage cajun, le sens de certains mots restera secret, mais quelque connaissance de l’anglais aidera souvent, tant le parler de la Louisiane emprunte à la langue voisine.
Il faut d’abord s’habituer au français du Goncourt 1989 : « En moins que rien il avait grab son vieille carabine et, craignant plus la nuit, se jeta au hasard des fardoches. Tant pis les ramponeaux, les griffures des broussailles sur ses mollets de kildi, il sentait pas son sang ». Sauf à consulter un dictionnaire du langage cajun, le sens de certains mots restera secret, mais quelque connaissance de l’anglais aidera souvent, tant le parler de la Louisiane emprunte à la langue voisine.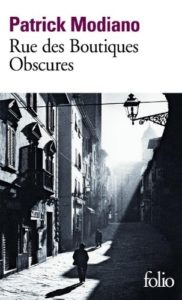 Le Goncourt de l’année 1978 est plus intéressant que captivant. L’interrogation de Guy Roland sur son passé ne s’effectue pas sous le registre de l’émotionnel, car il agit plutôt comme si une simple curiosité le motivait dans ses recherches. Cette distance avec une quête qu’on aurait pu imaginer vécue avec davantage de trouble donne sa portée originale au roman.
Le Goncourt de l’année 1978 est plus intéressant que captivant. L’interrogation de Guy Roland sur son passé ne s’effectue pas sous le registre de l’émotionnel, car il agit plutôt comme si une simple curiosité le motivait dans ses recherches. Cette distance avec une quête qu’on aurait pu imaginer vécue avec davantage de trouble donne sa portée originale au roman.