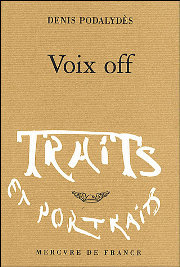 Tant de voix font un homme ; et peut-être plus de voix encore forment un comédien.
Tant de voix font un homme ; et peut-être plus de voix encore forment un comédien.
Les convoquant toutes, Denis Podalydès trace, au filet de ses voix, une manière d’autobiographie, toute en ondulations.
Au commencement, il y a la voix familiale, celle de sa grand-mère maternelle, de sa mère et de ses frères, qui est aussi la sienne lorsqu’il se trouve embarrassé, intimidé, emprunté. Une voix qui monte haut, se réfugie dans les aigus jusque dans le nez.
De la voix de sa grand-mère aussi respectée que crainte lui reviennent ces déjeuners hebdomadaires dans l’immeuble familial versaillais et son positionnement, dès l’enfance, dans la fratrie : il est déjà l’amateur de belles lettres, l’esprit nourri et délicat des quatre garçons.
De la bibliothèque (où il "règne une nostalgie féconde et radieuse, une douceur d’arrière saison, avec cette lame de soleil qui traverse à l’horizontale le salon, à cinq heures du soir au début de l’automne, une douceur de buffet garni, de vieux livres de la NRF…") à la librairie de son aïeule, le jeune Denis ne quitte guère le monde des livres, mais c’est au lycée, auprès d’un camarade de classe lui faisant découvrir Proust dans un passage d‘Albertine disparue ("Que le jour est lent à mourir par ces soirs démesurés de l’été"), qu’il découvre le plaisir incommensurable de poser sa voix dans la littérature et la littérature dans sa voix. S’installe alors en lui, pour ne plus le quitter, le besoin de dire, pour mieux les savourer, les textes aimés.
Si les voix des auteurs classiques ont alimenté et modelé sa voix intérieure, c’est avec celles des grands comédiens qu’il a exercé et trouvé sa voix de scène. Ses écoutes, empreintes d’autant d’attention que d’admiration, ses propres répétitions et imitations ont été et demeurent inlassables. Les évoquer à l’écrit serait vain si elles n’étaient pas perçues et restituées avec la sensibilité de Denis Podalydès, dont on connaît, depuis Scènes de la vie d’acteur, son premier ouvrage, la plume finement travaillée. Les descriptions de voix qu’il nous livre ici sont délicieuses de précisions métaphoriques et soulignent à merveille l’insaisissable matérialité, la puissance d’évocation et les réserves de séduction contenues dans une voix :
Voix de Jean-Louis Trintignant.
Avance à plat jusqu’à la finale, d’un mouvement décisif, régulier, faisant converger la phrase et la mélodie vers le même noeud de sens, qui lui donne sa charge et sa sensualité. Le petit repli délicat, au bout de la dernière syllabe, dit la pointe d’accent du Midi, et délivre en même temps la nuance ironique, amusée, tendre, qui gît dans la voix de Jean-Louis Trintignant. Son mordant est vivace, sa cruauté, infiniment précise, lorsque le rôle réclame qu’il libère les chiens féroces, trop longtemps contenus, de son timbre puissant. (…). Voix tapie prête à bondir, articulée dans une concentration qui parvient à résonner sans sécheresse, voluptueuse.
Voix off
Denis Podalydès
Mercure de France
Collection Traits et portraits
Livre + CD, 250 p., 25 €
 Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café.
Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café. L’Autre est d’abord l’occasion de retrouver à l’écran la magnifique Dominique Blanc, justement récompensée pour ce rôle au festival de Venise.
L’Autre est d’abord l’occasion de retrouver à l’écran la magnifique Dominique Blanc, justement récompensée pour ce rôle au festival de Venise.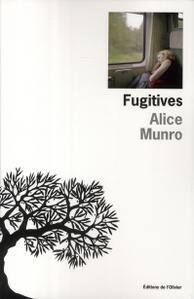 Il existe mille manières de partir. Mais toujours, au départ, il y a cet appel vers l’inconnu ; ou la rencontre de l’inconnu, qui donne envie de tout planter là, et transforme le chemin en fugue.
Il existe mille manières de partir. Mais toujours, au départ, il y a cet appel vers l’inconnu ; ou la rencontre de l’inconnu, qui donne envie de tout planter là, et transforme le chemin en fugue. Une belle corpulence, un pantalon de bleu de travail, des pataugas beige, bretelles et tee-shirt assortis : ainsi se présente Olivier Martin-Salvan, seul en scène (avec pour complice le pianiste Aurélien Richard, lui plutôt filiforme mais pareillement accoutré) pour jouer une heure et quart durant toutes les étapes qui vont précéder une représentation de Carmen.
Une belle corpulence, un pantalon de bleu de travail, des pataugas beige, bretelles et tee-shirt assortis : ainsi se présente Olivier Martin-Salvan, seul en scène (avec pour complice le pianiste Aurélien Richard, lui plutôt filiforme mais pareillement accoutré) pour jouer une heure et quart durant toutes les étapes qui vont précéder une représentation de Carmen. Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois.
Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois. Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «
Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «  Un garçon impossible, de Petter S. Rosenlund (né en Norvège en 1967) a été montée pour la première fois en 1997 au Théâtre Trøndelag. Distinguée par le prix Ibsen 1998, la pièce a depuis été présentée deux fois en France, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis par Stanislas Nordey, puis au Studio Théâtre de la Comédie Française dans une mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2000.
Un garçon impossible, de Petter S. Rosenlund (né en Norvège en 1967) a été montée pour la première fois en 1997 au Théâtre Trøndelag. Distinguée par le prix Ibsen 1998, la pièce a depuis été présentée deux fois en France, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis par Stanislas Nordey, puis au Studio Théâtre de la Comédie Française dans une mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2000. Sur cette ligne de départ (un schéma usé jusqu’à la corde), arrivent Sylvia (Hélène Viaux) et son fils Jim, âgé de huit ans (joué par le longiligne Micha Lescot) pour un prétendu problème d’audition : Jim n’entendrait pas la voix de son grand-père, mort, selon les précisions de Sylvia.
Sur cette ligne de départ (un schéma usé jusqu’à la corde), arrivent Sylvia (Hélène Viaux) et son fils Jim, âgé de huit ans (joué par le longiligne Micha Lescot) pour un prétendu problème d’audition : Jim n’entendrait pas la voix de son grand-père, mort, selon les précisions de Sylvia. Lorsqu’on annonce Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard, on voit les yeux de ses interlocuteurs s’arrondir comme sous l’effet d’une trouble frayeur. Si le cinéaste a sa renommée, l’homme a aussi la sienne, et elle moins flatteuse que la première. Alain Fleischer n’en a eu cure, qui est allé "s’y coller", recueillir auprès du grand maître, à sa demande, ses réflexions sur le cinéma et l’image.
Lorsqu’on annonce Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard, on voit les yeux de ses interlocuteurs s’arrondir comme sous l’effet d’une trouble frayeur. Si le cinéaste a sa renommée, l’homme a aussi la sienne, et elle moins flatteuse que la première. Alain Fleischer n’en a eu cure, qui est allé "s’y coller", recueillir auprès du grand maître, à sa demande, ses réflexions sur le cinéma et l’image. La première des deux expositions présentées jusqu’au 28 février à l’Institut Hongrois de Paris (situé à deux pas du jardin du Luxembourg) concerne un artiste dont l’univers nous est bien familier.
La première des deux expositions présentées jusqu’au 28 février à l’Institut Hongrois de Paris (situé à deux pas du jardin du Luxembourg) concerne un artiste dont l’univers nous est bien familier. A l’étage, l’autre exposition est consacrée à une artiste hongroise peu connue, Júlia Vajda (1913-1982), épouse du peintre Lajos Vajda. En recherche tout au long de sa vie entièrement dédiée à la peinture, Júlia Vajda a exploré différents styles, y compris durant les longues et souterraines années du Rideau de fer. Aujourd’hui, son pays souhaite faire connaître au public hongrois et étranger cette artiste dont l’oeuvre abondante et singulière s’inscrit, malgré l’isolement, dans les courants picturaux européens de son temps.
A l’étage, l’autre exposition est consacrée à une artiste hongroise peu connue, Júlia Vajda (1913-1982), épouse du peintre Lajos Vajda. En recherche tout au long de sa vie entièrement dédiée à la peinture, Júlia Vajda a exploré différents styles, y compris durant les longues et souterraines années du Rideau de fer. Aujourd’hui, son pays souhaite faire connaître au public hongrois et étranger cette artiste dont l’oeuvre abondante et singulière s’inscrit, malgré l’isolement, dans les courants picturaux européens de son temps.