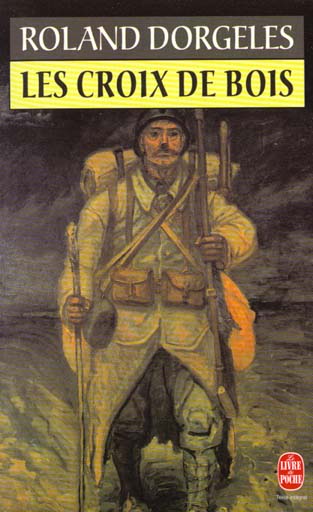
Les croix de bois, ce sont celles que les soldats plantaient hâtivement pour marquer le lieu où ils laissaient les cadavres de leurs camarades morts au cours de la guerre de 14-18. Roland Dorgelès, alors journaliste, mobilisé à 28 ans dès le début des combats, nous a donné un récit sous forme de reportage à la première personne, devenu une des plus fortes œuvres qu’a inspiré la Grande Guerre.
Ce prix Fémina 1919 n’est pas sans rappeler le Goncourt 1916 d’Henri Barbusse, Le Feu. Nombre de thématiques sont identiques : la vie dans les tranchées, les bombardements, l’attaque, le ravitaillement, la distribution du courrier, l’évacuation des blessés, l’infirmerie, et, souvent, la mort. Même étonnement sur l’équipement des soldats, loin de l’uniforme réglementaire : « le bonnet de fausse loutre du père Hamel, le fichu blanc crasseux que Fouillard se nouait autour du cou, le pantalon de Vairon cuirassé de graisse, la pèlerine de Laguy, l’agent de liaison qui avait cousu un col d’astrakan sur un capuchon de zouave… »
Les deux auteurs ne manquent pas de mettre en scène l’exécution « pour l’exemple » du soldat qui dans un moment de faiblesse n’a pas obéi aux ordres. Ici, dans un court chapitre intitulé acidement « Mourir pour la patrie » Dorgelès est très sobre. Car il reste dans le cadre du reportage, il n’a pas besoin d’intrigue, il lui suffit de la guerre comme misérable héroïne. Une guerre où le soldat ignore tout des événements qu’il vit hors des limites de son escouade, une guerre où l’on ne voit rien : « Les betteraves aux hautes fanes et l’herbe folle des champs incultes trempaient les jambes jusqu’aux genoux et tendaient les collets aux pieds pesants. On ne voyait rien. Le monde s’arrêtait à quelques pas, la terre noire et le ciel sombre confondus ».
Ces soldats restent des jeunes gens malgré tout, avec leurs blagues, les facéties qu’ils réservent aux crédules (inénarrable soupe au chocolat), les accents de leur région d’origine, la confiance, malgré l’évidence, qu’ils sortiront vivants de l’enfer : « Mourir, allons donc ! Lui mourra peut-être, et le voisin, et encore d’autres, mais soi, on ne peut pas mourir, soi… Cela ne peut pas se perdre d’un coup cette jeunesse, cette joie, cette force dont on déborde ».
Ils découvrent leur héroïsme lorsqu’ils reviennent de la bataille, vainqueurs, et défilent dans le village : « C’était un hommage de larmes, tout le long des maisons, et c’est seulement en les voyant pleurer que nous comprîmes combien nous avions souffert ».
Andreossi


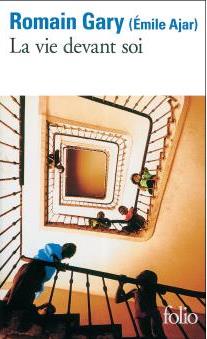
 Quels hommes sont fabriqués par les guerres ? C’est le thème fort du roman de Roger Vercel primé par le jury Goncourt en 1934. Une fois de plus, c’est la guerre de 14-18 qui est le théâtre de l’action, mais les protagonistes sont déplacés cette fois-ci dans les Balkans, juste après l’armistice de novembre 1918.
Quels hommes sont fabriqués par les guerres ? C’est le thème fort du roman de Roger Vercel primé par le jury Goncourt en 1934. Une fois de plus, c’est la guerre de 14-18 qui est le théâtre de l’action, mais les protagonistes sont déplacés cette fois-ci dans les Balkans, juste après l’armistice de novembre 1918.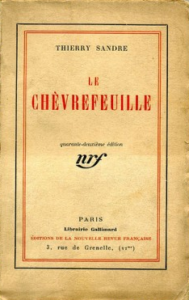 Ce Chèvrefeuille, associé à deux autres courts romans du même auteur, Le Purgatoire et Chapitre XIII d’Athénée, a été couronné par le Goncourt 1924. Il n’a pas laissé un grand souvenir et il est difficile de trouver des arguments pour le sortir de l’oubli, tant son intérêt reste faible, aussi bien du point de vue de l’histoire qu’il raconte que d’une écriture fort banale.
Ce Chèvrefeuille, associé à deux autres courts romans du même auteur, Le Purgatoire et Chapitre XIII d’Athénée, a été couronné par le Goncourt 1924. Il n’a pas laissé un grand souvenir et il est difficile de trouver des arguments pour le sortir de l’oubli, tant son intérêt reste faible, aussi bien du point de vue de l’histoire qu’il raconte que d’une écriture fort banale.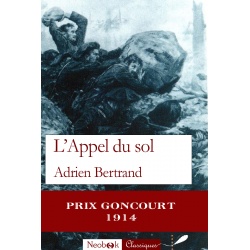 C’est avec deux ans de retard que le prix Goncourt 1914 a été attribué à Adrien Bertrand, qui avait vécu le début de la guerre de 14-18 comme chasseur alpin, puis avait été renvoyé pour raison de santé. Son roman révèle d’incontestables qualités d’écrivain, mais sa carrière est interrompue par la mort dès 1917.
C’est avec deux ans de retard que le prix Goncourt 1914 a été attribué à Adrien Bertrand, qui avait vécu le début de la guerre de 14-18 comme chasseur alpin, puis avait été renvoyé pour raison de santé. Son roman révèle d’incontestables qualités d’écrivain, mais sa carrière est interrompue par la mort dès 1917.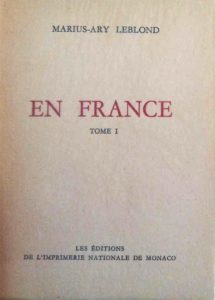 Ce sont deux cousins Réunionnais qui se cachent derrière ce pseudonyme de Marius-Ary Leblond qui obtint le Goncourt en 1909. Le titre est quelque peu trompeur, tant le récit ne concerne de la France que sa capitale, ville où un jeune créole vient effectuer ses études en ce début du XXème siècle. Paris est le lieu de toutes les découvertes, d’une forme de la civilisation « moderne » à une éducation sentimentale qui ouvre de larges horizons.
Ce sont deux cousins Réunionnais qui se cachent derrière ce pseudonyme de Marius-Ary Leblond qui obtint le Goncourt en 1909. Le titre est quelque peu trompeur, tant le récit ne concerne de la France que sa capitale, ville où un jeune créole vient effectuer ses études en ce début du XXème siècle. Paris est le lieu de toutes les découvertes, d’une forme de la civilisation « moderne » à une éducation sentimentale qui ouvre de larges horizons.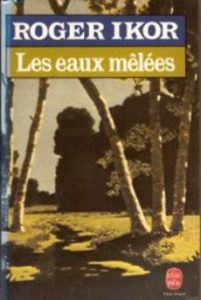 La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant.
La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant.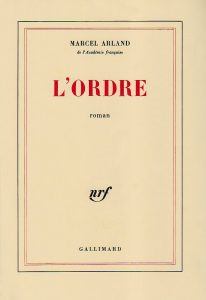 Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.
Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.