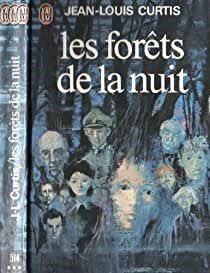 Le prix Goncourt 1947, qui décrit la vie d’une petite ville du sud- ouest de la France sous l’occupation nazie, n’est pas très convaincant. Sous une écriture sans relief, nous sommes tentés de suivre la trajectoire des personnages, mais nous les perdons trop facilement en route ; leur cohérence ne paraît pas non plus toujours évidente, même si on accepte l’idée qu’une période de grande crise bouleverse la vie des gens.
Le prix Goncourt 1947, qui décrit la vie d’une petite ville du sud- ouest de la France sous l’occupation nazie, n’est pas très convaincant. Sous une écriture sans relief, nous sommes tentés de suivre la trajectoire des personnages, mais nous les perdons trop facilement en route ; leur cohérence ne paraît pas non plus toujours évidente, même si on accepte l’idée qu’une période de grande crise bouleverse la vie des gens.
Curtis nous offre la palette des réactions que l’on peut attendre de la diversité des habitants de Saint Clar, dans les Pyrénées , de l’adolescent qui s’engage dans l’aide à la résistance, à la collaboration tranquille avec les Allemands, en passant par le grand bourgeois qui ne se prononce pas, à l’aristocrate déclassé qui réoriente son opinion. Curieusement, c’est du côté des gens modestes que les comportements ne sont guère valorisants : l’une couche avec un officier allemand, son fils participe aux tortures avec la Milice, une bonne dénonce un partisan.
Si la période du roman débute fin 1942, pour une mise en situation assez longuette, c’est le moment de la Libération qui révèle véritablement la nature des protagonistes. Et l’auteur n’est guère tendre avec ses personnages, dont il s’applique à décrire bien davantage les petitesses que la grandeur : « Je ne vous dis pas que les Clarois aiment les Allemands. Je vous dis qu’ils les acceptent, par calcul, intérêt, ou simple veulerie. Et au fond ils se rendent compte, plus ou moins obscurément, que tout ce qu’on leur avait chanté au sujet du Boche, c’était de la blague ».
Le temps de l’Occupation met au jour le caractère fondamentalement détestable des attitudes humaines, ainsi le jour de la libération : « Le ridicule et la sottise s’étalaient un peu partout avec trop de complaisance… Par exemple, ce gras commerçant si bavard et si ouvertement patriote, qui arborait des cocardes sur une bedaine engraissée par quatre ans d’occupation (…) C’était d’une tristesse funèbre, décourageante, c’était un noir nuage nauséeux dans le ciel de ce jour (…) Les forêts de la nuit étaient encore trop proches, leur ombre tenace s’étendait encore sous le soleil de la liberté ».
Ce pessimisme s’étend aussi sur l’avenir, tellement il n’y a rien à attendre de conséquent de ce peuple de Saint Clar : « La colère de ce peuple impuissant s’était résolue en cris inutiles contre de faux coupables et des boucs émissaires (…) Il n’y aurait que le retour des anciennes pantalonnades municipales ou électorales, la continuation d’un statu quo d’injustice et de médiocrité ».
Andreossi
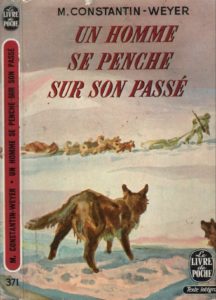 Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ».
Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ».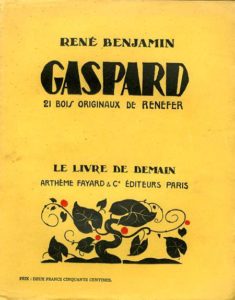 Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18.
Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18. Zelda Fitzgerald est l’héroïne du roman de Gilles Leroy couronné par le prix Goncourt 2007. C’est elle-même qui nous raconte sa vie, d’abord de jeune fille de bonne famille de l’Alabama, puis d’épouse du célèbre écrivain Scott Fitzgerald. Une vie que l’auteur a choisi avec justesse de présenter sous le thème de la difficulté pour une femme de l’époque de parvenir à exister pour elle-même.
Zelda Fitzgerald est l’héroïne du roman de Gilles Leroy couronné par le prix Goncourt 2007. C’est elle-même qui nous raconte sa vie, d’abord de jeune fille de bonne famille de l’Alabama, puis d’épouse du célèbre écrivain Scott Fitzgerald. Une vie que l’auteur a choisi avec justesse de présenter sous le thème de la difficulté pour une femme de l’époque de parvenir à exister pour elle-même.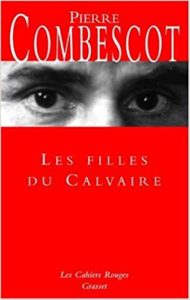 C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent).
C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent).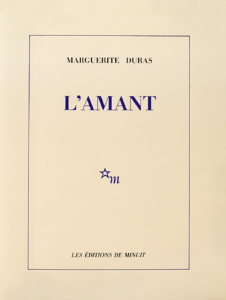 Le Goncourt 1984 se donne nettement comme autobiographique, voulant même prolonger certains écrits antérieurs : « Ici je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements ». Mais le titre choisi met l’accent sur une aventure qui paraît somme toute moins remarquable que révélatrice du rapport de l’auteure à sa famille.
Le Goncourt 1984 se donne nettement comme autobiographique, voulant même prolonger certains écrits antérieurs : « Ici je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements ». Mais le titre choisi met l’accent sur une aventure qui paraît somme toute moins remarquable que révélatrice du rapport de l’auteure à sa famille.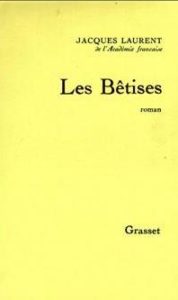 Le Goncourt 1970 ne manque pas d’ambition, surtout lorsque le narrateur confie : « le moment approche où si mon entreprise est réussie le lecteur me connaîtra mieux que moi ». Si Jacques Laurent tente de démêler les rapports complexes entre la vie et l’écriture, le résultat n’est pas tout à fait convaincant.
Le Goncourt 1970 ne manque pas d’ambition, surtout lorsque le narrateur confie : « le moment approche où si mon entreprise est réussie le lecteur me connaîtra mieux que moi ». Si Jacques Laurent tente de démêler les rapports complexes entre la vie et l’écriture, le résultat n’est pas tout à fait convaincant.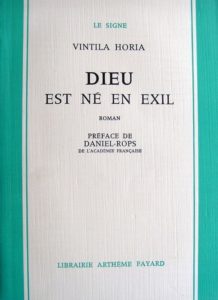 Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.
Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.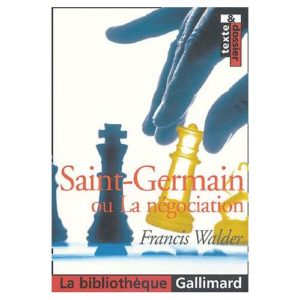 Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.
Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.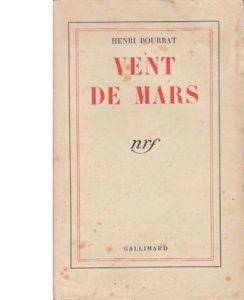 Les premières phrases du prix Goncourt 1941 sont prometteuses : « Les sapins, serrés en bleuissante laine de solitude et d’ennui, dorment sur le songe qui les a arrêtés là, dans cette faille, au bout du monde ». Mais au fur et à mesure de la lecture, le leitmotiv du livre, répété sous toutes les formes, devient lassant, et on se dit que rarement le jury du Goncourt a été aussi opportuniste dans son choix.
Les premières phrases du prix Goncourt 1941 sont prometteuses : « Les sapins, serrés en bleuissante laine de solitude et d’ennui, dorment sur le songe qui les a arrêtés là, dans cette faille, au bout du monde ». Mais au fur et à mesure de la lecture, le leitmotiv du livre, répété sous toutes les formes, devient lassant, et on se dit que rarement le jury du Goncourt a été aussi opportuniste dans son choix.