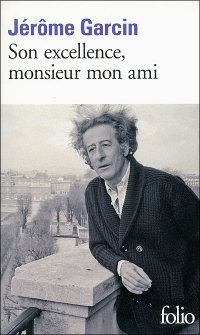 François-Régis Bastide. Un nom séduisant, avec un prénom (d’emprunt) à la fois bien planté et un peu en suspens, un patronyme rassurant, mais qui parle à bien peu de monde aujourd’hui.
François-Régis Bastide. Un nom séduisant, avec un prénom (d’emprunt) à la fois bien planté et un peu en suspens, un patronyme rassurant, mais qui parle à bien peu de monde aujourd’hui.
Aux auditeurs du Masque et la Plume d’avant les années 1980, l’émission de critiques de France-Inter vieille de plus d’un demi-siècle. A ceux qui ont lu, dans le passé, un ouvrage comme les Adieux, prix Femina 1956. Mais les moins de quarante ans sont rares à connaître l’existence même de ce personnage disparu en 1996.
Jérôme Garcin, actuel animateur du Masque et la Plume a entretenu avec cet admirateur et sosie de Cocteau une longue amitié faite de complémentarité bien plus que de gémellité. Il dévoile dans ce livre les multiples facettes de cette figure oubliée, en se livrant à un art dans lequel il excelle : l’art du portrait.
La balade auprès de l’ancien diplomate de François Mitterrand est d’autant plus convaincante qu’elle se méfie de l’hagiographie. François-Régis Bastide, natif de Biarritz, éducation catholique bourgeoise, fou de musique et de culture germanique, se serait rêvé compositeur, de préférence auréolé de gloire. Il a fait éditeur, journaliste dans les arts, ambassadeur élégant, partisan socialiste fidèle, écrivain dilettante.
Adorateur des femmes, il a passé sa vie à les séduire avant de rencontrer l’amour durable, mais c’est sans doute aux hommes qu’il regrette de n’avoir plu assez ; pour commencer, à lui-même.
Alors cet intello-chic de la Rive gauche, qui, comme tous ceux qui se sont figés dans leur style, a fini par être démodé, a trouvé un refuge heureux dans le Var, au milieu des cyprès et des oliviers, prenant les heures aux choses de l’esprit pour les consacrer à la taille, à l’arrosage et au bon temps.
Vie tout en contrastes, émouvante, celle d’un homme qui a cherché sa place dans son monde et son époque, vie presque ordinaire, avec ses zigs-zags, ses désirs et ses frustrations.
En décrivant François-Régis Bastide, en se souvenant de leur profond attachement, Jérôme Garcin dessine aussi en creux une sorte d’auto-portrait, d’une plume fine et douce, fidèle à l’ami autant qu’à lui-même, et empreinte d’une mélancolie bien dans sa veine, que l’on retrouve avec toujours autant de plaisir.
Son excellence, monsieur mon ami
Jérôme Garcin
Gallimard, 16 € (2008) – En folio, 230 p., 6,10 € (2009)

 Le spectacle fait rire, indéniablement, mais une fois le rideau tombé, on se trouve un peu glacé.
Le spectacle fait rire, indéniablement, mais une fois le rideau tombé, on se trouve un peu glacé.
 James Thierrée a impressionné et conquis le public français avec ses précédents spectacles, montrés depuis dix ans dans le monde entier et depuis 2003 chaque année à Paris et en province : "La Symphonie du Hanneton",
James Thierrée a impressionné et conquis le public français avec ses précédents spectacles, montrés depuis dix ans dans le monde entier et depuis 2003 chaque année à Paris et en province : "La Symphonie du Hanneton", 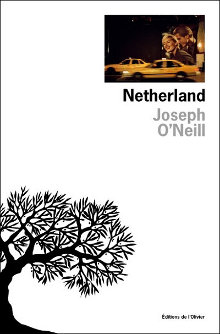 Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions.
Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions. Producteur indépendant à Paris, Grégoire Canvel choisit des films exigeants, le plus souvent refusés par les autres producteurs. Seule la qualité des projets l’intéresse, jeune scénariste inconnu ou réalisateur suédois insupportable.
Producteur indépendant à Paris, Grégoire Canvel choisit des films exigeants, le plus souvent refusés par les autres producteurs. Seule la qualité des projets l’intéresse, jeune scénariste inconnu ou réalisateur suédois insupportable.
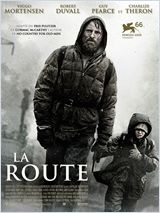 On était curieux de découvrir l’adaptation cinématographique du livre sobre et fort de Cormac McCarthy, La route, Prix Pulitzer 2007 et très grand succès de librairie des deux côtés de l’Atlantique (
On était curieux de découvrir l’adaptation cinématographique du livre sobre et fort de Cormac McCarthy, La route, Prix Pulitzer 2007 et très grand succès de librairie des deux côtés de l’Atlantique (