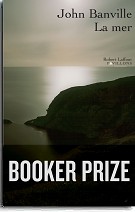 A l’aube de la vieillesse, Max perd son épouse, vaincue par la maladie.
A l’aube de la vieillesse, Max perd son épouse, vaincue par la maladie.
Il décide alors de retourner à Ballymoins, le village de bord de mer où, enfant, il passait ses vacances dans un bungalow avec ses parents.
Là, il s’installe dans la maison qu’un certain été la famille Grace avait louée.
La villa des Cèdres, qui l’avait alors fait tant rêver est aujourd’hui une pension de famille, tenue par Mlle Vavasour.
Cinquante ans se sont écoulés depuis ce fameux été : presque une vie.
De cette vie, de ces cinquante années, on saura peu.
C’est sur ses « extrêmités » que Max s’attarde : sa propre enfance, et la mort de sa femme.
Comme si à chacun de ses moments, le monde avait changé (« Mais, d’ici l’ultime changement, le plus crucial, notre vie ne change-t-elle pas radicalement à chacun des moments qui nous sont donnés de vivre ? » se demande pourtant Max) ; comme si quelque chose s’était alors cristallisé.
Quoi de commun entre ces deux périodes pourtant : d’un côté, la mer, le soleil, les peaux nues de Chloé et Connie Grace ; d’un autre les cliniques, la détresse, la maladie ?
Peut-être ce sentiment de perte, d’abandon ; le deuil à faire, la culpabilité ou les culpabilités, y compris celle d’avoir fui son milieu modeste pour s’élever socialement, d’abord en côtoyant les riches Grace, puis, plus tard, en épousant la fortunée Anna ?
Sur fond de bel été finissant et de station balnéaire presque désertée, Max se « refait » les deux histoires. Il replonge dans une enfance dont la fraîcheur, les découvertes, l’envie, les émois, les troubles sont demeurés parfaitement intacts.
Et des douze derniers mois passés près de sa femme malade, il mesure l’abîme qui s’est alors creusé, insidieusement, au point qu’il se demande, malgré le beau couple qu’ils formaient, si Anna et lui se sont vraiment « connus ».
De son écriture ultra-précise et souvent poétique, John Banville cisèle les émotions au fil du récit.
Le retour, chargé d’intrigue, que le narrateur fait constamment sur son passé, sa magnifique mélancolie (« Quels petits vaisseaux de tristesse nous faisons, à voguer dans ce silence étouffé à travers la pénombre de l’automne ») font de La mer un roman beau et troublant, qui berce en permanence le lecteur entre ses deux pôles qui s’attirent autant qu’ils s’opposent, la vie dans son érotisme le plus fort, et la mort, soudaine et implacable, effrayante.
La mer. John Banville
Traduit de l’anglais (Irlande) par Michèle Albaret-Maatsch
Robert Laffont, Pavillons (2007)
247 p., 20 €
Irlandais, âgé de 62 ans, John Banville a reçu, pour La mer, le prestigieux Booker Prize.