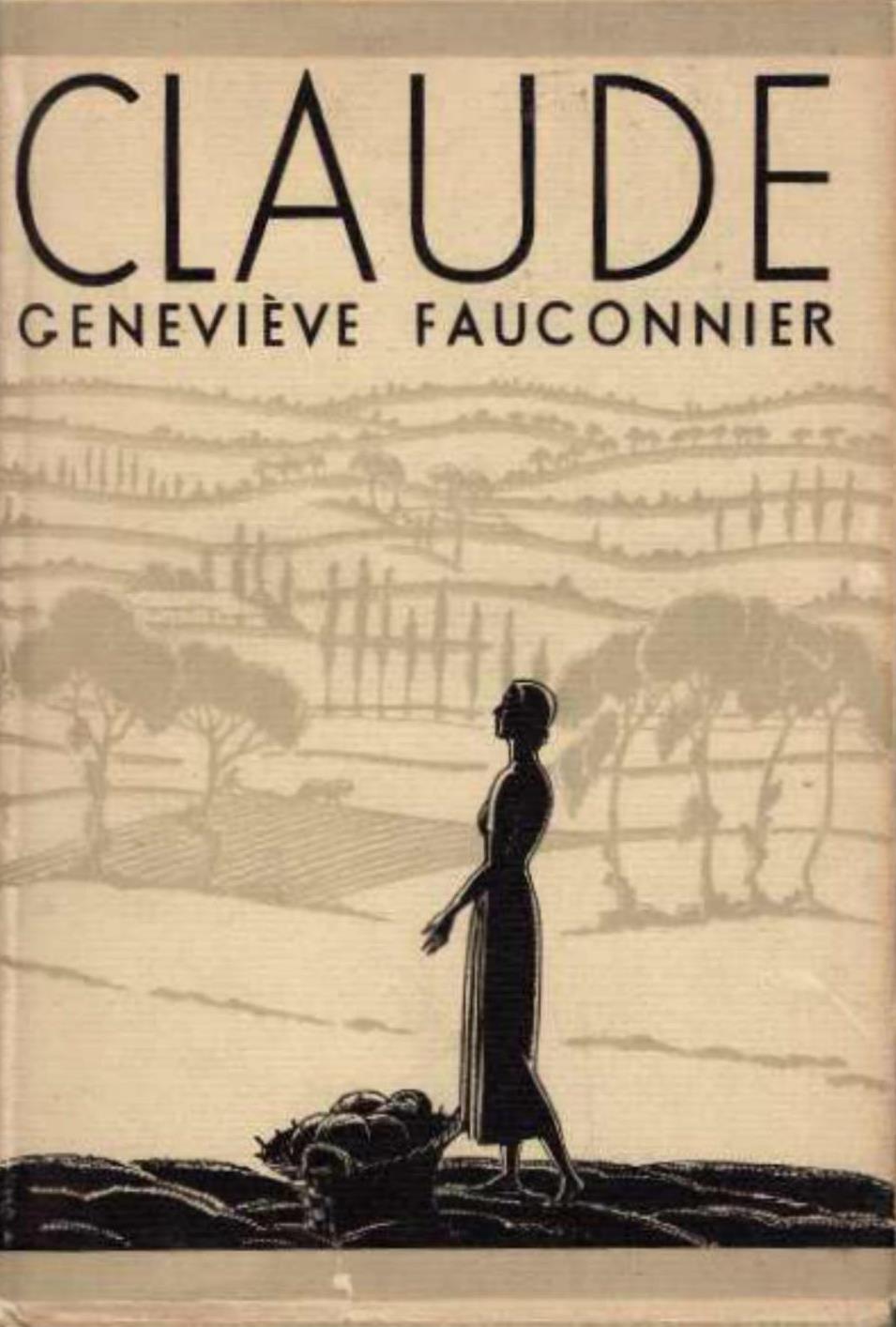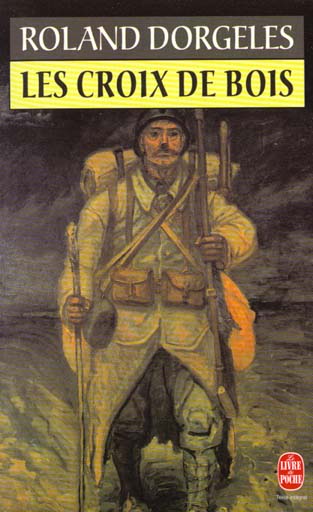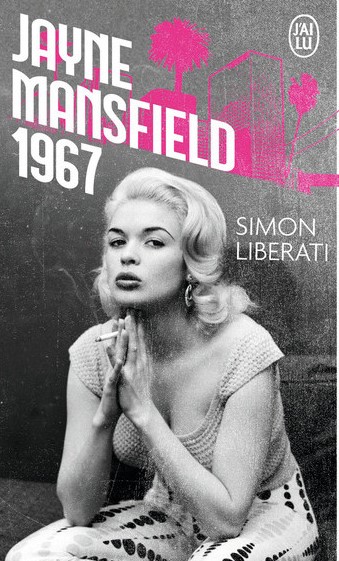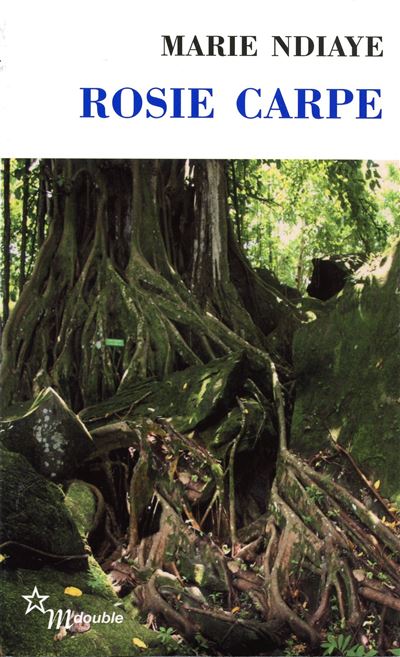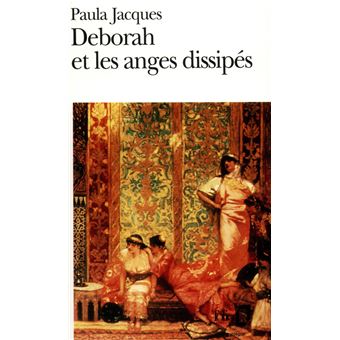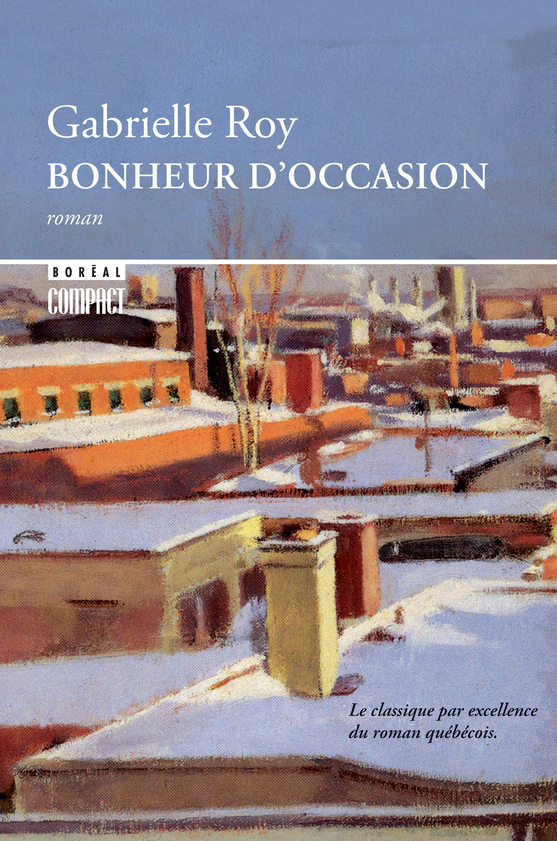
Ce prix Fémina 1947 nous est venu de l’autre côté de l’atlantique. C’est en effet à Montréal que l’autrice nous fait vivre la condition ouvrière, au moment où la deuxième guerre mondiale débute sur le continent européen. Si le roman n’évite pas toujours un ton quelque peu misérabiliste, il nous fait comprendre comment le Québec a pu si rapidement changer de régime démographique.
La famille trop nombreuse, avec dix ou douze enfants par famille, apparaît comme la source essentielle de la pauvreté. Florentine, l’aînée des Lacasse, est serveuse dans un restaurant. Comme son père Azarius, qui rêve toujours de trouver « une meilleure job », elle espère s’évader de la condition familiale que sa mère tente, comme elle le peut, de préserver d’une misère plus grande encore. Florentine rencontre un client du restaurant, jeune homme ambitieux qui se donne les moyens, par l’étude, d’ascension sociale.
Une soirée suffit pour qu’elle se retrouve enceinte, mais elle avait été abandonnée par Jean dès le lendemain. Il n’était pas question qu’il sacrifie son ambition pour une relation durable. Par ailleurs les malheurs s’accumulent : le petit frère Daniel meurt d’une leucémie, la mère part à la recherche d’un nouveau logement, car les Lacasse sont chassés du leur, et elle-même attend son treizième enfant !
La famille évite la catastrophe gare à la guerre qui se déclare à des milliers de kilomètres. C’est le moment en effet où le gouvernement canadien propose un engagement dans l’armée aux hommes du pays. Le père, l’aîné des garçons, et un amoureux de Florentine, qui fera un mari d’occasion, répondent favorablement, soit par intérêt économique, soit par désir de défendre la France : « Si France périssait, déclara-t-il, ça serait comme qui dirait aussi pire pour le monde que si le soleil tombait ».
Mais la guerre apparaît aussi comme une solution au chômage, ainsi pour Pitou qui se retrouve avec un fusil entre les mains : « Pitou ne se désolerait plus d’être un chômeur. Pitou gagnait enfin sa vie, sa vie légère d’oiseau qui demandait si peu (…) Pitou avait entre les mains son premier instrument de travail ».
Si l’écriture sort d’une certaine banalité, c’est grâce aux dialogues, qui ont la saveur du parler populaire montréalais et de ses expressions : « Et v’là betôt cinq ans qu’il est sorti de l’école à coups de pied dans la bonne place et pis qu’y cherche. C’est-y de la justice ça ? (…) Et v’là not’ Pitou qui fume comme un homme, mâche comme un homme, crache comme un homme, mais y a pas gagné une tannante de cenne de toute sa saprée vie. Trouves-tu ça beau toi ? Moi, je trouve ça laite, ben laite ».
Andreossi