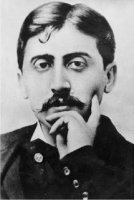 Lors de son séjour de « retour » à Combray, au cours duquel il n’éprouve pas l’émotion qu’il avait espérée, le narrateur séjourne chez Gilberte, la fille de Swann, devenue Mme de Saint-Loup.
Lors de son séjour de « retour » à Combray, au cours duquel il n’éprouve pas l’émotion qu’il avait espérée, le narrateur séjourne chez Gilberte, la fille de Swann, devenue Mme de Saint-Loup.
Le dernier soir de son séjour, Gilberte lui prête « pour lire avant de m’endormir » un volume du journal inédit des Goncourt.
Le passage qu’il en lit le laisse dans une profonde déception quant à la littérature. Du même coup, son incapacité à écrire, qu’il regrette jour après jour depuis son enfance, lui paraît soudain moins grave :
Mon absence de dispositions pour les lettres, pressentie jadis du côté de Guermantes, confirmée durant ce séjour dont c’était le dernier soir (…) me parut quelque chose de moins regrettable, comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde ; et en même temps il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce que j’avais cru.
Après avoir retranscrit le passage du journal des Goncourt, sur un dîner mettant en scène des personnages tels M. et Mme Verdurin, Charles Swann, le duc de Guermantes ou encore le professeur Cottard, que le narrateur pense avoir bien connus, mais dont il ne reconnaît pas les traits dans la description pleine de magnificence ainsi lue, il s’exclame :
Prestige de la littérature ! (…) j’éprouvais un vague trouble. Certes, je ne m’étais jamais dissimulé que je ne savais pas écouter ni, dès que je n’étais plus seul, regarder. (…) Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne, j’avais souvent dîné avec eux, c’était les Verdurin, c’était le duc de Guermantes, c’était les Cottard (…) chacun d’eux m’avait semblé insipide ; je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé…
Mais cette déception vis-à-vis de la littérature, perçue soudain comme impuissante à exprimer la réalité ne sera peut-être que passagère :
Je résolus de laisser provisoirement de côté les objections qu’avaient pu faire naître en moi contre la littérature les pages de Goncourt.
De longues années après, pendant la guerre, lorsqu’il revient à Paris, il trouvera que la vie, même la « vie quotidienne » et la littérature ne sont pas si éloignées, remarquant, à propos du meurtre de Raspoutine…
.. meutre auquel on fut surpris d’ailleurs de trouver un si fort cachet de couleur russe, dans un souper à la Dostoïevsky, parce que la vie nous déçoit tellement que nous finissons par croire que la littérature n’a aucun rapport avec elle et que nous sommes stupéfaits de voir que les précieuses idées que les livres nous ont montrées s’étalent, sans peur de s’abîmer, gratuitement, naturellement, en pleine vie quotidienne, et par exemple qu’un souper, un meurtre, événements russes, ont quelque chose de russe.
Bonne lecture à tous.
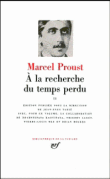 Mme de Guermantes n’est pas « une ».
Mme de Guermantes n’est pas « une ».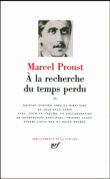 Dans Du côté de Guermantes, le narrateur succombe aux attraits de la vie mondaine, dont il livre de longues descriptions.
Dans Du côté de Guermantes, le narrateur succombe aux attraits de la vie mondaine, dont il livre de longues descriptions.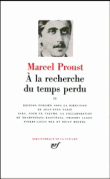 Reçu régulièrement chez les Guermantes, le narrateur a le loisir de détailler tous les ressorts que la duchesse déploie pour mener sa vie mondaine, laquelle est, de même que pour ses semblables, sa principale occupation.
Reçu régulièrement chez les Guermantes, le narrateur a le loisir de détailler tous les ressorts que la duchesse déploie pour mener sa vie mondaine, laquelle est, de même que pour ses semblables, sa principale occupation.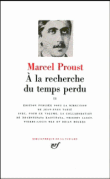 Lorsque le narrateur fait ses débuts dans le monde, il est rapidement et chaleureusement accueilli dans le salon des Guermantes.
Lorsque le narrateur fait ses débuts dans le monde, il est rapidement et chaleureusement accueilli dans le salon des Guermantes.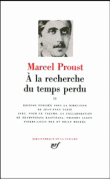 Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.
Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.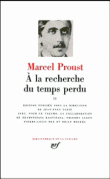 On sait à quel point le narrateur est attaché à sa grand’mère maternelle, qui est la délicatesse même.
On sait à quel point le narrateur est attaché à sa grand’mère maternelle, qui est la délicatesse même.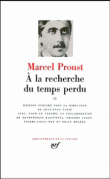 Dans Le côté des Guermantes, la grand’mère du narrateur, à qui il est profondément attaché, tombe malade, puis finit par s’éteindre.
Dans Le côté des Guermantes, la grand’mère du narrateur, à qui il est profondément attaché, tombe malade, puis finit par s’éteindre.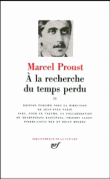 Dans Le côté de Guermantes, le narrateur est régulièrement reçu dans le monde aristocratique, les meilleurs salons de Paris, dont celui de la duchesse de Guermantes.
Dans Le côté de Guermantes, le narrateur est régulièrement reçu dans le monde aristocratique, les meilleurs salons de Paris, dont celui de la duchesse de Guermantes.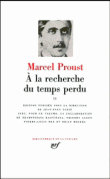 A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.
A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.