 A l’heure où l’on quitte, gonflé de regrets, ses vagues, ses cimes et ses feuillages, d’autres font chauffer les salles parisiennes pour nous préparer une rentrée tout en douceur : c’est l’équipe du Festival d’Automne qui, pour sa 40ème édition, nous a concocté cette année encore un programme aussi riche que pointu.
A l’heure où l’on quitte, gonflé de regrets, ses vagues, ses cimes et ses feuillages, d’autres font chauffer les salles parisiennes pour nous préparer une rentrée tout en douceur : c’est l’équipe du Festival d’Automne qui, pour sa 40ème édition, nous a concocté cette année encore un programme aussi riche que pointu.
Plus de 60 propositions de théâtre, danse, musique, arts plastiques et cinéma nous feront sortir dans de multiples lieux parisiens et franciliens du 15 septembre au 31 décembre.
Comme à l’accoutumée, le 104, le Centre Pompidou, la Cité de la Musique, les théâtres de la Bastille, de la Ville et du Rond-Point, pour n’en citer que quelques uns accueilleront artistes renommés et nouveaux talents venus d’un peu partout dans le monde.
C’est le moment d’ouvrir grand ses yeux, de feuilleter le programme en ligne et de faire sa sélection : des chorégraphes américains aux dramaturges argentins, en passant par la musique mexicaine et les grandes scènes européennes, il y en a pour tous les goûts. Ce sera par exemple l’occasion de découvrir la compagnie DV8 (Dance & Vidéo 8) qui sous l’impulsion de Lloyd Newson agite la scène anglaise depuis 25 ans (théâtre de la Ville du 28 septembre au 6 octobre), ou encore de retrouver le danseur Sud-Africain Steven Cohen (déjà venu au Festival présenter Golgotha en 2009) avec sa pièce The Cradle of Humankind, un lien noué entre l’art contemporain et les origines de l’Homme, la danse faisant ici une incursion du côté des peintures rupestres… (Centre Pompidou du 26 au 29 octobre).
Autre bonne nouvelle, chers lecteurs, dès 3 spectacles réservés – au lieu de 4 – le Festival d’Automne offre aux lecteurs de maglm le tarif abonnés !
Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de se laisser guider. Vous pouvez aussi réserver par téléphone, en précisant que vous êtes lecteur de maglm. Tout simplement !
Très beau Festival et très bel Automne à tous !
Programme, les dates, les lieux : tout savoir sur le Festival
Profiter de l’abonnement spécial partenaires Festival d’Automne
Ou par téléphone au 01 53 45 17 17 du lun. au ven. de 12h à 19h, sam. de 13h à 17h
 Pour son quatrième solo, voici une Michèle Guigon effectivement pieds nus sur scène, au propre comme au figuré ; une Michèle Guigon désarmée, au sens le plus noble, pacifique du terme.
Pour son quatrième solo, voici une Michèle Guigon effectivement pieds nus sur scène, au propre comme au figuré ; une Michèle Guigon désarmée, au sens le plus noble, pacifique du terme.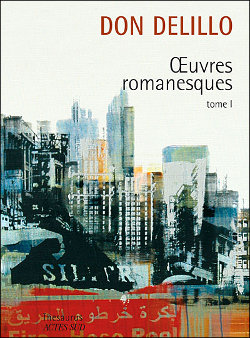 Découvrir le premier roman de Don DeLillo – publié en 1971 – après la lecture de
Découvrir le premier roman de Don DeLillo – publié en 1971 – après la lecture de  Malgré son parcours erratique, l’exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999) jusqu’au 18 septembre au Petit Palais permet, à travers de multiples supports, de se faire une bonne idée de ses créations, de ses sources d’inspiration et des valeurs auxquelles elle est restée fidèle durant sa longue vie.
Malgré son parcours erratique, l’exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999) jusqu’au 18 septembre au Petit Palais permet, à travers de multiples supports, de se faire une bonne idée de ses créations, de ses sources d’inspiration et des valeurs auxquelles elle est restée fidèle durant sa longue vie.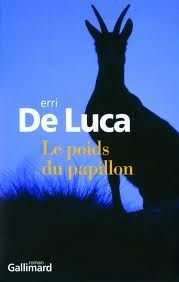 Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ».
Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ». -dans la friche ni silence
-dans la friche ni silence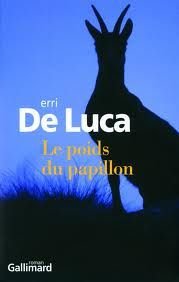 Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ».
Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ».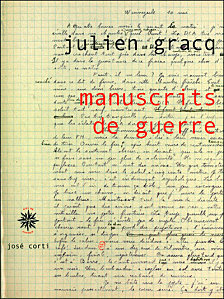 Deux formes d’écriture pour nous conter l’histoire d’une défaite.
Deux formes d’écriture pour nous conter l’histoire d’une défaite.

