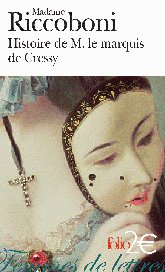 On aime cette série de la collection Folio 2 € (qui propose, pour le prix d’un café, des textes de haute tenue et faciles à emporter), intitulée Femmes de lettres : elle nous a déjà permis de découvrir de jolis petits romans comme Pauline de George Sand ou Les amants d’Avignon d’Elsa Triolet.
On aime cette série de la collection Folio 2 € (qui propose, pour le prix d’un café, des textes de haute tenue et faciles à emporter), intitulée Femmes de lettres : elle nous a déjà permis de découvrir de jolis petits romans comme Pauline de George Sand ou Les amants d’Avignon d’Elsa Triolet.
A l’occasion de la Journée de la Femme, Gallimard a préparé une nouvelle livraison de textes introuvables ou délaissés écrits par des auteurs féminins des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles.
Des noms célèbres comme Mme de Sévigné ou Mme de Lafayette côtoient ici des écrivaines moins connues.
Le moment est donc venu de lire, par exemple, Mme Riccoboni (1713-1792), longtemps actrice à la Comédie-Française, amie de Diderot, et dont les romans rencontrèrent à l’époque un très grand succès.
Dans Histoire de M. le marquis de Cressy, elle raconte l’existence galante et mondaine d’un jeune homme des plus ambitieux qui, pour élever sa fortune, sacrifie la tendresse d’une pure énamourée, avant de piétiner le profond amour d’une très digne femme.
"L’apparence des vertus est bien plus séduisante que les vertus elles-mêmes, et celui qui feint de les avoir a bien de l’avantage sur celui qui les possède" : en dénonçant la redoutable efficacité de l’hypocrisie et de la belle figure, Marie-Jeanne Riccoboni souligne le mal que peut faire à deux nobles âmes un homme empreint de "fausseté".
Face à ce charmant marquis de Cressy, la sincérité et la pureté des sentiments vrais et durables viennent se heurter en permanence au jeu, à la bassesse et à la manipulation : "il affectait un air attendri, pénétré, l’entretenait avec feu d’une ardeur déjà refroidie, et dont les faibles restes n’avaient pour objet que lui-même"…
Porté par le français raffiné et musical du XVIIIème, entre descriptions psychologiques, conversations galantes et billets secrets, ce court roman ne manque ni de saveur :
"Cette espèce de commerce où le caprice et la liberté, tenant la place du sentiment, ôtent à l’amour toutes ces erreurs aimables dont il se nourrit, en font une sorte de goût où le cœur ne prend jamais de part, et qui donne moins de plaisir qu’il ne produit de regret"
…ni d’aphorisme :
"En maltraitant M. de Cressy, elles croyait remplir son devoir ; mais les démarches que la raison nous conseille ne sont pas celles qui donnent le plus de satisfaction à notre cœur"
…encore moins de morale :
"Il fut grand, il fut distingué ; il obtient tous les titres, tous les honneurs qu’il avait désirés : il fut riche, il fut élevé ; mais il ne fut point heureux".
Histoire de M. le marquis de Cressy
Marie-Jeanne Riccoboni
144 p., Folio 2 € Gallimard
Egalement parus en mars 2009, dans la série Femmes de lettres :
Madame d’Agoult Premières années
Madame de Lafayette Histoire de la princesse de Montpensier et autres nouvelles
Madame de Sévigné Je vous écris tous les jours… Premières lettres à sa fille
Madame de Staël Trois nouvelles
Chaque volume de la série Femmes de lettres est présenté par Martine Reid, diplômée de Yale aux Etats-Unis et professeur à l’université de Lille-III.
Le 20 mars prochain, elle organisera à la BNF François Mitterrand une journée d’étude consacrée à la place des femmes dans le discours critique et l’histoire littéraire.
Renseignements sur le site de la Bibliothèque nationale de France.
 Sœur de
Sœur de 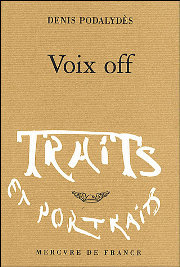 Tant de voix font un homme ; et peut-être plus de voix encore forment un comédien.
Tant de voix font un homme ; et peut-être plus de voix encore forment un comédien. Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café.
Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café. L’Autre est d’abord l’occasion de retrouver à l’écran la magnifique Dominique Blanc, justement récompensée pour ce rôle au festival de Venise.
L’Autre est d’abord l’occasion de retrouver à l’écran la magnifique Dominique Blanc, justement récompensée pour ce rôle au festival de Venise.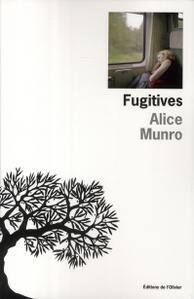 Il existe mille manières de partir. Mais toujours, au départ, il y a cet appel vers l’inconnu ; ou la rencontre de l’inconnu, qui donne envie de tout planter là, et transforme le chemin en fugue.
Il existe mille manières de partir. Mais toujours, au départ, il y a cet appel vers l’inconnu ; ou la rencontre de l’inconnu, qui donne envie de tout planter là, et transforme le chemin en fugue.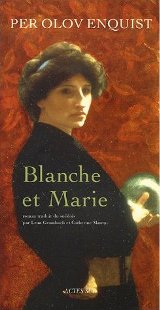 Dans le cœur du roman, on trouve ces deux phrases : « Pas non plus comme l’amour de Blanche pour Charcot, qui est en réalité le sujet que le Livre des Questions déclare traiter. Ce "en réalité" ! ».
Dans le cœur du roman, on trouve ces deux phrases : « Pas non plus comme l’amour de Blanche pour Charcot, qui est en réalité le sujet que le Livre des Questions déclare traiter. Ce "en réalité" ! ». Une belle corpulence, un pantalon de bleu de travail, des pataugas beige, bretelles et tee-shirt assortis : ainsi se présente Olivier Martin-Salvan, seul en scène (avec pour complice le pianiste Aurélien Richard, lui plutôt filiforme mais pareillement accoutré) pour jouer une heure et quart durant toutes les étapes qui vont précéder une représentation de Carmen.
Une belle corpulence, un pantalon de bleu de travail, des pataugas beige, bretelles et tee-shirt assortis : ainsi se présente Olivier Martin-Salvan, seul en scène (avec pour complice le pianiste Aurélien Richard, lui plutôt filiforme mais pareillement accoutré) pour jouer une heure et quart durant toutes les étapes qui vont précéder une représentation de Carmen.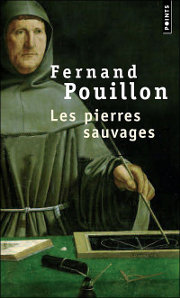 L’abbaye du Thoronet en Provence est un modèle d’abbaye cistercienne : sa visite impressionne par la beauté de l’architecture, faite de simplicité et d’harmonie des proportions.
L’abbaye du Thoronet en Provence est un modèle d’abbaye cistercienne : sa visite impressionne par la beauté de l’architecture, faite de simplicité et d’harmonie des proportions. Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois.
Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois.