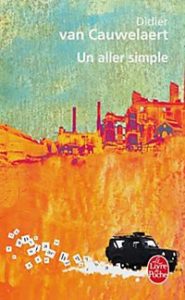 Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages.
Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages.
On l’a appelé Aziz parce qu’on l’a trouvé bébé dans une Ami 6. Elevé par une famille Tsigane, il a des (faux) papiers d’identité marocains et gagne sa vie dans les quartiers Nord de Marseille en travaillant dans le recyclage des autoradios volés. Repéré comme clandestin, il est renvoyé dans un pays, le Maroc, qu’il n’a aucune raison de considérer comme le sien.
C’est un fonctionnaire français, Jean-Pierre, qui le reconduit « chez lui », mais son village d’origine ayant été inventé pour cause d’identité factice, la quête se révèle difficile. Aziz, qui aime raconter des histoires, arrive facilement à convaincre son accompagnateur qu’il vient d’une vallée montagnarde de l’Atlas marocain quasi secrète. Ils sont aidés dans leur recherche par une guide, Valérie, dont les deux hommes tombent amoureux.
A partir du voyage au Maroc, l’histoire devient davantage celle de Jean-Pierre que celle d’Aziz. Récemment abandonné par sa femme, il remet en cause sa vie antérieure et, à l’occasion de l’écriture de son « carnet de mission », envisage d’écrire un roman qu’il baptisera « Un aller simple », car il n’est plus question pour lui de revenir en arrière. Pourtant, lorsque la maladie l’atteint, c’est son passé d’enfance et de jeunesse qui revient, dans sa Lorraine natale victime de la désindustrialisation.
Aziz revient en France ramener le corps de Jean-Pierre, finalement mort avant de découvrir la vallée mystérieuse. Partis d’une affaire de migrant renvoyé « chez lui », nous arrivons en Lorraine et ses anciens hauts fourneaux : « Le savoir-faire centenaire des meilleurs hauts-fournistes d’Europe, qui vendaient leur fonte jusqu’en Amérique, s’est transformé en préretraite, dispense d’activité, reclassement ».
Ainsi le roman dévoile son ambition sociologique, dont nous avions eu un aperçu sans nuances dans les premières pages à propos de certains quartiers de Marseille : « La vie est calme, à Vallon-Fleuri, et les descentes sont rares. Il faut dire qu’un policier qui se mettrait en tête de contrôler les identités dans les quartiers nord, d’abord il serait immédiatement reconduit à la frontière, et puis le préfet lui passerait un savon, parce que la mesure qu’il a prise pour faire baisser la criminalité, le préfet, c’est de décider qu’on n’existe pas ».
Andreossi
Un aller simple. Didier Van Cauwelaert

 Si l’histoire est désormais connue, elle mérite d’être racontée une nouvelle fois et surtout montrée.
Si l’histoire est désormais connue, elle mérite d’être racontée une nouvelle fois et surtout montrée.