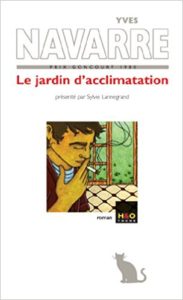 C’est avec intérêt qu’on lit ce roman prix Goncourt de 1980, et avec amusement que l’on découvre certaines formules (« peindre des natures vivantes », ou « la place qui respire à plein poumons morts » ou encore lorsque les malentendus sont plutôt des « mal écoutés ») ; mais malgré ces clins d’œil, le climat du livre reste très pesant, car on assiste, pour la plupart des personnages, à l’impossibilité de faire leur deuil de la perte d’un proche.
C’est avec intérêt qu’on lit ce roman prix Goncourt de 1980, et avec amusement que l’on découvre certaines formules (« peindre des natures vivantes », ou « la place qui respire à plein poumons morts » ou encore lorsque les malentendus sont plutôt des « mal écoutés ») ; mais malgré ces clins d’œil, le climat du livre reste très pesant, car on assiste, pour la plupart des personnages, à l’impossibilité de faire leur deuil de la perte d’un proche.
Et ils sont nombreux et nombreuses à avoir perdu l’être aimé, que ce soit par rupture sentimentale ou par la mort. Le roman découvre la vie d’une fratrie de quatre enfants, de leurs parents et de la sœur du père. Luc a été quitté par son épouse Anne-Marie et n’arrive plus à nouer de relations un tant soit peu suivies : « Anne-Marie couche en travers de ma tête, et prend toute la place. Les années passent. Je n’ai jamais pu me défaire de l’inquiétude du courrier. J’attends toujours d’elle une lettre de retour ». Claire, des années après l’accident qui a coûté la vie à son mari, a gardé les deux oreillers : « un pour Gérard, un pour elle, un oreiller pour poser la tête et l’autre qu’elle serre contre son ventre les nuits durant ».
Sébastien aussi a été largué par sa femme qui a amené avec elle leurs deux enfants, et les tentatives de liaisons, depuis, échouent. La tante Suzy, veuve de son dramaturge de mari, ne pense qu’à faire revivre le théâtre qui a fait le succès du couple, lui comme auteur, elle comme actrice. Tous ces esseulés pour toujours sont aussi en manque de Bertrand, le frère et neveu, ni mort ni vraiment vivant : le père lui a fait subir une opération du cerveau pour en chasser sa passion homosexuelle, qui menaçait sa carrière politique.
Car ces destins tragiques prennent leur origine dans la figure du père. Luc commente une photo : « Un seul ne bouge pas sur la photo de famille. C’est mon père. Il fixe l’objectif. Il me regarde. Il nous regarde. Il est là, comme quelqu’un qui observe une cible pour ne pas la manquer. Il voulait nous réussir ». Aussi les enfants sont passés par le jardin d’acclimatation parisien et son entrée aux miroirs déformants : « Pour nous acclimater, on nous déforme. Dès l’entrée, on nous dit d’en rire (…) Dans ce jardin, il n’y a que des rêves contrariés ».
Le climat du livre est bien lourd, mais l’écriture reste assez alerte pour nous tenir jusqu’au bout.
Andreossi
Le jardin d’acclimatation, Yves Navarre
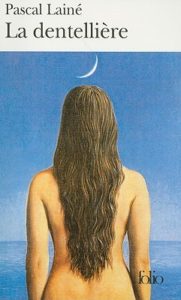 Un Goncourt 1974 vite lu car très court, mais qui laisse bien songeur. Car ce portrait de cette jeune femme, Pomme, nous semble à la fois très suggestif (nous avons l’impression de l’avoir rencontrée), et aussi très incomplet car, comme le narrateur le reconnaît à la fin du roman, nous avons le sentiment d’avoir manqué Pomme.
Un Goncourt 1974 vite lu car très court, mais qui laisse bien songeur. Car ce portrait de cette jeune femme, Pomme, nous semble à la fois très suggestif (nous avons l’impression de l’avoir rencontrée), et aussi très incomplet car, comme le narrateur le reconnaît à la fin du roman, nous avons le sentiment d’avoir manqué Pomme.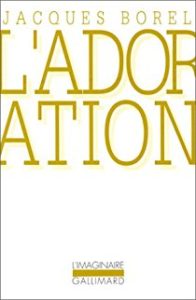 Une grosse autobiographie a eu les honneurs du Goncourt 1965. Ce discours sur soi ne manque pas d’intérêt et l’écriture est impeccable, faite de phrases longues et bien balancées. Bien sûr le lecteur intéressé souscrit aux lois du genre : une vie présentée comme un roman qui serait vrai, hypothèse qui demande d’accepter ce qui n’est, au bout du compte, que l’épanouissement d’un ego sans possibilité de confirmation par les autres protagonistes du roman.
Une grosse autobiographie a eu les honneurs du Goncourt 1965. Ce discours sur soi ne manque pas d’intérêt et l’écriture est impeccable, faite de phrases longues et bien balancées. Bien sûr le lecteur intéressé souscrit aux lois du genre : une vie présentée comme un roman qui serait vrai, hypothèse qui demande d’accepter ce qui n’est, au bout du compte, que l’épanouissement d’un ego sans possibilité de confirmation par les autres protagonistes du roman. Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence.
Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence.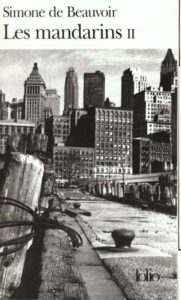 On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis.
On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis.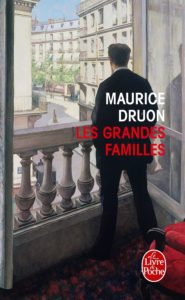 Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.
Un Goncourt 1948 qui ne donne vraiment pas envie de connaître les « Grandes Familles » ! Le sordide imprègne le climat du roman, tant du point de vue des rapports entre les personnages que dans le sentiment d’achèvement de l’histoire de ces castes dont l’accession au pouvoir apparaît comme l’ambition ultime, qu’aucune autre valeur ne peut concurrencer.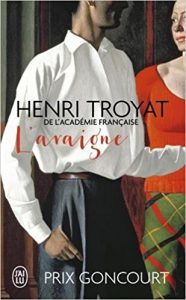 Ce n’est pas que le prix Goncourt 1938 ne se lise pas sans intérêt, car tout au long du roman l’on se demande jusqu’où ira Gérard dans son odieux comportement vis-à-vis de ses sœurs. Mais qu’un tel personnage est pénible à suivre dans les méandres de ses bassesses !
Ce n’est pas que le prix Goncourt 1938 ne se lise pas sans intérêt, car tout au long du roman l’on se demande jusqu’où ira Gérard dans son odieux comportement vis-à-vis de ses sœurs. Mais qu’un tel personnage est pénible à suivre dans les méandres de ses bassesses !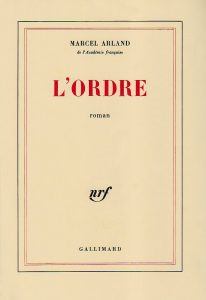 Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.
Un Goncourt 1929 un peu longuet avec ses 540 pages, qui met en parallèle les histoires de deux frères que tout oppose. L’aîné est la droiture même, médecin raisonnable, qui, lancé en politique, conquiert différents échelons du pouvoir au point d’être tout proche d’un poste de ministre. Le cadet s’applique, par son mauvais caractère, par son sentiment constant d’être dévalorisé, par son orgueilleuse ambition pas très bien ciblée, de défaire le peu qu’il arrive à construire.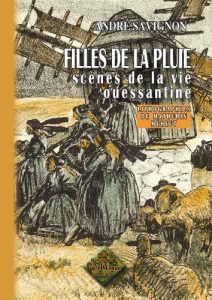 Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain.
Le sous-titre du Goncourt 1912 est explicite : « Scènes de la vie ouessantine ». Savignon ne propose pas un roman mais neuf histoires dont le centre d’intérêt principal sont les îliennes, en particulier dans leur rapport aux hommes, car ceux-ci, en mer ou perdus en mer, ou définitivement partis de l’île, leur ont donné une liberté qui pose question à l’écrivain.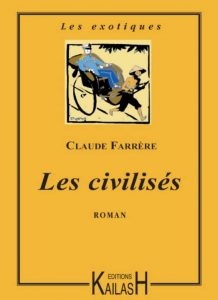 Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.
Un Goncourt 1905 étonnant, dont il est difficile d’imaginer la réception à sa sortie. Il nous faut entendre le titre du roman comme une antiphrase : en milieu colonial, le trio d’amis qui se disent « civilisés » défend un mode de vie à base de débauches : sexe, opium, jeu et saouleries constituent leurs principales activités quotidiennes. Leur capacité à résister à ce qu’ils considèrent comme « barbarie » (amour, honneur, honnêteté) constitue le ressort romanesque.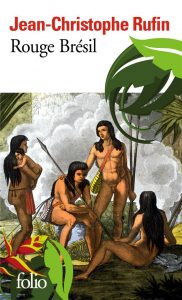 Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant.
Par certains côtés, le Goncourt 2001 nous plonge dans l’univers des romans lus dans notre jeunesse, lorsque des enfants couraient l’aventure, où l’on découvrait leurs origines nobles sous les misères qui les assaillaient, où à la fin de l’histoire ils pouvaient enfin s’aimer comme des amants alors qu’ils étaient donnés comme frères et sœurs depuis le début. Le contraste entre le sérieux du propos (une épopée colonialiste au XVIème siècle) et les recettes du roman feuilleton du XIXème est parfois embarrassant.