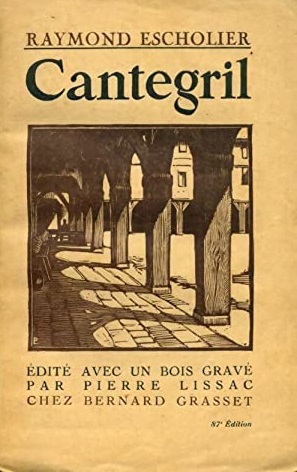
Il manque un nom sur la couverture du roman primé par « La Vie heureuse » (futur Fémina) 1921. C’est celui de Marie-Louise Escholier, car les époux ont en réalité écrit à deux mains la plupart des romans publiés sous le seul nom de Raymond Escholier, dont ce Cantegril. Paradoxe d’un jury féminin, mais il paraît que Marie-Louise n’a accepté d’apparaître publiquement que quelques années plus tard.
Auteur de très nombreux écrits sur l’art (il a été conservateur du musée Victor Hugo et directeur du Petit Palais à Paris) Raymond partageait sa vie entre la capitale et la petite ville de Mirepoix en Ariège, où vivait Marie-Louise. C’est dans cette région que se situent les histoires cocasses de Philou Cantegril, aubergiste qui a appris, enfant, du père Bireben (saint homme dont « les vignes du Seigneur illustraient de leur pourpre insigne sa grosse face glabre de montagnard trapu ») ce qu’était vraiment la vie : la bonne chère, la joie, le rire. A titre personnel il a ajouté quelques aventures galantes.
Treize historiettes nous renvoient dans cet univers que l’on pourrait qualifier de gaulois si le florentin Boccace n’avait montré le chemin dès le 14ème siècle. Les Escholier y joignent la truculence du Midi, et son parler disparu depuis, car on n’entend plus dans le sud-ouest ces expressions occitanes : « Milo Dious », « maquarel », « hil de puto », et autres « biettazé » dont on taira l’étymologie. Un style très alerte aux métaphores qui sentent bon la campagne : « son rire jaillit et pétille comme la mousse d’une bouteille de blanquette, et ses dents apparaissent toutes à la fois, plus blanches que des amandes fraîchement pelées ».
On rira des aventures vécues dans le dernier voyage en diligence avant que le train n’impose son trajet qui ignorera le plaisir de s’arrêter à la moindre occasion pour boire un verre de vin en bonne compagnie, ainsi que des bonnes blagues de Philou Cantegril à ses amis. On sourira lorsque celui-ci, pourtant mécréant, emmène sa vieille mère à la procession de la Fête Dieu. Devant ses voisins étonnés il explique : « J’ai conduit ma sainte mère de reposoir en reposoir, et je disais : Mon Dieu, la voilà. Elle est bien bonne, bien vieille. Son fils vous l’amène, ne l’oubliez plus. Pour les années, il y a bien le compte. Tant de jeunes sont passés devant ». Témoignage d’une société où l’ordre des choses était une valeur à respecter !
Andreossi
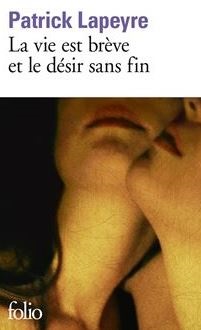
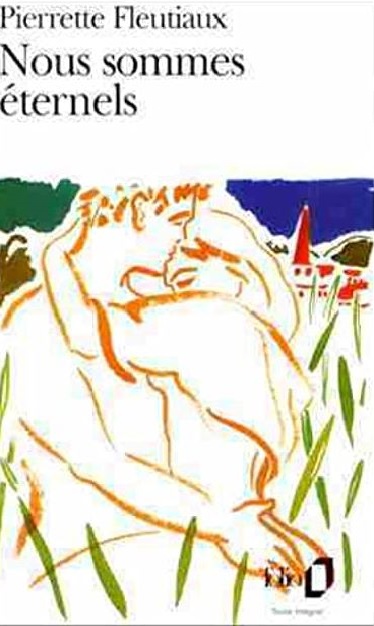
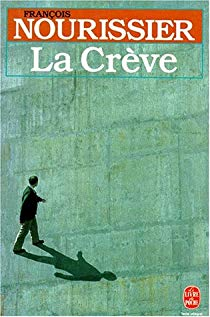
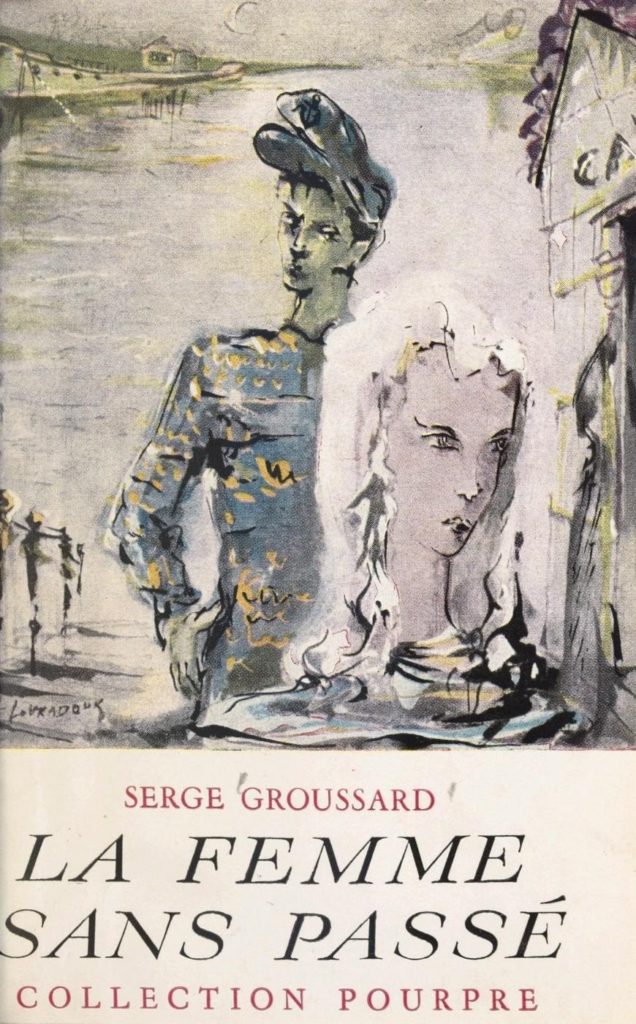
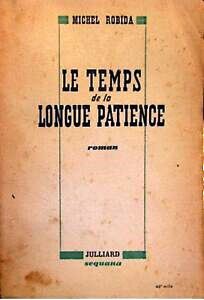
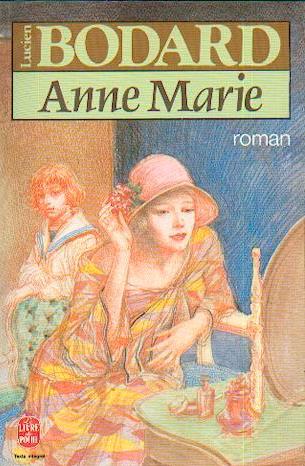
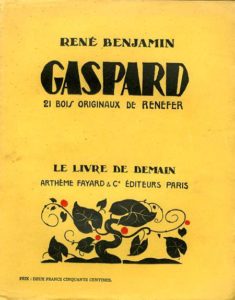 Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18.
Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18.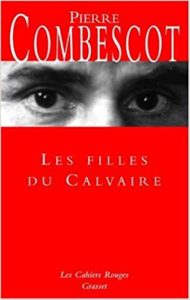 C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent).
C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent). Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964.
Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964. Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.
Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.