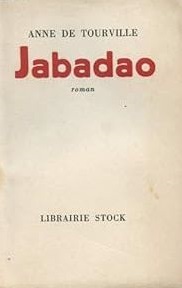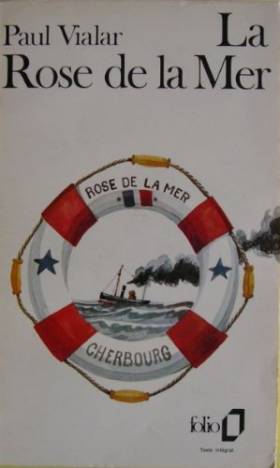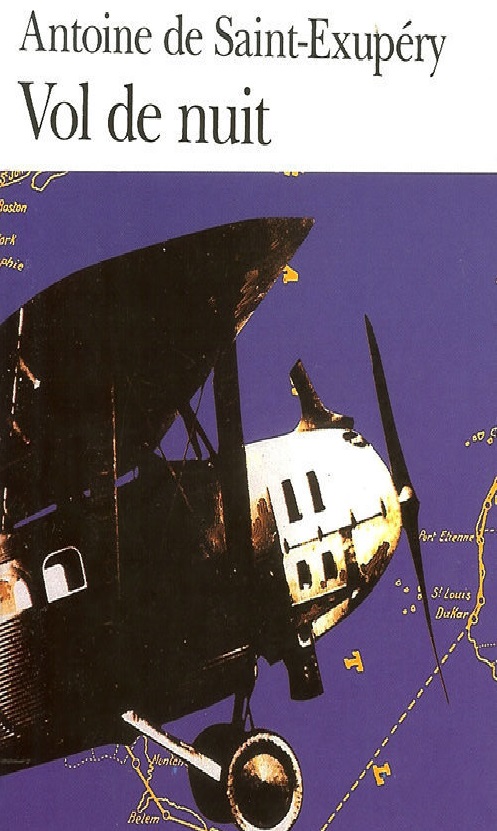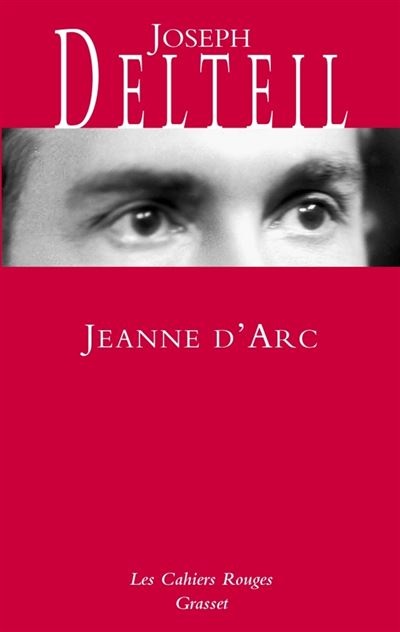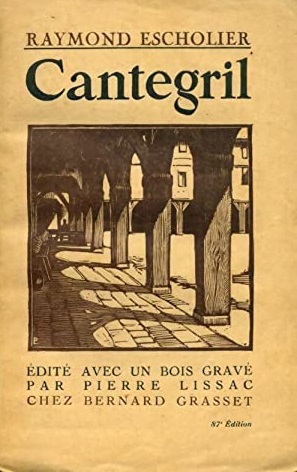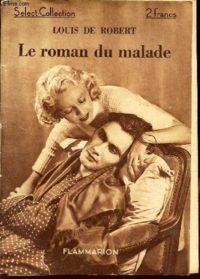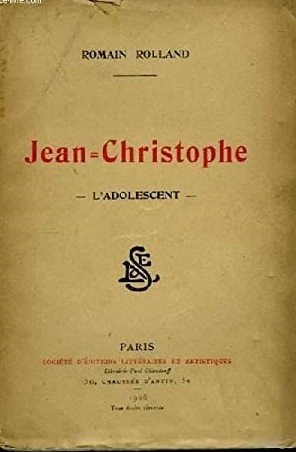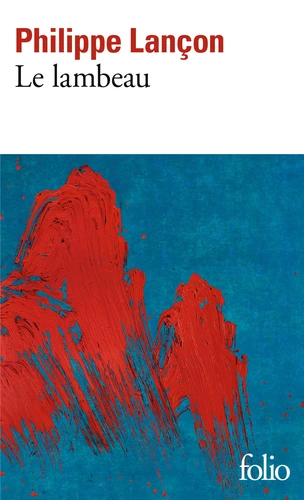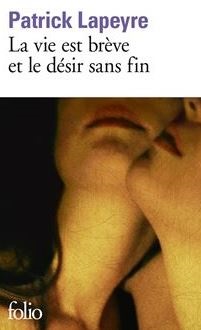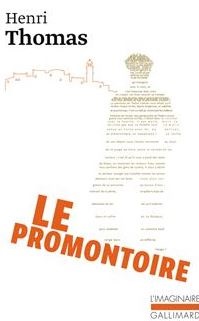
La nouvelle année est déjà là ! Meilleurs vœux à vous tous ! Que 2024 permette à chacune et à chacun de s’accorder des moments « culture » enrichissants, divertissants, étonnants…. que ce soit à travers la littérature comme maglm.fr vous y invite régulièrement, mais encore le théâtre, le cinéma, la peinture, la photo, la sculpture, la danse… Bref, tout ce qui nous fait voir le monde plus grand et nous rend la vie plus douce !
Et pour bien commencer l’année, un nouveau billet de la série des prix Fémina par Andreossi !
Mag.
Les questions que soulève le narrateur du Promontoire ont un aspect philosophique, puisqu’il s’interroge sur la mort, ou sur la vérité. Mais peut-être que l’essentiel de son propos concerne le mystère de l’écriture, car c’est en vivant une expérience personnelle marquante qu’il trouve matière à devenir enfin romancier.
Car il s’agit bien d’un roman, prix Fémina 1961, que nous lisons. Nous saisissons très bien le processus d’enfermement dans (ou par) ce village corse que vit ce traducteur de métier, venu sur l’île avec femme et enfant, mais laissé rapidement seul. Il abandonne ses habitudes, délaisse son travail, se néglige, boit de trop, comme s’il fallait qu’il change de peau pour comprendre les villageois et leur environnement.
A l’occasion de l’enterrement de l’aubergiste qui l’avait accueilli, c’est l’énigme de la mort d’une jeune femme, Diane, qui ressurgit. Le narrateur est maintenant assez inséré dans le village (et coupé de son monde) pour commencer à écrire : « Je suis quelqu’un à qui il arrive quelque chose qu’il ne comprend pas (…) seulement mon point de vue a changé tout récemment, depuis que je suis tombé dans cet espèce de trou (…) Il vaudrait mieux que je lâche carrément l’écriture, mais ce n’est plus possible. D’une certaine manière, elle fait partie de mon feu, de la vapeur de mon vin chaud ».
Le mystère de la mort de Diane le confronte à la question de la vérité, et comment rendre compte de cela ? « Votre cervelle en enregistre cent mille fois plus que votre main ne peut en décrire. Je vois cela, je le dis, et ce n’est pour personne, je suis enfermé avec la vérité ». Au bout du compte, et après une tragédie personnelle, il dépasse ce problème : « Ce n’était pas un crime, ce n’était pas un suicide ; c’était la mort qui se produisait avec une telle facilité qu’en y pensant je tourne dans un espace où tout est d’accord, tout est bien mené, terminé, sans importance ».
Le pouvoir du romancier peut s’exercer pleinement : « J’ai conscience de ce qui nous enferme ensemble, et l’autre cercle dans lequel je suis pris c’est ces mots qui n’arrêtent pas de courir pour imiter ce qui n’est pas directement saisissable, l’idée que personne n’a tué Diane, et que si personne ne l’a tuée il n’y a pas eu de mort ».
Poser des questions difficiles n’empêche pas Henri Thomas d’avoir proposé un roman très lisible et attachant.
Andreossi