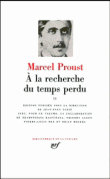 A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.
A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.
Cet instant sera précédé de multiples observations, d’ordre visuel, imaginatif ou purement sensuel :
Mais en laissant mon regard glisser sur le beau globe rose de ses joues, dont les surfaces doucement incurvées venaient mourir aux pieds des premiers plissements de ses beaux cheveux noirs qui couraient en chaînes mouvementées, soulevaient leurs contreforts escarpés et modelaient les ondulations de leurs vallées, je dus me dire : « Enfin, n’y ayant pas réussi à Balbec je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d’Albertine. Et puisque les cercles que nous pouvons faire traverser aux choses et aux êtres, pendant le cours de notre existence, ne sont pas bien nombreux, peut-être pourrai-je considérer la mienne comme en quelque manière accomplie, quand, ayant fait sortir de son cadre lointain le visage fleuri que j’avais choisi entre tous, je l’aurai amené dans ce plan nouveau, où j’aurai enfin de lui la connaissance par les lèvres ».
De longues réflexions pour aboutir soudain au constat :
Mais hélas ! – car pour le baiser, nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres, mal faites – tout d’un coup, mes yeux cessèrent de voir, à son tour mon nez, s’écrasant, ne perçut plus aucune odeur, et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j’appris, à ces détestables signes, qu’enfin j’étais en train d’embrasser la joue d’Albertine.
Le narrateur en est tout étonné, puisque lors d’une première tentative d’obtenir d’elle un baiser, à Balbec, Albertine s’était vivement refusée.
Ce fut tout le contraire. Déjà, au moment où je l’avais couchée sur mon lit et où j’avais commencé à la caresser, Albertine avait pris un air que je ne lui connaissais pas, de bonne volonté docile, de simplicité presque puérile. Effaçant d’elle toutes préoccupations, toutes prétentions habituelles, le moment qui précède le plaisir, pareil en cela à celui qui suit la mort, avait rendu à ses traits rajeunis comme l’innocence du premier âge. Et sans doute tout être dont le talent est soudain mis en jeu, devient modeste, appliqué et charmant ; surtout si, par ce talent, il sait nous donner un grand plaisir, il en est lui-même heureux, veut nous le donner bien complet.
Très bon week-end à tous.
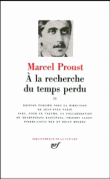 Dans Le côté de Guermantes, le narrateur est régulièrement reçu dans le monde aristocratique, les meilleurs salons de Paris, dont celui de la duchesse de Guermantes.
Dans Le côté de Guermantes, le narrateur est régulièrement reçu dans le monde aristocratique, les meilleurs salons de Paris, dont celui de la duchesse de Guermantes.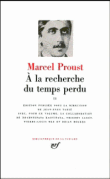 Dans Le côté de Guermantes, le narrateur obtient d’Albertine à Paris ce qu’il avait fortement désiré en vain à Balbec.
Dans Le côté de Guermantes, le narrateur obtient d’Albertine à Paris ce qu’il avait fortement désiré en vain à Balbec. Après le départ de sa femme, Nashe, âgé d’une trentaine d’années laisse sa fille chez sa sœur, quitte son emploi de pompier et, l’héritage de son père en poche, se met à avaler des kilomètres, le volant d’une routière rouge entre les mains.
Après le départ de sa femme, Nashe, âgé d’une trentaine d’années laisse sa fille chez sa sœur, quitte son emploi de pompier et, l’héritage de son père en poche, se met à avaler des kilomètres, le volant d’une routière rouge entre les mains.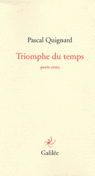 Les contes s’enchaînent sans aucune frontière matérielle.
Les contes s’enchaînent sans aucune frontière matérielle. Les 19èmes Rencontres Cinémas d’Amérique Latine se dérouleront à Toulouse du vendredi 16 au dimanche 25 mars.
Les 19èmes Rencontres Cinémas d’Amérique Latine se dérouleront à Toulouse du vendredi 16 au dimanche 25 mars. Avec La photographie publicitaire en France, de Man Ray à Jean-Paul Goude, le musée de la Publicité met à l’honneur un pan de la création photographique relativement méconnu et considéré généralement comme peu noble.
Avec La photographie publicitaire en France, de Man Ray à Jean-Paul Goude, le musée de la Publicité met à l’honneur un pan de la création photographique relativement méconnu et considéré généralement comme peu noble. Après un voyage au long cours avec Céline, qui emmenait son public sinon au bout de la nuit, au moins au terme d’une excellente soirée, Fabrice Luchini reprend ses lectures pour une Carte blanche originale.
Après un voyage au long cours avec Céline, qui emmenait son public sinon au bout de la nuit, au moins au terme d’une excellente soirée, Fabrice Luchini reprend ses lectures pour une Carte blanche originale. En janvier 1972, huit photographes (Alain Dabgert, Claude Dityvon, Martine Franck, Hervé Gloaguen, François Hers, Richard Kavlar, Jean Lattes, Guy Le Querrec) se réunissent autour d’un projet imprégné de l’esprit de Mai 1968.
En janvier 1972, huit photographes (Alain Dabgert, Claude Dityvon, Martine Franck, Hervé Gloaguen, François Hers, Richard Kavlar, Jean Lattes, Guy Le Querrec) se réunissent autour d’un projet imprégné de l’esprit de Mai 1968. Lorsque Franco s’empare du pouvoir en 1939, Arcadi, artilleur républicain pendant la guerre civile, n’a guère le choix.
Lorsque Franco s’empare du pouvoir en 1939, Arcadi, artilleur républicain pendant la guerre civile, n’a guère le choix.