 Poursuite de la visite de l’exposition-parcours De l’Inde au Japon, dix ans d’acquisitions au Musée Guimet mise en place au Musée des Arts asiatiques jusqu’au 13 décembre pour valoriser plus de 200 acquisitions effectuées entre 1996 et 2006.
Poursuite de la visite de l’exposition-parcours De l’Inde au Japon, dix ans d’acquisitions au Musée Guimet mise en place au Musée des Arts asiatiques jusqu’au 13 décembre pour valoriser plus de 200 acquisitions effectuées entre 1996 et 2006.
La galerie des arts décoratifs de l’Inde, (galerie Jean et Krishna Riboud, du nom des donateurs) rassemble textiles, armes, objets décoratifs et bijoux du XVIème au XIXème siècle. Ils mettent en évidence la splendeur des cours royales et princières de l’Inde et le savoir-faire de leurs artistes et artisans.
On y découvre ce pendentif en forme d’oiseau (peut-être Inde moghole, XVIIème siècle), en or, diamants, rubis, émeraudes, perles et cristal de roche. Il s’agit d’un perroquet aux ailes déployées, certainement doté d’un caractère emblématique, mais dont l’origine demeure matière à conjectures.
Sans nul doute, un splendide bijou.
On profite du passage à la galerie Riboud pour admirer également un lé de soierie avec scènes vishnuites (daté de la fin du XVIème au début du XVIIIème siècle). Provenant du Nord-Est de l’Inde, cette pièce a été retrouvée au Tibet. Elle servait à couvrir les autels ou à envelopper les manuscrits.
Autre beau textile, un Kalamkari avec scènes du Ramayana (Inde du Sud, fin du XVIIIème siècle) en toile de coton teinte, une tenture de temple décorée de scènes mythologiques.
Dans la section du Pakistan et de l’Afghanistan, la collection d’art Gandhara, souvent dit art gréco-bouddhique, s’est enrichie d’oeuvres rares, notamment d’une pièce unique à ce jour, un bodhisattva Avalokitesvara Gandhara (IIIème-Vème siècle) : superbe sculpture en bronze aux incrustations d’argent, montrant un bodhisattva au torse dévêtu et richement paré. (1)
En Chine, impossible de louper la monumentale statue d’un bodhisattva debout (VIème siècle) sculpture en grès rosé de 2,40 mètres de hauteur. Pièce-phare de l’art bouddhique chinois, fidèle à une iconographie fixée en Inde, le bodhisattva, être d’Eveil, distinctement des images du Bouddha, porte le costume et les attributs princiers.
Dans la salle consacrée à la peinture chinoise se déploie le Sûtra du Diamant (1477, « Sûtra de la Perfection de Sagesse coupante comme le diamant ») : livre plié en accordéon de 258 feuillets, il est la copie du Sûtra du Diamant tel qu’il fut donné dans sa première traduction chinoise du sanscrit en 402. Il s’ouvre par une grande illustration en frontispice, figurant le « Buddha prêchant son assemblée brillante ».
De la Chine, on passe à la Corée pour adorer le petit Roi-gardien ou musicien céleste (époque Silla, IX-Xème siècle), superbe sculpture en bronze de l’art bouddhique, représentant un roi gardien au visage enfantin coiffé d’une peau de lion, peut-être un Gandharva, musicien céleste. Une des pièces majeures de la section des arts de Corée.
Toujours en Corée, on peut prendre connaissance des Dix diagrammes du Savoir royal (1568), album de dix pages réalisé à l’époque Choson par Yi Hwang (1501-1570) pour le roi Sonjo, alors âgé de 17 ans. Le Confucianisme est alors érigé en idéologie officielle et Yi Hwang, l’un des artisans les plus actifs de cette « révolution » n’a de cesse de promouvoir le royaume idéal, qui ne peut se faire que par l’éducation du roi. Le système repose sur trois principes fondamentaux : piété filiale, fidélité conjugale et dévouement envers le prince.
On peut terminer ce beau parcours avec la peinture japonaise, devant par exemple le magnifique triptyque Le voyage de vers l’Est de Ariwara no Narihira, encre et couleurs sur soie de Maruyam Okyo (1733-1795), qui a joué un rôle déterminant sur le développement de la peinture japonaise d’époque Edo. Il illustre l’exil du poète Ariwara no Narihira quittant Kyoto et faisant halte au pied du Mont Fuji.
Superbe verticalité, paysage très poétique, on ne peut que savourer cet arrêt majestueux à pied de montagne.
1996-2006, de l’Inde au Japon dix ans d’acquisitions au musée Guimet
Musée national des Arts asiatiques
Exposition-parcours du 13 juin au 13 décembre 2007
6, place d’Iéna – Paris 16ème
M° Iéna, Boissière – RER Pont de l’Alma
Tlj sauf le mardi de 10 h à 18 h
Entrée 6,50 € (TR 4,50 €)
(1) bodhisattva : dans la religion bouddhique, sage ayant franchi tous les degrés de la perfection sauf le dernier qui fera de lui un bouddha.
Image : pendentif en forme d’oiseau Inde moghole ( ?), XVII ème siècle ( ?). Donation Jean et Krishnâ Riboud, 2000 ( MA 6768) © Thierry Ollivier / RMN
 Fin de journée, fatigue, lassitude : assise à une table, la tête dans les mains, vêtue de noir, une vieille dame vient d’enterrer son mari.
Fin de journée, fatigue, lassitude : assise à une table, la tête dans les mains, vêtue de noir, une vieille dame vient d’enterrer son mari. « Les arbres, a dit un sage un peu misanthrope, me consolent des hommes mieux que les animaux, avec lesquels ils ont trop de ressemblance.
« Les arbres, a dit un sage un peu misanthrope, me consolent des hommes mieux que les animaux, avec lesquels ils ont trop de ressemblance. Avec Italie, doubles visions, la Maison européenne de la photographie propose jusqu’au 30 septembre un enrichissant voyage en Italie.
Avec Italie, doubles visions, la Maison européenne de la photographie propose jusqu’au 30 septembre un enrichissant voyage en Italie.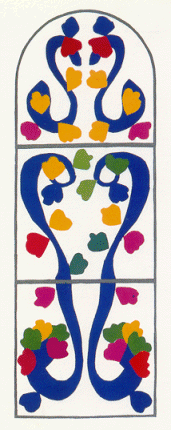 Terre natale d’Henri Matisse (1869-1954), le Cateau-Cambresis (Nord) dispose d’un très beau musée grâce notamment à la donation de quatre-vingt-deux oeuvres que l’artiste fit à sa ville en 1952.
Terre natale d’Henri Matisse (1869-1954), le Cateau-Cambresis (Nord) dispose d’un très beau musée grâce notamment à la donation de quatre-vingt-deux oeuvres que l’artiste fit à sa ville en 1952. Le narrateur est terrassé de chagrin par la mort d’Albertine.
Le narrateur est terrassé de chagrin par la mort d’Albertine. A la fin de La Fugitive, alors que son amour pour Albertine est éteint et qu’aucun autre n’est venu le remplacer, le narrateur apprend le mariage de deux de ses connaissances, son ami Robert de Saint-Loup et le fils Cambremer.
A la fin de La Fugitive, alors que son amour pour Albertine est éteint et qu’aucun autre n’est venu le remplacer, le narrateur apprend le mariage de deux de ses connaissances, son ami Robert de Saint-Loup et le fils Cambremer. Albertine est partie et ne reviendra pas.
Albertine est partie et ne reviendra pas. Au début du Temps retrouvé, le dernier tome de A la recherche du temps perdu, le narrateur retourne à Combray.
Au début du Temps retrouvé, le dernier tome de A la recherche du temps perdu, le narrateur retourne à Combray. Le narrateur finit par faire avec sa mère le voyage à Venise dont il rêvait si fort et depuis si longtemps, auquel il avait même un temps renoncé après la mort d’Albertine.
Le narrateur finit par faire avec sa mère le voyage à Venise dont il rêvait si fort et depuis si longtemps, auquel il avait même un temps renoncé après la mort d’Albertine.