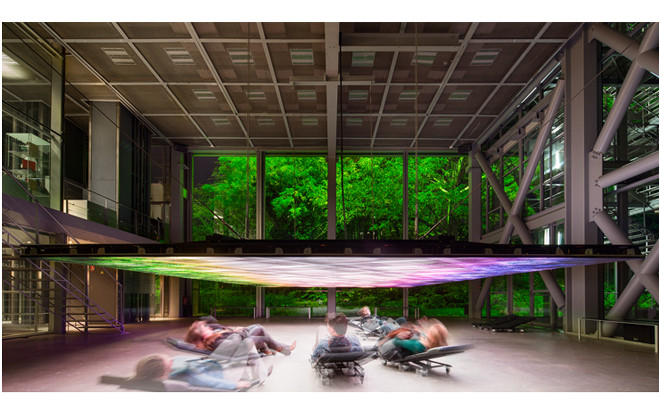C’est entre 1349 et 1354, alors que la peste venait de ravager Florence, que Boccace (1313-1375) écrivit Le Décaméron, ensemble de cent nouvelles racontées en dix jours par dix jeunes hommes et femmes réunis à la campagnes pour échapper à l’affreuse épidémie.
C’est entre 1349 et 1354, alors que la peste venait de ravager Florence, que Boccace (1313-1375) écrivit Le Décaméron, ensemble de cent nouvelles racontées en dix jours par dix jeunes hommes et femmes réunis à la campagnes pour échapper à l’affreuse épidémie.
Plus de quarante ans après avoir été adapté au cinéma par Pasolini, cet écrit en prose fondateur de la littérature italienne et admiré bien au-delà de la frontière transalpine, est mis à l’écran par Paolo et Vittorio Taviani.
Les cinéastes italiens, aujourd’hui octogénaires, ont choisi cinq de ces cent contes, précédés comme dans l’œuvre de Boccace d’une ouverture sur Florence gangrenée par la peste. Ces premières images sont terribles. Un malade se jette du haut du campanile, un père enterre ses enfants, des charrettes entières de cadavres sont déversées dans des fosses. Sans compter la terreur qui transpire partout et fait tour à tour crier puis se taire, courir puis se figer.
Pour en réchapper, sept femmes sont déterminées à quitter Florence. Trois de leurs amoureux les suivent. Réfugiés à la campagne, ils prennent la décision d’essayer d’oublier l’horreur qui frappe leur ville, en profitant de la vie et en se racontant chaque jour une histoire. Cinq contes suivent, tous assez sombres – malgré une farce, non dénuée de dureté – mais qui sont autant d’hymnes à l’amour. La grandeur du sentiment amoureux, poussé au plus haut degré, y est célébré, sous des variations différentes.
Ces contes sont entrecoupés d’épisodes de la vie quotidienne de cette belle jeunesse enivrée de liberté, d’amour, d’amitié, de communion avec la nature. Mais malgré ce désir d’aimer, cet élan vital et ce besoin d’insouciance, comment oublier la tragédie qui frappe les siens ?
Le film des frères Taviani, singulier et intemporel à la fois, est d’une somptuosité affolante. Scénaristiquement, il nous prend dans les filets des contes, hauts en splendeurs comme en noirceur. Esthétiquement, il nous chavire. Il n’y a pas la finesse d’un lin, la couleur d’une robe, la forme d’une coiffe qui ne nous rappelle les tableaux de la Renaissance florentine. Il n’y a pas le bruit mat d’une semelle sur le pavé, le clair obscur d’une demeure, la céramique d’un vaisselier qui ne nous renvoie à un XIV° siècle propice à la rêverie. Au-delà des détails, les compositions elles-mêmes – les scènes de groupes en particulier – sont très picturales. Jeune et belle, la distribution est pleine de talent. Les actrices, gracieuses sous la fluidité de leurs robes, coiffures botticelliennes mais regards déterminés, incarnent parfaitement ce mélange de soumission liée à leur condition et de volonté due à la force de caractère de leurs personnages. Enfin, la campagne toscane, sous d’infinies nuances de lumière, embrasse parfaitement ces variations de l’âme, quand la musique accompagne magnifiquement l’intensité dramatique tout en se faisant oublier quand le récit n’a pas besoin d’elle.
Contes italiens
Réalisé par Paolo et Vittorio Taviani
Avec Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Flavio Parenti, Vittoria Puccini, Lello Arena
Durée 1 h 55
Sorti en salles le 10 juin 2015