L’idée est amusante, le casting sympathique, mais le résultat plutôt décevant.
Martin, ex intello parisien reconverti dans la farine coule des jours calmes – mais peut-être pas si heureux que ça – dans un village normand avec sa sympathique épouse et son fils bourgeonnant. S’il a quitté le milieu de l’édition pour la boulangerie paternelle, il est resté fidèle à la littérature, et particulièrement à Gustave Flaubert, à qui il voue un véritable culte.
Voici qu’il se passe enfin quelque chose d’excitant : l’installation, juste en face de chez lui, de Gemma et Charles Bovery, un couple d’Anglais, dont le nom lui-même met déjà notre rêveur en émoi. Cet émoi n’est rien à côté de celui qui le saisira quand il découvrira la charmante personne de Gemma, sensualité faite femme. Il lui montre comment on fait la pâte ; lui fait déguster ses meilleurs pains ; lui fait goûter le Calva : tout y passe. Il est amoureux en secret. Mais elle, évidemment, elle s’en fiche du Martin, elle est toute à sa joie de sa nouvelle vie avec son mari en Normandie.
Sauf qu’elle est jeune et pétillante, qu’il pleut souvent et que ça reste la campagne. Elle s’ennuie. Tombe à pic un jeune bien-né parisien qui vient passer quelques temps dans le château familial pour tenter d’y étudier quelques lignes de droit. Il a une jolie figure et sait s’y prendre. En deux temps trois mouvements, Gemma trompe son Charles entre ses bras.
Notre Martin observe tout cela et a même tout vu venir puisque son imagination lui fait penser depuis le début que Gemma Bovery est Emma Bovary et que par conséquent son destin est déjà écrit. Là où les choses vont se corser, c’est quand il va vouloir sauver « son » héroïne et se mêler de ce qui ne le regarde pas…
L’originalité et le charme de Gemma Bovery viennent naturellement du rôle de Martin, qui se fait son roman comme d’autres se font des films, et commente en voix off les événements avec l’aplomb de celui qui tient la plume. Le regard de Martin créé un décalage et ce décalage suscite un humour réel. A cet égard, la scène de la rencontre entre Emma et son futur amant devant la boulangerie est très réussie.
Pour le reste, le film ne présente pas grand intérêt. Montrer les rapports humains et de classes de la bonne société de province, Claude Chabrol l’a fait bien avant Anne Fontaine et en beaucoup mieux. La sensualité d’une passion charnelle entre verte prairie et vieille commode, c’est pas du neuf non plus. Quant à l’ingénue en jolie robe face au vieux sage qui saurait tout, ça sent aussi le déjà vu, et ici, comme le reste, tellement appuyé… Les acteurs, pour bons qu’ils soient, ne peuvent jouer que ce qu’on leur donne, en l’occurrence du convenu. On le regrette d’autant plus qu’on adore Fabrice Luchini et qu’on avait beaucoup aimé la charmante Gemma Arterton dans Tamara Drewe, un poil plus sulfureux et surtout d’un comique autrement plus abouti.
Gemma Bovery
Anne Fontaine
Avec Fabrice Luchini, Gemma Arterton, Jason Flemyng
Durée 1 h 39
Sorti en salles le 10 septembre 2014






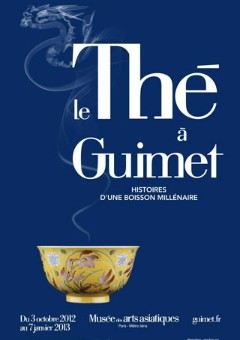 Présentée au musée Guimet, Le thé, histoires d’une boisson millénaire est la première exposition consacrée en France à l’histoire du thé.
Présentée au musée Guimet, Le thé, histoires d’une boisson millénaire est la première exposition consacrée en France à l’histoire du thé.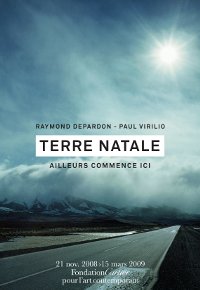
 Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires.
Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires. Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France.
Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France.