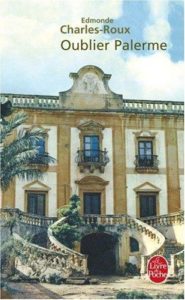 Le Goncourt 1966 récompense Edmonde Charles-Roux pour son premier roman, Oublier Palerme. Deux pôles géographiques se partagent l’intrigue, New York et cette grande ville de Sicile que les protagonistes ne peuvent oublier. Mais si l’intérêt se soutient bien lorsque que l’action se déroule sur l’île, les épisodes new-yorkais provoquent un grand ennui, du fait d’une construction peu convaincante.
Le Goncourt 1966 récompense Edmonde Charles-Roux pour son premier roman, Oublier Palerme. Deux pôles géographiques se partagent l’intrigue, New York et cette grande ville de Sicile que les protagonistes ne peuvent oublier. Mais si l’intérêt se soutient bien lorsque que l’action se déroule sur l’île, les épisodes new-yorkais provoquent un grand ennui, du fait d’une construction peu convaincante.
C’est Ginna, rédactrice dans un grand magazine féminin américain qui nous présente l’essentiel des acteurs du roman et leur vie à New York. Nous apprenons ainsi à connaître Babs et son entourage : rédactrice dans le même journal, elle travaille à répondre à l’ambition bien assumée de la patronne : « Car le tirage de Fair ne dépendait ni de culture, ni de musique, ni d’art (qui étaient les bêtes noires de Fleur Lee) mais seulement de ces fringales féminines que seuls les magazines savent assouvir. Mode, sexualité, voyage, boustifaille, telle était notre formule ».
Un autre univers est représenté par Carmine Bonnavia, jeune élu démocrate, fils d’immigré sicilien originaire de la même région que Ginna. Les deux univers se rencontrent car (et ce n’est pas l’événement le plus vraisemblable du roman) Babs et Carmine se marient. Cette union nous vaut toutefois de quitter New York pour nous conduire à Palerme où enfin démarre une véritable intrigue avec le voyage de noce tragique des deux époux.
La ville prend consistance, la latinité sicilienne s’impose, et Babs est vite écartée du milieu : « Il y avait quelque chose de fantastique à penser qu’elle était arrivée avec cette démarche provocante, son grand rire claironnant, un rire comme pour prendre le monde d’assaut, avec ses attitudes d’une séduction si efficace –jambes croisées haut, genoux au vent- et que rien de tout cela n’avait résisté ». Carmine, de son côté, retrouve ses racines : « Comme il était vite acquis aux penchants latins, cet Américain respectueux de la valeur du temps, soumis à la puissance du travail, de l’argent et si désireux de bien faire ! Quelques jours lui suffirent pour s’organiser dans une passivité orientale ».
C’est la figure d’un jeune vendeur de jasmin, Gigino, qui déchaîne le drame, où meurent Carmine et Gigino. Auparavant Carmine a compris pourquoi il ne pouvait oublier Palerme : « A voir Gigino ainsi, tout douloureux, tout recroquevillé sur lui-même tel un enfant avant la naissance, Carmine prit enfin conscience de ses origines (…) Voilà mon compagnon, mon frère se disait-il. Comment ne l’avais-je pas deviné plus tôt ? ».
Andreossi
Oublier Palerme. Edmonde Charles-Roux
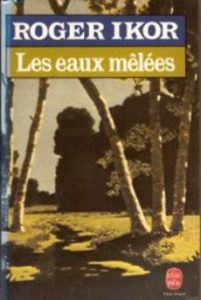 La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant.
La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant.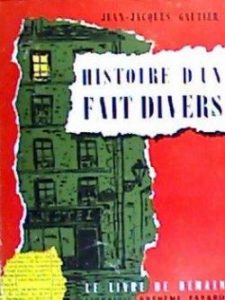 La lecture du Goncourt 1946 nous montre comment l’interprétation de l’assassinat d’une épouse par son conjoint a évolué dans les esprits. Dans l’Histoire d’un fait divers Jean-Jacques Gautier s’évertue à faire comprendre la quasi légitimité de Lucien à tuer Fernande ! Pourtant le lecteur d’aujourd’hui peut découvrir ce que cet acte suppose de rapports asymétriques entre les hommes et les femmes.
La lecture du Goncourt 1946 nous montre comment l’interprétation de l’assassinat d’une épouse par son conjoint a évolué dans les esprits. Dans l’Histoire d’un fait divers Jean-Jacques Gautier s’évertue à faire comprendre la quasi légitimité de Lucien à tuer Fernande ! Pourtant le lecteur d’aujourd’hui peut découvrir ce que cet acte suppose de rapports asymétriques entre les hommes et les femmes.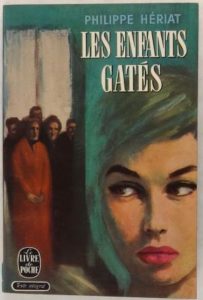 Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel.
Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel.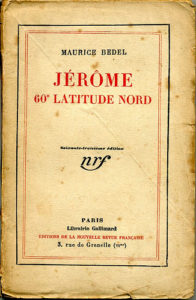 Un roman amusant que le Goncourt 1927. Beaucoup de dialogues, une langue alerte, des caractères bien peu compliqués, une thèse simple, font qu’il se lit sans y penser ; et si au total l’intérêt paraît littérairement mince, on reconnaît qu’il est représentatif de ces années 1920, qui voulaient oublier les horreurs de la première guerre mondiale et ne pas envisager qu’il pourrait y en avoir une seconde.
Un roman amusant que le Goncourt 1927. Beaucoup de dialogues, une langue alerte, des caractères bien peu compliqués, une thèse simple, font qu’il se lit sans y penser ; et si au total l’intérêt paraît littérairement mince, on reconnaît qu’il est représentatif de ces années 1920, qui voulaient oublier les horreurs de la première guerre mondiale et ne pas envisager qu’il pourrait y en avoir une seconde.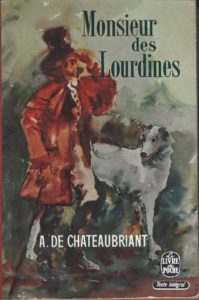 Un Goncourt 1911 bien plaisant à lire, aux métaphores souvent originales et au vocabulaire parfois agréablement vieillot : « L’unique étage s’allongeait sous la carapace ensellée d’une haute et molle toiture, dont l’ardoise, niellée de verdures et de lichens safranés, venait faire visière sur des fenêtres à petits carreaux ; et les murailles étaient tout à fait de la couleur des vieux chemins ».
Un Goncourt 1911 bien plaisant à lire, aux métaphores souvent originales et au vocabulaire parfois agréablement vieillot : « L’unique étage s’allongeait sous la carapace ensellée d’une haute et molle toiture, dont l’ardoise, niellée de verdures et de lichens safranés, venait faire visière sur des fenêtres à petits carreaux ; et les murailles étaient tout à fait de la couleur des vieux chemins ».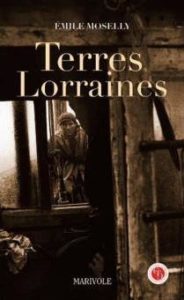 Le Goncourt 1907 n’est pas tout à fait le vrai Goncourt de l’année. C’est Jean des Brebis ou le Livre de la Misère qui avait été élu, mais les jurés se sont aperçus que celui-ci, paru en 1904, n’obéissait pas à un impératif des frères Goncourt : donner leur prix à un ouvrage sorti dans l’année. Ils se sont alors reportés sur Terres Lorraines, du même Moselly, en attribuant le prix aux deux ouvrages.
Le Goncourt 1907 n’est pas tout à fait le vrai Goncourt de l’année. C’est Jean des Brebis ou le Livre de la Misère qui avait été élu, mais les jurés se sont aperçus que celui-ci, paru en 1904, n’obéissait pas à un impératif des frères Goncourt : donner leur prix à un ouvrage sorti dans l’année. Ils se sont alors reportés sur Terres Lorraines, du même Moselly, en attribuant le prix aux deux ouvrages.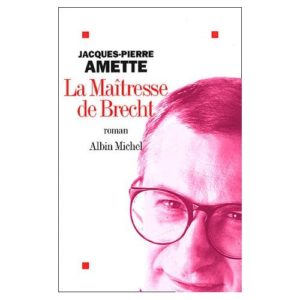 Le prix Goncourt 2003 est un portrait de femme, mais au bout des trois cent pages, Maria Eich garde largement ses mystères pour elle. Qu’est-ce qui a décidé vraiment cette jeune actrice à espionner, pour le compte de la Stasi, le dramaturge Bertold Brecht, en devenant sa maîtresse ? Réelle admiration pour le « Maître » ou rachat politique auprès des autorités de la R.D.A. pour avoir eu pour père et pour mari des nazis partis à l’étranger ? Ou peut-être encore pour l’obtention de facilités pour rendre visite à sa fille, à Berlin Ouest ?
Le prix Goncourt 2003 est un portrait de femme, mais au bout des trois cent pages, Maria Eich garde largement ses mystères pour elle. Qu’est-ce qui a décidé vraiment cette jeune actrice à espionner, pour le compte de la Stasi, le dramaturge Bertold Brecht, en devenant sa maîtresse ? Réelle admiration pour le « Maître » ou rachat politique auprès des autorités de la R.D.A. pour avoir eu pour père et pour mari des nazis partis à l’étranger ? Ou peut-être encore pour l’obtention de facilités pour rendre visite à sa fille, à Berlin Ouest ?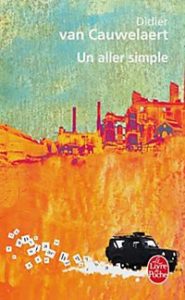 Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages.
Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages.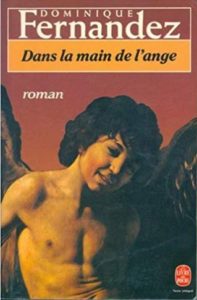 C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70.
C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70.