
Soirée inoubliable vendredi au Théâtre des Champs Elysées à Paris où on assistait au Ritorno d’Ulisse in patria de Claudio Monteverdi (1567-1643). Le Concert d’Astrée, la formation baroque créée par Emmanuelle Haïm en 2000, inaugure cet opéra patiné de près de quatre siècles cette saison dans le théâtre de l’avenue Montaigne.
On retrouve dans cette nouvelle production l’essence du spectacle opératique, tel qu’il a été inventé en Italie au tournant du XVII° siècle : l’union étroite du théâtre, du chant et de la musique, avec ici le mélange de drame et de comédie cher à l’opéra vénitien, une direction d’acteurs-chanteurs précise, une mise en scène soignée, mettant en valeur un livret bien écrit et une séduisante partition.
 Commençons par celle-ci, la musique. Sous la direction posée et sûre d’Emmanuelle Haïm, sa formation resserré, dont l’osmose avec son chef est palpable, joue une interprétation sobre : le travail de Mme Haïm offre à la délicatesse de la musique baroque un écrin de calme et de raffinement dont rien ne semble dépasser.
Commençons par celle-ci, la musique. Sous la direction posée et sûre d’Emmanuelle Haïm, sa formation resserré, dont l’osmose avec son chef est palpable, joue une interprétation sobre : le travail de Mme Haïm offre à la délicatesse de la musique baroque un écrin de calme et de raffinement dont rien ne semble dépasser.
On la voit diriger les chanteurs avec la même détermination et une complicité qui donnent un fort solide résultat. Il faut dire que la distribution est de haut niveau, avec des voix pleines de personnalité. Évacuons tout de suite le sujet du rôle-titre, tenu par le très attendu Rolando Villazón. La critique l’accable, le public prend ce qu’il y a à prendre. Non, il ne séduit pas – plus – par ses « montées », en revanche il émeut tant par le velouté de son phrasé que par son jeu d’acteur, incarnant un Ulysse plein d’humanité, plus fatigué, amoureux et soumis aux dieux que jamais.
 Le reste de la distribution émerveille tant vocalement que scéniquement. Citons d’abord Magdalena Kožená dont la Pénélope est au-dessus même de ce qu’on attend, tant elle restitue la tristesse et la dignité, puis l’alternance de la détermination et du doute, avant que, in fine, l’allégresse des retrouvailles chasse de ses traits et de sa voix les vingt années d’attente écoulées. Puis l’Eumée, le fidèle berger d’Ulysse, de Kresimir Spicer, dont le chant doux et mélodieux n’a d’égal que la justesse du geste. Jörg Schneider est également parfait dans le rôle de son opposé, Irus, bouffon des Prétendants, au-delà du ventru : si dans la première partie il brille par ses talents comiques conformément au rôle, mais aussi par sa voix à la puissance rugissante, celle-ci s’exprime dans de beaux aigus dans le solo de la seconde partie où il pleure, avec la mort des Prétendants, le retour de la faim. Parmi les Prétendants justement, tous très bien, c’est surtout Maarten Engeltjes en Pissandre que l’on a envie de mentionner, tant sa voix de contre-ténor est rafraîchissante et rend l’ensemble plus savoureux encore. Enfin, l’un des plus grands bonheurs de la soirée vient d’Anne-Catherine Gillet, qui campe Minerve / Amour de sa voix cristalline, pleine d’aisance et colorée, et offre une interprétation scénique fort remarquée, tant elle pétille et surprend.
Le reste de la distribution émerveille tant vocalement que scéniquement. Citons d’abord Magdalena Kožená dont la Pénélope est au-dessus même de ce qu’on attend, tant elle restitue la tristesse et la dignité, puis l’alternance de la détermination et du doute, avant que, in fine, l’allégresse des retrouvailles chasse de ses traits et de sa voix les vingt années d’attente écoulées. Puis l’Eumée, le fidèle berger d’Ulysse, de Kresimir Spicer, dont le chant doux et mélodieux n’a d’égal que la justesse du geste. Jörg Schneider est également parfait dans le rôle de son opposé, Irus, bouffon des Prétendants, au-delà du ventru : si dans la première partie il brille par ses talents comiques conformément au rôle, mais aussi par sa voix à la puissance rugissante, celle-ci s’exprime dans de beaux aigus dans le solo de la seconde partie où il pleure, avec la mort des Prétendants, le retour de la faim. Parmi les Prétendants justement, tous très bien, c’est surtout Maarten Engeltjes en Pissandre que l’on a envie de mentionner, tant sa voix de contre-ténor est rafraîchissante et rend l’ensemble plus savoureux encore. Enfin, l’un des plus grands bonheurs de la soirée vient d’Anne-Catherine Gillet, qui campe Minerve / Amour de sa voix cristalline, pleine d’aisance et colorée, et offre une interprétation scénique fort remarquée, tant elle pétille et surprend.
 Voilà pour le geste, voilà pour la voix, voici pour la mise en scène : Mariame Clément mixe les codes et les époques autour de grands décors qui mettent bien en place l’essentiel de l’intrigue et de détails qui viennent la titiller avec humour. On pourrait résumer ainsi : du classique de bon goût réveillé par des surgissements plus pop art – et donc moins consensuels – mais le tout suivant une veine très poétique. Idée inventive et judicieuse : l’Olympe est bien surélevé, mais… n’est autre qu’un troquet où dieux et déesses occupent leur désœuvrement et observent les mortels dont ils font du destin leur joujou en picolant et en jouant aux fléchettes. On est bien loin de l’Olympe de nos imaginaires ! Mais l’ensemble fonctionne fort bien, et l’on s’enchante de ce mariage parfait du chant, de la musique baroque et d’un théâtre plein de merveilleux.
Voilà pour le geste, voilà pour la voix, voici pour la mise en scène : Mariame Clément mixe les codes et les époques autour de grands décors qui mettent bien en place l’essentiel de l’intrigue et de détails qui viennent la titiller avec humour. On pourrait résumer ainsi : du classique de bon goût réveillé par des surgissements plus pop art – et donc moins consensuels – mais le tout suivant une veine très poétique. Idée inventive et judicieuse : l’Olympe est bien surélevé, mais… n’est autre qu’un troquet où dieux et déesses occupent leur désœuvrement et observent les mortels dont ils font du destin leur joujou en picolant et en jouant aux fléchettes. On est bien loin de l’Olympe de nos imaginaires ! Mais l’ensemble fonctionne fort bien, et l’on s’enchante de ce mariage parfait du chant, de la musique baroque et d’un théâtre plein de merveilleux.
Le retour d’Ulysse dans sa patrie, Monteverdi
Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm
Mise en scène : Mariame Clément
Rolando Villazón Ulysse
Magdalena Kožená Pénélope
Katherine Watson Junon
Kresimir Spicer Eumée
Anne-Catherine Gillet L’Amour / Minerve
Isabelle Druet La Fortune / Mélantho
Maarten Engeltjes La Fragilité humaine / Pisandre
Callum Thorpe Le Temps / Antinoüs
Lothar Odinius Jupiter / Amphinome
Jean Teitgen Neptune
Mathias Vidal Télémaque
Emiliano Gonzalez Toro Eurymaque
Jörg Schneider Irus
Elodie Méchain Euryclée
Théâtre des Champs-Elysées
Prochaines représentations : lundi 6, jeudi 9 et lundi 13 mars 2017 à 19 h 30
Puis à l’Opéra de Dijon du vendredi 31 Mars au dimanche 2 Avril 2017

 Merci Jean-Yves de nous faire partager cette soirée unique !
Merci Jean-Yves de nous faire partager cette soirée unique ! 



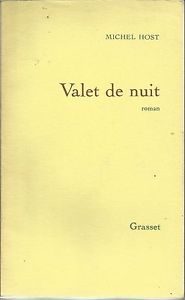 Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.
Les lecteurs du Goncourt 1986 ont peu suivi les jurés : le tirage du livre fut un des plus modestes de l’histoire du prix, et il est aujourd’hui difficile de trouver des échos sur le roman, peu disponible d’ailleurs dans les librairies.
 Commençons par celle-ci, la musique. Sous la direction posée et sûre d’Emmanuelle Haïm, sa formation resserré, dont l’osmose avec son chef est palpable, joue une interprétation sobre : le travail de Mme Haïm offre à la délicatesse de la musique baroque un écrin de calme et de raffinement dont rien ne semble dépasser.
Commençons par celle-ci, la musique. Sous la direction posée et sûre d’Emmanuelle Haïm, sa formation resserré, dont l’osmose avec son chef est palpable, joue une interprétation sobre : le travail de Mme Haïm offre à la délicatesse de la musique baroque un écrin de calme et de raffinement dont rien ne semble dépasser. Le reste de la distribution émerveille tant vocalement que scéniquement. Citons d’abord Magdalena Kožená dont la Pénélope est au-dessus même de ce qu’on attend, tant elle restitue la tristesse et la dignité, puis l’alternance de la détermination et du doute, avant que, in fine, l’allégresse des retrouvailles chasse de ses traits et de sa voix les vingt années d’attente écoulées. Puis l’Eumée, le fidèle berger d’Ulysse, de Kresimir Spicer, dont le chant doux et mélodieux n’a d’égal que la justesse du geste. Jörg Schneider est également parfait dans le rôle de son opposé, Irus, bouffon des Prétendants, au-delà du ventru : si dans la première partie il brille par ses talents comiques conformément au rôle, mais aussi par sa voix à la puissance rugissante, celle-ci s’exprime dans de beaux aigus dans le solo de la seconde partie où il pleure, avec la mort des Prétendants, le retour de la faim. Parmi les Prétendants justement, tous très bien, c’est surtout Maarten Engeltjes en Pissandre que l’on a envie de mentionner, tant sa voix de contre-ténor est rafraîchissante et rend l’ensemble plus savoureux encore. Enfin, l’un des plus grands bonheurs de la soirée vient d’Anne-Catherine Gillet, qui campe Minerve / Amour de sa voix cristalline, pleine d’aisance et colorée, et offre une interprétation scénique fort remarquée, tant elle pétille et surprend.
Le reste de la distribution émerveille tant vocalement que scéniquement. Citons d’abord Magdalena Kožená dont la Pénélope est au-dessus même de ce qu’on attend, tant elle restitue la tristesse et la dignité, puis l’alternance de la détermination et du doute, avant que, in fine, l’allégresse des retrouvailles chasse de ses traits et de sa voix les vingt années d’attente écoulées. Puis l’Eumée, le fidèle berger d’Ulysse, de Kresimir Spicer, dont le chant doux et mélodieux n’a d’égal que la justesse du geste. Jörg Schneider est également parfait dans le rôle de son opposé, Irus, bouffon des Prétendants, au-delà du ventru : si dans la première partie il brille par ses talents comiques conformément au rôle, mais aussi par sa voix à la puissance rugissante, celle-ci s’exprime dans de beaux aigus dans le solo de la seconde partie où il pleure, avec la mort des Prétendants, le retour de la faim. Parmi les Prétendants justement, tous très bien, c’est surtout Maarten Engeltjes en Pissandre que l’on a envie de mentionner, tant sa voix de contre-ténor est rafraîchissante et rend l’ensemble plus savoureux encore. Enfin, l’un des plus grands bonheurs de la soirée vient d’Anne-Catherine Gillet, qui campe Minerve / Amour de sa voix cristalline, pleine d’aisance et colorée, et offre une interprétation scénique fort remarquée, tant elle pétille et surprend. Voilà pour le geste, voilà pour la voix, voici pour la mise en scène : Mariame Clément mixe les codes et les époques autour de grands décors qui mettent bien en place l’essentiel de l’intrigue et de détails qui viennent la titiller avec humour. On pourrait résumer ainsi : du classique de bon goût réveillé par des surgissements plus pop art – et donc moins consensuels – mais le tout suivant une veine très poétique. Idée inventive et judicieuse : l’Olympe est bien surélevé, mais… n’est autre qu’un troquet où dieux et déesses occupent leur désœuvrement et observent les mortels dont ils font du destin leur joujou en picolant et en jouant aux fléchettes. On est bien loin de l’Olympe de nos imaginaires ! Mais l’ensemble fonctionne fort bien, et l’on s’enchante de ce mariage parfait du chant, de la musique baroque et d’un théâtre plein de merveilleux.
Voilà pour le geste, voilà pour la voix, voici pour la mise en scène : Mariame Clément mixe les codes et les époques autour de grands décors qui mettent bien en place l’essentiel de l’intrigue et de détails qui viennent la titiller avec humour. On pourrait résumer ainsi : du classique de bon goût réveillé par des surgissements plus pop art – et donc moins consensuels – mais le tout suivant une veine très poétique. Idée inventive et judicieuse : l’Olympe est bien surélevé, mais… n’est autre qu’un troquet où dieux et déesses occupent leur désœuvrement et observent les mortels dont ils font du destin leur joujou en picolant et en jouant aux fléchettes. On est bien loin de l’Olympe de nos imaginaires ! Mais l’ensemble fonctionne fort bien, et l’on s’enchante de ce mariage parfait du chant, de la musique baroque et d’un théâtre plein de merveilleux. Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur !
Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur ! L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt…
L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt… Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille.
Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille. L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.
L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle. Quand l’hiver nous grisouille l’âme à Paris, pourquoi ne pas aller s’égayer sur la plage ? Cabourg, Nice, Port Grimaud, Monaco… des noms qui nous font bien rêver en ce moment.
Quand l’hiver nous grisouille l’âme à Paris, pourquoi ne pas aller s’égayer sur la plage ? Cabourg, Nice, Port Grimaud, Monaco… des noms qui nous font bien rêver en ce moment. Alors profitons de l’exposition proposée par la Cité de l’Architecture jusqu’au 12 février pour nous plonger dans l’histoire des stations balnéaires. Loin de se limiter à leur architecture (ce qui est du reste drôlement bien restitué à l’aide de nombreux plans, dessins et maquettes), le parcours retrace l’évolution économique et sociale de la fréquentation des bords de mer.
Alors profitons de l’exposition proposée par la Cité de l’Architecture jusqu’au 12 février pour nous plonger dans l’histoire des stations balnéaires. Loin de se limiter à leur architecture (ce qui est du reste drôlement bien restitué à l’aide de nombreux plans, dessins et maquettes), le parcours retrace l’évolution économique et sociale de la fréquentation des bords de mer. Costumes de bains, affiches publicitaires, photos, vidéos, arrêtés de police… la visite est abondamment illustrée. Instructive et distrayante, elle nous apprend comment le développement de l’activité balnéaire a commencé au XVIII° siècle autour de considérations thérapeutiques pour ensuite se déployer à la Belle Époque au profit de la bonne société séduite par les palaces et les casinos, avant d’être accessible aux classes populaires avec l’arrivée des congés payés en 1936.
Costumes de bains, affiches publicitaires, photos, vidéos, arrêtés de police… la visite est abondamment illustrée. Instructive et distrayante, elle nous apprend comment le développement de l’activité balnéaire a commencé au XVIII° siècle autour de considérations thérapeutiques pour ensuite se déployer à la Belle Époque au profit de la bonne société séduite par les palaces et les casinos, avant d’être accessible aux classes populaires avec l’arrivée des congés payés en 1936. Enfin, l’exposition n’oublie pas l’aspect environnemental de l’explosion de la fréquentation du littoral, dont la protection est devenu un enjeu majeur ces dernières décennies.
Enfin, l’exposition n’oublie pas l’aspect environnemental de l’explosion de la fréquentation du littoral, dont la protection est devenu un enjeu majeur ces dernières décennies.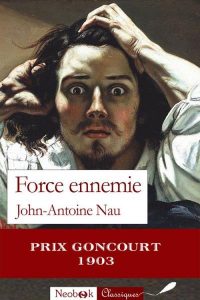 Verrait-on aujourd’hui le jury du prix Goncourt élire un roman publié à compte d’auteur, alors que les éditeurs rivalisent d’ardeur pour mettre en avant leurs favoris ? En 1903, à l’occasion du premier prix Goncourt, c’est pourtant ce qui est arrivé à John Antoine Nau. Et pour le moins à propos d’un livre fort original à divers points de vue.
Verrait-on aujourd’hui le jury du prix Goncourt élire un roman publié à compte d’auteur, alors que les éditeurs rivalisent d’ardeur pour mettre en avant leurs favoris ? En 1903, à l’occasion du premier prix Goncourt, c’est pourtant ce qui est arrivé à John Antoine Nau. Et pour le moins à propos d’un livre fort original à divers points de vue. Revoici un billet maglm, avec le 21ème épisode des Goncourt. Cette semaine : Pascal Quignard ! Merci à Andreossi pour ce très beau billet !
Revoici un billet maglm, avec le 21ème épisode des Goncourt. Cette semaine : Pascal Quignard ! Merci à Andreossi pour ce très beau billet !


