 Dans Le côté de Guermantes, le narrateur fait d’Albertine sa maîtresse, après l’avoir longuement et intensément désirée à Balbec dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs.
Dans Le côté de Guermantes, le narrateur fait d’Albertine sa maîtresse, après l’avoir longuement et intensément désirée à Balbec dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs.
La prisonnière s’ouvre sur une situation totalement bouleversée : profitant de l’absence de ses parents, le narrateur a installé Albertine chez lui.
Il n’en revient pas d’être parvenu à ce qu’il croit acquis, ou plutôt à ce qu’il croit retrouvé : la tendresse de sa mère.
Quand je pense que maintenant que mon amie était venue, à notre retour de Balbec, habiter à Paris sous le même toit que moi, qu’elle avait renoncé à l’idée d’aller faire une croisière, qu’elle avait sa chambre à vingt pas de la mienne, au bout de couloir, dans le cabinet à tapisseries de mon père, et que chaque soir, fort tard, avant de me quitter, elle glissait dans ma bouche sa langue, comme un pain quotidien, comme un aliment nourrissant et ayant le caractère presque sacré de toute chair à qui les souffrances que nous avons endurées à cause d’elle ont fini par conférer une sorte de douceur morale, ce que j’évoque aussitôt par comparaison, ce n’est pas la nuit que le capitaine Borodino me permit de passer au quartier, par une faveur qui ne guérissait en somme qu’un malaise éphémère, mais celle où mon père envoya maman dormir dans le petit lit à côté du mien. Tant la vie, si elle doit une fois de plus nous délivrer, contre toute prévision, de souffrances qui paraissaient inévitables, le fait dans des conditions différentes, opposées parfois, jusqu’au point qu’il y a presque un sacrilège apparent à constater l’identité de la grâce octroyée !
Il pense alors épouser Albertine ; mais n’en est pas pour autant convaincu…
Alors, convalescent affamé qui se repaît déjà de tous les mets qu’on lui refuse encore, je me demandais si me marier avec Albertine ne gâcherait pas ma vie, tant en me faisant assumer la tâche trop lourde pour moi de me consacrer à un autre être qu’en me forçant à vivre absent de moi-même à cause de sa présence continuelle et en me privant à jamais des joies de la solitude.
Très bon week-end, à bientôt.
 Emmanuel Carrère, lassé d’écrire des histoires où il est question d’enfermement et de folie, désireux d’aller « vers le dehors, vers les autres, vers la vie » part en Russie pour y réaliser un reportage.
Emmanuel Carrère, lassé d’écrire des histoires où il est question d’enfermement et de folie, désireux d’aller « vers le dehors, vers les autres, vers la vie » part en Russie pour y réaliser un reportage. Lire la correspondance de Truman Capote (1924-1984) est un vrai régal.
Lire la correspondance de Truman Capote (1924-1984) est un vrai régal.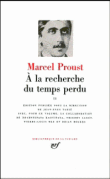 Mme de Guermantes n’est pas « une ».
Mme de Guermantes n’est pas « une ».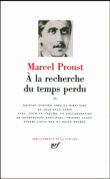 Dans Du côté de Guermantes, le narrateur succombe aux attraits de la vie mondaine, dont il livre de longues descriptions.
Dans Du côté de Guermantes, le narrateur succombe aux attraits de la vie mondaine, dont il livre de longues descriptions. Sous l’occupation, Juliette Noël, dactylo, vit avec tante Aline à Lyon. Toutes deux élèvent José, le petit orphelin catalan que Juliette a adopté.
Sous l’occupation, Juliette Noël, dactylo, vit avec tante Aline à Lyon. Toutes deux élèvent José, le petit orphelin catalan que Juliette a adopté.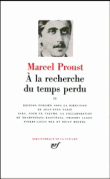 Reçu régulièrement chez les Guermantes, le narrateur a le loisir de détailler tous les ressorts que la duchesse déploie pour mener sa vie mondaine, laquelle est, de même que pour ses semblables, sa principale occupation.
Reçu régulièrement chez les Guermantes, le narrateur a le loisir de détailler tous les ressorts que la duchesse déploie pour mener sa vie mondaine, laquelle est, de même que pour ses semblables, sa principale occupation.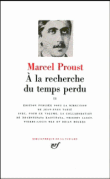 Lorsque le narrateur fait ses débuts dans le monde, il est rapidement et chaleureusement accueilli dans le salon des Guermantes.
Lorsque le narrateur fait ses débuts dans le monde, il est rapidement et chaleureusement accueilli dans le salon des Guermantes.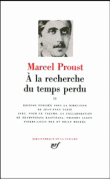 Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.
Lorsque, enfant, le narrateur se promenait avec ses parents autour de Combray, deux promenades s’offraient à la petite famille : le côté de Méséglise et le côté de Guermantes, où se trouvait la propriété de la célèbre lignée, nom qui alimentait chez lui de grands mythes.