 Voici une exposition aussi inédite que fascinante.
Voici une exposition aussi inédite que fascinante.
Heinrich Kühn (1866-1944), photographe allemand du courant pictoraliste, proche des groupes Photo-Club de Paris et Linked Ring à Londres, participant de la Sécession viennoise, demeure en effet relativement peu connu, contrairement à ses contemporains d’avant-garde Alfred Stieglitz et Edward Steichen.
La toute nouvelle exposition de l’Orangerie à Paris, visible jusqu’à fin janvier, est d’ailleurs la première grande rétrospective consacrée à l’artiste. Il est heureux de voir ce long oubli enfin réparé tant les travaux de Kühn témoignent d’expérimentations audacieuses aux résultats très emballants.
Les techniques d’impression photographique qu’il utilise ont pour noms gomme bichromatée, platinotypie, gommogravure, photypie ou encore tirage et report à l’huile… Une pause à mi-parcours les explique.
Malgré leur lecture, pour une grande part, et pour les non-initiés aux secrets du pictoralisme, le mystère reste entier.
Dans quelle mesure s’agit-il de tirages photographiques au sens classique du terme, dans quelle mesure ont-ils été peints ? L’œil a du mal à le déterminer et ce doute, et le léger trouble qu’il engendre, accroissent encore l’attention des visiteurs – assez remarquable de bout en bout.
Après avoir présenté un panorama de ses axes d’investigation, l’exposition suit un fil thématique autour de ses différents modèles, des portraits d’atelier, des natures mortes et des paysages, pour finir avec les autochromes, premier procédé photographique en couleur inventé par les frères Lumières.
Le « plein air » est chez Heinrich Kühn particulièrement enthousiasmant. Les nuances de lumière, les ambiances de clair-obscur à la fin du jour, la « matérialité » des végétaux, l’impression de proximité d’un paysage de montagne, alors même qu’un léger flouté peut border les contours confèrent à ses photographies une admirable force poétique.
L’esthétique est encore sublimée par un sens du cadrage très assuré – le rapprochement avec la peinture de Manet saute aux yeux. On retrouve cet art de la composition dans les portraits, notamment ceux de Mary Warner, qui fut la gouvernante de ses enfants, sa maîtresse et son modèle. Une robe, un sofa, un miroir : alors que la prise risquait le déjà vu ou le surchargé, le résultat est au contraire magnifique d’équilibre, dans les courbes, dans les volumes comme dans l’éclairage.
Lorsqu’il travaille plus intensément sur les effets de lumière – on est chez les impressionnistes ici encore -, il crée des natures mortes simplissimes autour d’un verre d’eau ou d’une carafe, d’une coupe en étain. La transparence scintille, c’est à la fois précis et ouaté, domestique et surnaturel.
Contrairement au célèbre Edward Steichen, Kühn ne s’est lui jamais tourné vers le spectaculaire et le glamour, que ce soit pour ses paysages ou ses portraits ; il a choisi uniquement des sujets familiers. Le regard qu’il leur a porté, inventif, noble et amoureux rend ses œuvres plus émouvantes encore.
Heinrich Kühn
Musée national de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 75001 Paris
TLJ sf mardi de 9 h à 18 h
Entrée (avec musée) 7,5 € (TR 5 €)
Jusqu’au 24 janvier 2010
Exposition organisée par l’Albertina de Vienne en collaboration avec les musées d’Orsay et de l’Orangerie à Paris et le musée des Beaux Arts de Houston
Image : Heinrich Kühn, Nature morte : verres et carafe © DR – RMN (Musée d’Orsay) – Béatrice Hatala
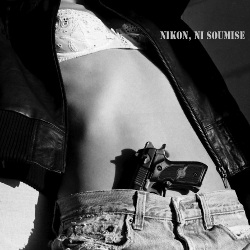 C’est dans l’ambiance feutrée de la place des Vosges à Paris que Chantal Blumann a ouvert en juillet 2009 sa galerie dédiée à l’art contemporain. Elle y expose aussi bien de la peinture, de la photographie, de la sculpture que des comics, avec la volonté "de rendre l’art accessible au plus grand nombre, de faire émerger de nouveaux talents et de proposer des photos numérotées à prix juste". On sent chez cette marchande d’art, en parlant avec elle et en parcourant sa galerie une envie de démocratisation et de désacralisation de l’art qui mettent tout de suite à l’aise.
C’est dans l’ambiance feutrée de la place des Vosges à Paris que Chantal Blumann a ouvert en juillet 2009 sa galerie dédiée à l’art contemporain. Elle y expose aussi bien de la peinture, de la photographie, de la sculpture que des comics, avec la volonté "de rendre l’art accessible au plus grand nombre, de faire émerger de nouveaux talents et de proposer des photos numérotées à prix juste". On sent chez cette marchande d’art, en parlant avec elle et en parcourant sa galerie une envie de démocratisation et de désacralisation de l’art qui mettent tout de suite à l’aise. Que dire face aux photographies de Willy Ronis, tant l’émotion nous serre la gorge devant la simplicité des sujets, mis en valeur par une esthétique si juste ?
Que dire face aux photographies de Willy Ronis, tant l’émotion nous serre la gorge devant la simplicité des sujets, mis en valeur par une esthétique si juste ? Engagé auprès des Communistes, il a photographié les usines textiles et automobiles, a montré les piquets de grève chez Citroën, femme haragant les autres travailleurs, ouvrier brandissant sa fiche de paye, un autre surveillant l’outil de production dans les usines désertées.
Engagé auprès des Communistes, il a photographié les usines textiles et automobiles, a montré les piquets de grève chez Citroën, femme haragant les autres travailleurs, ouvrier brandissant sa fiche de paye, un autre surveillant l’outil de production dans les usines désertées.
 Ces photographies sont présentées pour la première fois en France.
Ces photographies sont présentées pour la première fois en France. La deuxième partie de l’exposition traite précisément de ce sujet, avec les photos que Centelles a prises dans les camps du sud de la France lorsqu’il a dû fuir le régime franquiste avec près d’un demi-million de ses compatriotes en février 1939.
La deuxième partie de l’exposition traite précisément de ce sujet, avec les photos que Centelles a prises dans les camps du sud de la France lorsqu’il a dû fuir le régime franquiste avec près d’un demi-million de ses compatriotes en février 1939. Planète Parr, à voir au site Concorde du Jeu de Paume et dans le jardin des Tuileries jusqu’au 27 septembre, n’est pas une simple exposition de photographies de Martin Parr.
Planète Parr, à voir au site Concorde du Jeu de Paume et dans le jardin des Tuileries jusqu’au 27 septembre, n’est pas une simple exposition de photographies de Martin Parr. Après avoir montré les milieux ouvriers et les classes moyennes, il a consacré ses derniers travaux aux privilégiés de la planète.
Après avoir montré les milieux ouvriers et les classes moyennes, il a consacré ses derniers travaux aux privilégiés de la planète. Dans le cadre de
Dans le cadre de  A Madrid, l’historique et magnifique centre culturel Círculo de Bellas Artes (expositions, théâtre, concerts, cinéma, conférences, récitals de poésie… sans compter librairie et très agréable café) accueille dans le cadre de
A Madrid, l’historique et magnifique centre culturel Círculo de Bellas Artes (expositions, théâtre, concerts, cinéma, conférences, récitals de poésie… sans compter librairie et très agréable café) accueille dans le cadre de 
 Comment clôturer cette série de billets dédiés à au festival
Comment clôturer cette série de billets dédiés à au festival 
 Quotidien vu très différemment avec Karen Knorr et sa série Belgravia : ici est montrée la bourgeoisie anglaise cantonnée dans une zone résidentielle du centre de Londres. Chaque photo est accompagnée d’un texte court qui n’en est pas la description, mais résulte de l’entrevue au cours de laquelle le cliché a été soigneusement préparé. La tranquillité, l’assurance, pour ne pas dire l’arrogance d’une situation et d’un mode de vie privilégiés sont mis en scène avec revendication. Un homme assis dans une chambre tirée à quatre épingles (couvre-lit, tête de lit, murs et plafonds tendus du même tissu) affirme : "Chaque matin, je me lève et je fais 50 pompes. Je mange du müesli et du germe de blé au petit déjeuner. Tu es ce que tu manges."
Quotidien vu très différemment avec Karen Knorr et sa série Belgravia : ici est montrée la bourgeoisie anglaise cantonnée dans une zone résidentielle du centre de Londres. Chaque photo est accompagnée d’un texte court qui n’en est pas la description, mais résulte de l’entrevue au cours de laquelle le cliché a été soigneusement préparé. La tranquillité, l’assurance, pour ne pas dire l’arrogance d’une situation et d’un mode de vie privilégiés sont mis en scène avec revendication. Un homme assis dans une chambre tirée à quatre épingles (couvre-lit, tête de lit, murs et plafonds tendus du même tissu) affirme : "Chaque matin, je me lève et je fais 50 pompes. Je mange du müesli et du germe de blé au petit déjeuner. Tu es ce que tu manges."