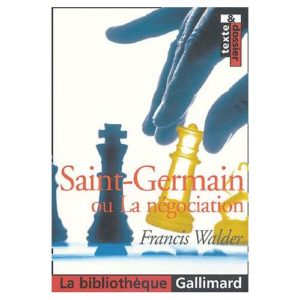 Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.
Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.
Le narrateur est monsieur de Malassise (personnage effectivement historique) chargé par le roi Charles IX de traiter avec le parti huguenot. Il est accompagné d’un militaire, le baron de Biron et ont tous deux comme interlocuteurs deux représentants de l’amiral de Coligny. Un personnage féminin, jeune cousine de de Malassise, passée du côté protestant, intervient dans l’affaire, pour pimenter quelque peu le roman sans l’envahir toutefois.
L’essentiel réside dans les commentaires du négociateur qui nous rend compte de quelques règles utiles en matière de diplomatie. Par exemple ne pas se laisser surprendre par l’imprévu : « J’ai toujours observé qu’en négociation l’élément imprévu est de précieux rapport pour qui sait s’en servir. Chaque délégation vient avec un programme d’idées et d’arguments faits d’avance (…) Dès lors, toute nouveauté, même favorable, sème le trouble dans cet ordre préconçu et produit un moment d’incertitude, dont l’esprit le plus vif tire parti avant les autres ».
Un des points majeurs des pourparlers est celui de la liberté de culte qui sera octroyée à quelques villes. Les deux partis tombent immédiatement d’accord sur Montauban et La Rochelle. Reste à s’entendre sur deux autres villes. De longs marchandages concernent Sancerre et Angoulême, mais finalement sont choisies Cognac et La Charité sur Loire. Entre temps il a fallu déployer beaucoup d’habileté et passer par le cabinet de la reine mère Catherine de Médicis.
Parmi les règles énoncées par de Malassise on retiendra le souci d’aller chercher le contact humain jusque chez l’adversaire : « Malgré tout ce sont des hommes, des hommes, sensibles par conséquent à ce qui est humain, et le sort des négociations huguenotes dépend de leurs sensibilités, comme dépend de la mienne celui des négociations royales. Les connaître, les faire parler d’eux, les amener à s’ouvrir ».
Et puis c’est le militaire de Biron qui rappelle la raison fondamentale de ces rencontres : « La guerre, dit-il, couvre des choses affreuses, vous le savez, mais qui sont vraies, et cela ne se sait pas suffisamment. On ne peut pas les traiter comme des idées. Les cadavres dans les champs, cela existe réellement, et cela ne ressemble à rien de ce que vous connaissez ».
Deux ans après cet accord de paix, c’est le massacre de la Saint Barthélémy.
Andreossi
Saint Germain ou la négociation, Francis Walder
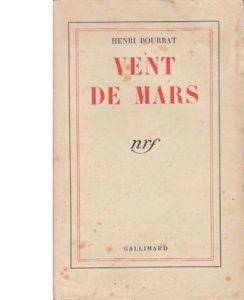 Les premières phrases du prix Goncourt 1941 sont prometteuses : « Les sapins, serrés en bleuissante laine de solitude et d’ennui, dorment sur le songe qui les a arrêtés là, dans cette faille, au bout du monde ». Mais au fur et à mesure de la lecture, le leitmotiv du livre, répété sous toutes les formes, devient lassant, et on se dit que rarement le jury du Goncourt a été aussi opportuniste dans son choix.
Les premières phrases du prix Goncourt 1941 sont prometteuses : « Les sapins, serrés en bleuissante laine de solitude et d’ennui, dorment sur le songe qui les a arrêtés là, dans cette faille, au bout du monde ». Mais au fur et à mesure de la lecture, le leitmotiv du livre, répété sous toutes les formes, devient lassant, et on se dit que rarement le jury du Goncourt a été aussi opportuniste dans son choix.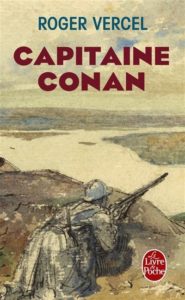 Quels hommes sont fabriqués par les guerres ? C’est le thème fort du roman de Roger Vercel primé par le jury Goncourt en 1934. Une fois de plus, c’est la guerre de 14-18 qui est le théâtre de l’action, mais les protagonistes sont déplacés cette fois-ci dans les Balkans, juste après l’armistice de novembre 1918.
Quels hommes sont fabriqués par les guerres ? C’est le thème fort du roman de Roger Vercel primé par le jury Goncourt en 1934. Une fois de plus, c’est la guerre de 14-18 qui est le théâtre de l’action, mais les protagonistes sont déplacés cette fois-ci dans les Balkans, juste après l’armistice de novembre 1918.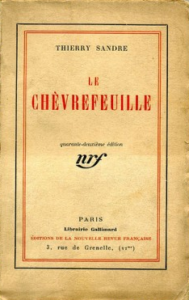 Ce Chèvrefeuille, associé à deux autres courts romans du même auteur, Le Purgatoire et Chapitre XIII d’Athénée, a été couronné par le Goncourt 1924. Il n’a pas laissé un grand souvenir et il est difficile de trouver des arguments pour le sortir de l’oubli, tant son intérêt reste faible, aussi bien du point de vue de l’histoire qu’il raconte que d’une écriture fort banale.
Ce Chèvrefeuille, associé à deux autres courts romans du même auteur, Le Purgatoire et Chapitre XIII d’Athénée, a été couronné par le Goncourt 1924. Il n’a pas laissé un grand souvenir et il est difficile de trouver des arguments pour le sortir de l’oubli, tant son intérêt reste faible, aussi bien du point de vue de l’histoire qu’il raconte que d’une écriture fort banale.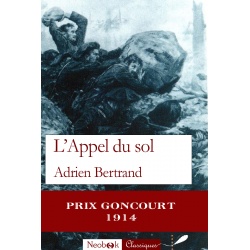 C’est avec deux ans de retard que le prix Goncourt 1914 a été attribué à Adrien Bertrand, qui avait vécu le début de la guerre de 14-18 comme chasseur alpin, puis avait été renvoyé pour raison de santé. Son roman révèle d’incontestables qualités d’écrivain, mais sa carrière est interrompue par la mort dès 1917.
C’est avec deux ans de retard que le prix Goncourt 1914 a été attribué à Adrien Bertrand, qui avait vécu le début de la guerre de 14-18 comme chasseur alpin, puis avait été renvoyé pour raison de santé. Son roman révèle d’incontestables qualités d’écrivain, mais sa carrière est interrompue par la mort dès 1917.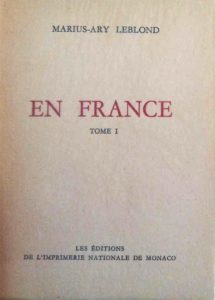 Ce sont deux cousins Réunionnais qui se cachent derrière ce pseudonyme de Marius-Ary Leblond qui obtint le Goncourt en 1909. Le titre est quelque peu trompeur, tant le récit ne concerne de la France que sa capitale, ville où un jeune créole vient effectuer ses études en ce début du XXème siècle. Paris est le lieu de toutes les découvertes, d’une forme de la civilisation « moderne » à une éducation sentimentale qui ouvre de larges horizons.
Ce sont deux cousins Réunionnais qui se cachent derrière ce pseudonyme de Marius-Ary Leblond qui obtint le Goncourt en 1909. Le titre est quelque peu trompeur, tant le récit ne concerne de la France que sa capitale, ville où un jeune créole vient effectuer ses études en ce début du XXème siècle. Paris est le lieu de toutes les découvertes, d’une forme de la civilisation « moderne » à une éducation sentimentale qui ouvre de larges horizons.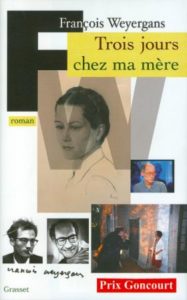 La lecture du Goncourt 2005 achevée, la question douloureuse est posée : mais quel est le sens de ce récit divagant, qui apparaît finalement comme le livre d’un auteur en mal d’inspiration, qui noircirait des pages parce que l’échéance du contrat signé avec l’éditeur approche à grand pas ?
La lecture du Goncourt 2005 achevée, la question douloureuse est posée : mais quel est le sens de ce récit divagant, qui apparaît finalement comme le livre d’un auteur en mal d’inspiration, qui noircirait des pages parce que l’échéance du contrat signé avec l’éditeur approche à grand pas ?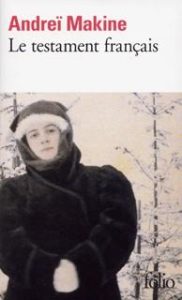 C’est Charlotte qui a séduit le jury du prix Goncourt 1995. Elle est l’attachante grand-mère du narrateur du « Testament français », celle qui été si importante pour lui dans sa passion pour la langue grand maternelle, pour la littérature française, et au bout du compte pour l’écriture.
C’est Charlotte qui a séduit le jury du prix Goncourt 1995. Elle est l’attachante grand-mère du narrateur du « Testament français », celle qui été si importante pour lui dans sa passion pour la langue grand maternelle, pour la littérature française, et au bout du compte pour l’écriture.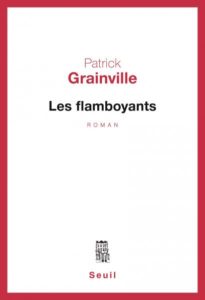 Si le flamboyant est un arbre africain très coloré, le style du Goncourt 1976 est autant flamboyant que coloré. L’histoire qui nous est contée est assez mince mais les mises en scène sont tellement enflées par l’exubérance de l’écriture que le roman paraît bien long.
Si le flamboyant est un arbre africain très coloré, le style du Goncourt 1976 est autant flamboyant que coloré. L’histoire qui nous est contée est assez mince mais les mises en scène sont tellement enflées par l’exubérance de l’écriture que le roman paraît bien long.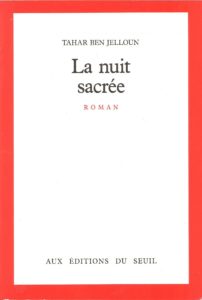 C’est dans une ambiance de conte oriental que le Goncourt 1987 nous narre l’histoire de Zahra, amenée à conquérir son identité de femme dans une société aux dures lois masculines. Et Tahar Ben Jelloun demeure dans la littérature en ne s’écartant pas du principe qu’il fait énoncer à un de ses personnages : « Un conte est un conte, pas un prêche ! »
C’est dans une ambiance de conte oriental que le Goncourt 1987 nous narre l’histoire de Zahra, amenée à conquérir son identité de femme dans une société aux dures lois masculines. Et Tahar Ben Jelloun demeure dans la littérature en ne s’écartant pas du principe qu’il fait énoncer à un de ses personnages : « Un conte est un conte, pas un prêche ! »