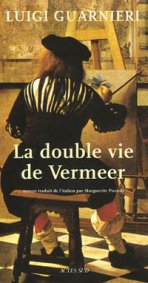 Voici certainement l’histoire de faussaire la plus gonflée et la plus réussie du siècle dernier.
Voici certainement l’histoire de faussaire la plus gonflée et la plus réussie du siècle dernier.
Dans la première partie du XXème siècle, Han van Meegeren (VM), peintre hollandais admirateur des grands maîtres du passé, pourfendeur des modernes de son temps, produit une peinture traditionnelle qui plaît au public mais n’éblouit pas la critique.
Petit à petit gagné par l’amertume à l’égard des milieux "autorisés" qui ont le tort selon lui de s’intéresser un peu trop à ces Magritte, Picasso et autre Dali, VM se répand en articles féroces contre les critiques et historiens d’art. C’est ainsi que d’un même mouvement, il signe son exclusion des milieux artistiques et commence à nourrir un incommensurable désir de vengeance.
Il décide alors de faire un faux, un faux idéal, qui trompera tout ce beau monde et fera de lui un artiste de génie.
Sa "victime", idéale elle aussi : la peinture de Vermeer, alors découverte depuis peu et déjà vouée aux gémonies. Par bonheur, l’on ignore pratiquement tout de la biographie de Vermeer et ses oeuvres authentifiées se comptent sur quelques poignées de main.
VM s’engouffre dans la brèche ouverte par un historien d’art, selon qui le peintre hollandais aurait eu une "période religieuse".
Utilisant les techniques, les matériaux et les pigments du XVIIème siècle, y compris le plus coûteux d’entre eux, le bleu lapis-lazuli, VM réalise un chef d’oeuvre Les Disciples d’Emmaus qui bluffe et les experts et l’Etat néerlandais.
Il faut préciser qu’il bénéficie du contexte de son époque – celle-là même qui le conduira plus tard à sa perte : pendant l’occupation des Pays-Bas par l’Allemagne, l’Etat se précipite pour acquérir ce miraculeux Vermeer, de crainte qu’il ne tombe entre les mains de l’occupant.
Tout aurait pu s’arrêter là. (Et l’on ne peut s’empêcher d’imaginer que dans d’autres circonstances, étant donné l’absence de soupçon sur cette oeuvre, ce faux n’aurait peut-être jamais été identifié comme tel et que l’on admirerait encore aujourd’hui ce Disciples d’Emmaus comme l’un des plus beaux Vermeer…)
Mais VM ne put s’arrêter là, bien que sa vengeance eût été accomplie : la facilité avec laquelle il avait aveuglé les experts avait donné raison au mépris dans lequel il les tenait.
En réalité, notre héros courait après la reconnaissance de son talent d’artiste et dès lors il se mit à multiplier les faux et les risques, négligeant de plus en plus de détails (poussé certainement par un désir profond de se dévoiler comme auteur de ces oeuvres) jusqu’à ce que l’un de ses acheteurs ne soit autre que le nazi Hermann Göring.
Cette "plaisanterie" finira donc à la Libération sur une accusation de collaboration avec l’ennemi (ce qui n’était visiblement pas son intention) et, pour y échapper, VM avouera ses forfaits et leurs mobiles.
Malgré son style plat, ce roman qui se lit comme un document est absolument passionnant. D’une part parce que, partagé entre dégoût et admiration, le lecteur ne peut s’empêcher de s’attacher à ce stupéfiant faussaire, après qui la valeur de l’art et ses appréciations se trouvent quelque peu relativisées. D’autre part parce que le sujet sur lequel il s’appuie, l’oeuvre de Vermeer et l’engouement qu’elle a entraîné au début du XXème siècle donnent à Luigi Guarnieri l’occasion d’aller faire un petit tour du côté de chez Swann, au cours d’une délicieuse digression sur le fameux petit pan de mur jaune que Proust via Bergotte admirait tant dans le tableau La vue de Delf, celui-ci, paraît-il, authentique Vermeer…
La double vie de Vermeer. Luigi Guarnieri
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
Actes Sud (2006) 229 p., 19,80 €
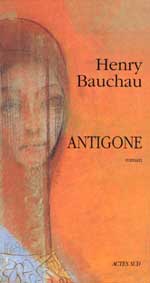 Depuis la mise en place de l’histoire et des personnages par Sophocle, on a connu beaucoup de versions d’Antigone. Elles ont été essentiellement été écrites pour le théâtre. Et voilà qu’un auteur, peu connu jusqu’alors malgré ses romans, ses recueils de poèmes, ses pièces de théâtre (et même sa biographie de Mao Zedong !), publie il y a dix ans un Antigone roman.
Depuis la mise en place de l’histoire et des personnages par Sophocle, on a connu beaucoup de versions d’Antigone. Elles ont été essentiellement été écrites pour le théâtre. Et voilà qu’un auteur, peu connu jusqu’alors malgré ses romans, ses recueils de poèmes, ses pièces de théâtre (et même sa biographie de Mao Zedong !), publie il y a dix ans un Antigone roman. Les mystères du rectangle, c’est d’abord le mystère de La Tempête, ce tableau peint par Giorgione en 1505 dont Siri Hustvedt est tombée amoureuse à l’âge de 19 ans lorsqu’une reproduction lui en a été montrée sur les bancs de l’université.
Les mystères du rectangle, c’est d’abord le mystère de La Tempête, ce tableau peint par Giorgione en 1505 dont Siri Hustvedt est tombée amoureuse à l’âge de 19 ans lorsqu’une reproduction lui en a été montrée sur les bancs de l’université. Servies par une prose claire et un langage simple, bien construites, joliment ramassées à chaque fin de chapitre, ces réflexions constituent une séduisante invitation à appréhender les oeuvres évoquées en adoptant le regard original de Siri Hustvedt.
Servies par une prose claire et un langage simple, bien construites, joliment ramassées à chaque fin de chapitre, ces réflexions constituent une séduisante invitation à appréhender les oeuvres évoquées en adoptant le regard original de Siri Hustvedt.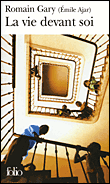 Prix Goncourt 1975, La vie devant soi a été publié sous le nom d’Emile Ajar, valant ainsi à Romain Gary un deuxième Prix Goncourt, après celui qui lui avait été attribué pour Les Racines du ciel en 1956.
Prix Goncourt 1975, La vie devant soi a été publié sous le nom d’Emile Ajar, valant ainsi à Romain Gary un deuxième Prix Goncourt, après celui qui lui avait été attribué pour Les Racines du ciel en 1956.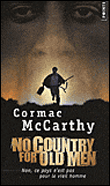 No country for old men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme), l’avant-dernier livre de Cormac McCarthy (1) vient d’être réédité en poche, juste avant la sortie du film des frères Coen, en salles aujourd’hui.
No country for old men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme), l’avant-dernier livre de Cormac McCarthy (1) vient d’être réédité en poche, juste avant la sortie du film des frères Coen, en salles aujourd’hui.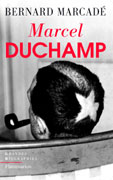 Marcel Duchamp est-il seulement celui qui renversa une pissotière pour en faire une fontaine ?
Marcel Duchamp est-il seulement celui qui renversa une pissotière pour en faire une fontaine ?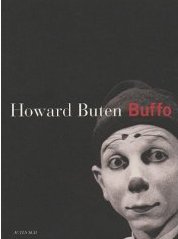 Buffo est ce clown singulier inventé par Howard Buten bien avant qu’il ne devienne l’auteur de Quand j’avais cinq ans je m’ai tué et le psychologue clinicien pour enfants que l’on sait.
Buffo est ce clown singulier inventé par Howard Buten bien avant qu’il ne devienne l’auteur de Quand j’avais cinq ans je m’ai tué et le psychologue clinicien pour enfants que l’on sait. On a parfois tendance à considérer Prévert à partir de nos souvenirs d’école, lorsqu’on récitait en choeur et par coeur Le cancre : des textes au langage simple destinés aux enfants.
On a parfois tendance à considérer Prévert à partir de nos souvenirs d’école, lorsqu’on récitait en choeur et par coeur Le cancre : des textes au langage simple destinés aux enfants. Voici un livre qui permet d’oublier vite fait bien fait la sale humidité de janvier.
Voici un livre qui permet d’oublier vite fait bien fait la sale humidité de janvier. Mots doux ou enflammés, mais mots toujours lyriques, à la fois si près du ridicule et si beaux. Que ne donnerait-on pas pour être dans l’état qui fait jaillir ce mouvement fou, ces mots maladroits, magnifiques, poétiques ?
Mots doux ou enflammés, mais mots toujours lyriques, à la fois si près du ridicule et si beaux. Que ne donnerait-on pas pour être dans l’état qui fait jaillir ce mouvement fou, ces mots maladroits, magnifiques, poétiques ?